· Qui sommes-nous ?
· GROUPES / REGIONS
Derniers groupes mis à jour :
· Pays Yonnais- Dialogue pour la paix
· Tibhirine - Nantes
· Asso Ephata Quimper
· CERDI
· Compostelle-Cordoue
· Croyants dans la Cité
· Cal. mois précedents 2024
· Calendrier interr. 2023
· Liens vers les amis
· En savoir plus sur les religions
Marche en Ariège 13 au 20 juillet 2024 : Randonnée dans la Réserve nationale de biodiversité d’Orlu, les monts d’Olme, le Pic St Barthélémy.
Strasbourg, du 14 au 20 octobre 2024 : Sacrées journées de Strasbourg - Festival des Musiques Sacrées du Monde.
MADIPAX, 3 au 10 mars 2024 : Voyage de la Paix interculturel à Barcelone.
Bulletin de Juin_2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de mai_2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de avril 2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de fevrier 2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de Janvier 2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de décembre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin de novembre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin d'octobre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin de septembre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin de janvier 2023 de l'association Tibhirine, voeux.
Bulletin de mai 2022 de l'association Tibhirine .(cliquer)
Bulletin d'octobre 2021 de l'association Tibhirine.(cliquer)>
le Bulletin d'avril 2021 de l'association Tibhirine.(cliquer)
le Bulletin de Decembre 2020 de l'association Tibhirine.(cliquer)
Nous vous recommandons des articles très intéressants à l'occasion du déconfinement dans:
Bulletin de juin 2020 de l'association Tibhirine.
La Lettre du CERDI, de juin 2020.
Et les numéros précédents, en temps de confinement:
Bulletin de mai 2020 de l'association Tibhirine.
l'Edition spéciale de la Lettre du CERDI ( Angers) sur le Coronavirus.
- Pour adhérer : Adhésion - Dispositif spécifique pour 2024 (cliquer )
- Pour nous contacter, participer à la vie de la CMRP,- Mode d'emploi du site :
Cliquer ICI
Refaire la France Replay dy débat aux Bernardins.
Sur l'Islam, débat entre Remi Brague et Ghaleb Bencheikh. Replay du débat aux Bernardins. Cliquer.
L'Islam et la liberté de conscience - Fondation de l'islam de France.
Si vous n'avez pas pu assister à ce Colloque en direct, il est visible en Replay sur la video de la Fondation de l'Islam de France ( cliquer )
Le Cri de la Paix, Religions et Cultures en dialogue, Rome 23 au 25 octobre 2022.
Avec Sant'Egidio. Autour de la guerre en Ukraine.
Video de l'Assemblée inaugurale, le 23 octobre 2022"
Frère Alois de Taizé : La prière comme source de paix. Cliquer.
- Vidéo de l'hommage-prière interconvictionnelle pour les victimes de la pandémie par l'association Agir pour la Fraternité.Paris 15e (cliquer)
- Mardi 5 février 2021 : vidéo-conférence :Fondacio, La dimension spirituelle des enjeux actuels, regards croisés ; juif, catholique, musulmane"> Revoir la rencontre du 5 février.
Vidéo à revoir : Cultiver la paix avec Louis Massignon.
 "Créons un monde où la Paix se construit avec la Justice
"Créons un monde où la Paix se construit avec la Justiceet où la Justice est guidée par l'Amour !"
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis,
Face à la situation, très affligeante, où se trouvent, actuellement, les peuple de l’Ukraine, de la Turquie et de la Syrie, et même beaucoup d’autres peuples dans le monde, comme celui, notamment, de l’Iran, je me permets de vous transmettre, ci-dessous, une courte prière extraite des Écrits Sacrés de la Foi Bahá'ie.
Je vous suggère – si cela vous convient – de la réciter en pensant à ces peuples meurtris…
Avec mes remerciements et mes chaleureuses salutations,
Rochan MAVADDAT
« Ô Seigneur Bienveillant ! Dissipe la détresse des malheureux.
Ô pure Providence ! Montre Ta miséricorde à ces enfants orphelins.
Ô Dieu qui suffit à tout ! Mets fin à ce déluge tumultueux.
Ô Créateur des mondes ! Éteins ce feu qui fait rage.
Ô Grand Secours ! Viens au secours des orphelins.
Ô Juge suprême ! Console les mères amèrement affligées.
Ô Seigneur compatissant et miséricordieux !
Aie pitié des yeux qui pleurent et du cœur meurtri des pères.
Apaise cette tempête et change cette guerre, qui embrase le monde, en paix et en réconciliation.
Tu es Celui qui voit et qui entend tout ! »< br />
Prière extraite des Écrits Sacrés de la Foi Bahá'ie ( cliquer ).


FEVRIER 2023
Jeudi 2 février 2023 - Fête chrétienne : Présentation de Jésus au Temple. Célébration de la lumière.
Marie accomplit le rite de purification, suivant la loi juive , et l'enfant Jésus est présenté au Temple. Il est reconnu comme lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël.
Pour les Orthodoxes : Sainte Rencontre ou Présentation au Temple (2 février en cal. grégorien; 15 février en cal. julien)
Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.
Dimanche 5 février 2023 - Fête chinoise : Yuanxiao / Shangyuan. Fête des lanternes.
Cette fête, placée sous le signe du Ciel, est une fête de la lumière qui clôt le cycle des festivités du Nouvel an. Elle est célébrée à la pleine lune qui suit le nouvel an. Fête nocturne, on la nomme parfois "petit Nouvel an".
Les enfants sortent à la nuit tombée tenant à la main une lanterne représentant des héros modernes ou traditionnels.
Dimanche 5 février 2023 - Fête bouddhique : Magha Puja
Fête du courant theravada
Le Magha Puja commémore le grand rassemblement de Bouddha et de ses 1 250 disciples au cours duquel il a donné les principes de son enseignement. Cette fête importante rend hommage à Bouddha. C'est le jour du Dharma. Elle est célébrée par les bouddhistes cambodgiens, laotiens, thaïlandais et srilankais. À cette occasion, les communautés offrent des fleurs et des cadeaux aux moines.
Date différente selon les pays : au Laos, Boun Khao Chi ( fête du riz grillé ) le 6 février.
Lundi 6 février 2023 - Fête juive : Tou Bichvat ; Nouvel an des arbres.
Célébration mystique de la création, devenue une journée de l'écologie.
Cette fête fait référence à la coutume qui consiste à ne pas prendre de fruits sur les arbres tant que ceux-ci n'ont pas atteint leurs quatre ans.
Mercredi 15 février 2023 - Fête bouddhique : Parinirvana
Commémoration mahayana de la mort du Bouddha et de sa libération ultime à l'âge de 80 ans. La journée est consacrée à méditer sur le caractère éphémère et illusoire du monde.
Samedi 18 février 2023 - Fête hindouiste : Maha Shivaratree.
La grande nuit de Shiva commémore la descente du Gange sur la terre. Shiva, pour sauver le monde, a recueilli le Gange dans ses cheveux, pour le faire couler sur la terre, et ainsi y a mis la vie.
Samedi 18 février 2023 - Fête musulmane : Isra’a wal-Mi’raj / Lailat al-Mi’raj – Le voyage nocturne. Nuit de l'ascension.
Laïlat Al Miraj est une fête de la prière et de la transmission de la foi
Commémoration de l'ascension nocturne du Prophète Muhammad de la Mecque à Jérusalem et de là par une échelle, vers le septième ciel dans la même nuit. Durant ce voyage lui fut révélé le commandement des cinq prières quotidiennes.
Mardi 21 février 2023 - Fête bouddhique : Nouvel An tibétain – Losar. 2150
Premier jour de l'an 2150 du calendrier vajrayana qui débute en -127, date de l'intronisation du premier roi tibétain. Le Nouvel An est suivi de quinze jours de festivités, de danses rituelles, d'offrandes et de prières pour la paix dans le monde.
Mercredi 22 février 2023 - Fête chrétienne : Mercredi des Cendres.
Premier jour du Carême, temps de jeûne qui prépare à la fête de Pâques.
Avec de la cendre, le prêtre trace une croix sur le front ou dans les mains des croyants en les invitant à changer de vie et à croire à la Bonne Nouvelle.
C'est un appel à revenir vers Dieu, pour accueillir sa paix et son pardon. De même, appel au pardon et à la réconciliation avec les autres.
Lundi 27 février 2023 - Grand Carême orthodoxe. ( du lundi 27 février au vendredi 7 avril)
40 jours d'abstinence pour préparer le Vendredi saint et Pâques ( 9 avril en cal grégorien ; 16 avril en cal julien ). Cette période de jeûne commence, chez les orthodoxes, par le Lundi Pur et se termine le vendredi précédant la semaine de la Passion..
Photo : Oliviers – Pixabay
 Prières interreligieuses contre le “Covid-19”, proposées par le
Prières interreligieuses contre le “Covid-19”, proposées par leCentre Bahà'i
24 Rue Maréchal Joffre.
06000 NICE.
CentreBahaiNice@absmark.com
- 14 Mai 2020.
Le “Haut-Comité pour la Fraternité Humaine” invite tous les croyants à une prière pour l'Humanité le 14 Mai prochain contre le Covid-19. Il propose également d'observer le jeûne et de participer à des œuvres de miséricorde.
“Vatican News” :
Le “Comité” invite les croyants à ne pas oublier de nous adresser à Dieu lors de cette crise du Covid-19, « danger imminent menaçant la vie de millions de personnes dans le monde». C'est pourquoi il appelle « tous les humains partout dans le monde à s’adresser à Dieu en priant, en observant le jeûne, en faisant des œuvres de miséricorde et en L’invoquant – chacun là où il se trouve selon sa religion, sa croyance, ou sa doctrine – de mettre fin à cette pandémie, de nous sauver de ce malheur et d'inspirer aux savants les moyens permettant de découvrir un remède susceptible de réduire à néant cette pandémie. »
L'objectif, pour le “Haut-Comité pour la Fraternité Humaine”, est de contrer les répercussions de la pandémie dans différents domaines, sanitaire, économique et humanitaire.
Le Comité invoque donc Dieu « pour qu’Il sauve l’Humanité et l'aide à mettre fin à cette pandémie et qu’Il rétablisse la sécurité, la stabilité, la santé et la prospérité de façon à rendre notre monde, après la fin de cette pandémie, plus humain et plus fraternel qu’avant. »
Remarque : Le « Haut-Comité pour la Fraternité Humaine » est né de la signature, le 4 Février 2019, à Abou Dhabi, du « Document sur la Fraternité humaine, pour la Paix mondiale et la Coexistence commune » par le Pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, lors du voyage du Saint-Père aux Émirats Arabes Unis. Depuis les initiatives se sont multipliées pour faire connaître ce document fondateur.
Si vous n’avez pas sous la main des prières issues de votre propre religion ou doctrine,
voici 3 exemples de Prières – tirées des Écrits Sacrés Bahá'is – que vous pourrez lire
lors de cette “Journée de Prières” :
-------------------------------------------
« En son nom, l’Éminent, le Très-Haut, le Sublime. Sois glorifié, ô Seigneur, mon Dieu ! Toi qui es mon Dieu, mon Maître et mon Seigneur, mon soutien et mon espoir, mon refuge et ma lumière !
Par Ton Nom celé et vénéré, que nul ne connaît sauf Toi, je te demande de protéger le détenteur de cette prière de toute maladie et calamité, de toute malveillance (…).
Ô mon Dieu, protège-le aussi de toute douleur et chagrin, Toi qui règnes sur toutes choses.
En vérité, Tu as pouvoir sur tout. Tu agis selon Ton désir et ordonne selon Ton plaisir.
Ô Roi des rois, ô Seigneur de Bonté ! Ô Source de Beauté ancienne, de Grâce, de Générosité et de Libéralité !
Ô Toi qui guéris, Toi qui suffis à tout, Lumière de Lumière, la plus éclatante des Lumières ! Toi qui révèles chaque [Messager divin], Toi, le Compatissant, le Clément !
En ton infinie Miséricorde et en ta Grâce abondante, fais preuve de clémence envers le détenteur de cette prière, ô Bienveillant, ô Généreux, protège-le de tout ce qui répugne à son cœur et à son esprit (…) ».
_______________________________________
« Ô Toi, Dieu indulgent, Tu es le refuge de tous Tes serviteurs. Tu connais les secrets, rien ne t’échappe. Nous sommes tous faibles, Tu es le Puissant, l’Omnipotent. Nous sommes tous des pécheurs, Tu pardonnes les péchés, Toi, le Miséricordieux, le Compatissant.
Ô Seigneur, ne considère pas nos faiblesses. Traite-nous selon Ta grâce et Ta miséricorde. Nombreux sont nos défauts, mais infini est l’océan de Ton pardon, grande est notre indigence, mais manifestes sont les signes de Ton aide et de Ton soutien. Aussi, confirme-nous et fortifie-nous.
Que nos actes soient dignes de Ton seuil divin ! Illumine notre cœur, donne-nous des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Ressuscite le mort et guéris le malade. Accorde la richesse au pauvre, la paix et la sécurité à celui qui a peur. Accepte-nous dans Ton Royaume, éclaire-nous de la Lumière de Tes conseils.
Tu es le Puissant et l’Omnipotent, Tu es le Généreux, Tu es le Clément, Tu es le Bienveillant. »
________________________________
« Ô mon Seigneur, Tu sais de combien de souffrances et de calamités, de tribulations et d’afflictions, est entourée l’Humanité. Les épreuves et les infortunes s’attaquent à l’Homme telles des serpents. Il n’est pour lui ni abri ni refuge si ce n’est sous l’aile de Ta protection et de Ton assistance, de Ta garde et de Ta tutelle.
Ô toi, le Miséricordieux, ô mon Seigneur, fais de Ta protection mon armure, de Ton assistance mon bouclier, de l’humilité au seuil de Ton unité ma sauvegarde, de Ta tutelle et de Ta défense ma forteresse et ma demeure.
Préserve-moi de l’influence de mon ego et de mes désirs, et protège-moi de toute épreuve et maladie, difficulté et tribulation.
En vérité, Tu es le Protecteur, le Gardien, le Défenseur. Tu es celui qui suffit à tout, Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux ! »
______________________________


SEPTEMBRE 2019
Samedi 31 août 2019 - Fête musulmane : 1er Moharram* ( date variable selon l'observation de la lune ).
Hégire, nouvel an : 1441 ; en souvenir du départ du Prophète Muhammad de la Mecque vers Médine en 622, pour créer une communauté qui respecte les préceptes qu'il a reçus. On fait la fête en famille et entre amis ; on formule des vœux de bonheur pour l'année à venir.
Dimanche 1er septembre 2019 - Fête chrétienne : Journée mondiale de prière pour la Création , jusqu'au 4 octobre fête de François d'Assise.
C’est en 1989 que Demetrios le patriarche de l’Église orthodoxe a décidé de consacrer le 1er jour de l’année liturgique à la sauvegarde de la création. Il a ainsi invité toutes les églises du monde orthodoxe et chrétien à faire des prières de remerciement pour le grand don du monde créé, des prières pour sa protection et son salut.
Dix ans plus tard, en 1999 le Réseau Chrétien Européen pour l’environnement reprend cette proposition, avec des dates diverses selon les Eglises.
Dans la lignée de son encyclique Laudato Si, le Pape François a pris l'initiative, le 6 août 2015, d'instituer le 1er septembre : « la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création », pour offrir à chacun l'opportunité de renouveler son adhésion personnelle à sa vocation de gardien de la création.
Dimanche 1er septembre 2019 - Fête orthodoxe : Début de l’année liturgique orthodoxe
L’année liturgique des Églises orthodoxes s’ouvre en septembre et s’achève quinze jours après la fête de la Dormition de Marie, mère du Christ.
Lundi 2 septembre 2019 - Fête hindouiste : Ganesha Chaturthi.
Naissance du fils de Shiva, Ganesh, dieu du savoir, reconnaissable à sa tête d'éléphant. Il est invoqué au commencement de toute nouvelle entreprise.
Mardi 3 septembre 2019 - Fête jaïne : Samvatsari
Jour le plus sacré de l’année jaïne, qui clot la période de Paryushana Parva, période de jeûne, de prière et de méditation qui prend fin le 3 septembre avec Samvatsari, jour du repentir, du pardon et de l’abandon de toute haine ou méchanceté.
Dimanche 8 septembre 2019 - Fête catholique et orthodoxe : Nativité de Marie (8 septembre: cal. grégorien; 21 septembre: cal. julien)
Fête de la naissance de Marie, mère du Christ.
Orthodoxes : Nativité de Notre Souveraine, la Très Sainte Mère de Dieu.
Lundi 9 septembre 2019 - Fête musulmane : Achoura ( date variable selon les observations de la lune ).
Souvenir, pour les Shi’ites, du massacre de l’Imâm Hussein,
fils d’Ali et petit-fils du Prophète Muhammad, et de sa famille. Suivie de 40 jours de deuil.
Pour les Sunnites, c'est une journée de jeûne, de dons et de partage Les enfants reçoivent des cadeaux.
Vendredi 13 septembre 2019 - Fête taoiste : Zhongqiu
Fête de la mi-automne en l’honneur de la Lune. Fête des enfants, par des cadeaux et des gâteaux.
On y mange des gâteaux de lune appelés yuebing.
Samedi 14 septembre 2019 - Fête chrétienne : Exaltation de la Croix (14 septembre: cal. grégorien; 27 septembre: cal. julien)
Grande fête orthodoxe en souvenir de la découverte de la vraie Croix par Hélène en 326.
Pour les catholiques : la Croix glorieuse. C'est le rappel que, par la Croix, signe de la résurrection du Christ, la mort a été vaincue par la vie.
Dimanche 15 septembre 2019 - Fête catholique : Notre-Dame des Douleurs.
Debout au pied de la Croix, Marie connut le glaive de douleurs que lui avait annoncé le vieillard Siméon dans le Temple au jour de la Présentation de Jésus.
Mardi 17 septembre 2019 - Fête hindouiste : Début de Govinden, mois dédié à Krishna. Selon la mythologie hindoue, Dieu en sa forme de Shri Krishna, abrita les habitants de la cité de Maduraï du déluge qui eut lieu pendant ce mois et qui ravagea le monde ( Cal. Strasbourg ).
Samedi 21 septembre 2019 - ONU : Journée internationale de la paix (instituée par l’ONU en 1981)
Journée dédiée à la paix, qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Elle est observée dans de nombreux pays depuis sa création en 1981.
Depuis 2002, cette Journée commence au siège des Nations unies à New York par une cérémonie en présence du secrétaire-général qui fait sonner la Cloche de paix, fabriquée à partir de pièces de monnaie données par des enfants de tous les continents. C'est un don de l'association japonaise pour l'ONU et se veut un « rappel de ce que la guerre a coûté à l'humanité ». Elle porte cette inscription : « Longue vie à la paix dans le monde ».
Mercredi 25 septembre 2019 - Fête confucéenne : Naissance de Confucius * (-551 à -479)
Vénéré sous le nom de maître Kong, son enseignement a donné naissance à la tradition confucéenne en Chine.
Samedi 28 septembre 2019 - Fête hindouiste : Malaya Paksha.
Journée d'hommages aux défunts, très importante dans l'hindouisme.
Dimanche 29 septembre 2019 - Fête hindouiste : Navaratri / Durga Puja (du 29 septembre au 7 octobre)
Célébration de la Déesse mère, dans ses différentes manifestations.
Lundi 30 septembre 2019 - Fête juive : Roch ha-Chanah * (30 septembre et 1er octobre) la Tête de l'année.
Nouvel An (1er Tishri) 5780,. Rappel de la création du monde et de la souveraineté de Dieu.
Cette fête est une célébration joyeuse de la création.
En même temps, elle est appelée « Jour du jugement ». C'est un temps de réflexion pour la communauté et l'individu. Dieu juge les actes de l'année écoulée. C'est le début d'un jeune de 10 jours qui précède Yom Kippour, le Grand Pardon, le 8-9 octobre 2019, fête solennelle qui apporte le pardon de Dieu.
Photo : Saison de la Création, http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ .

Calendrier 2011, 12 mois.

JANVIER 2011
Samedi 1er janvier 2011 - Fête shinto : Ganjitsu (du 1er au 3 janvier) .
Nouvel An japonais, fêté depuis 1873 selon le calendrier grégorien. Les Japonais offrent des prières ainsi que des vœux de santé et de prospérité. Ils fréquentent les temples, portent leurs plus beaux vêtements et nettoient leur demeure. Ils offrent des étrennes et la fête s’étend sur plusieurs jours.
Dimanche 2 janvier 2011 - Fête chrétienne : Epiphanie du Seigneur.
Cette fête, appelée aussi jour des Rois, célèbre l'arrivée des Rois mages à Bethléem pour adorer l'Enfant Jésus. Plus largement, elle célèbre la manifestation de Dieu à toute l'humanité.
Mercredi 5 janvier 2011 - Fête sikhe : Naissance du gourou Gobind Singh
Le gourou Gobind Singh Ji (1666-1708) est le dixième maître spirituel sikh. Il a fondé la confrérie des Purs (Khalsa) dont les membres portent cinq attributs (kesh, kaccha, kirpan, kangha et kara). Il a transmis sa succession spirituelles dans le Guru Granth Sahib, le livre sacré des sikhs.
Jeudi 6 janvier 2011 - Fête chrétienne orthodoxe : Théophanie. (19 janvier en calendrier julien)
La Théophanie est associée au baptême de Jésus par Jean et au miracle de Cana où Jésus changea l'eau en vin.
Vendredi 7 janvier 2011 - Fête chrétienne : Noël, en calendrier julien.
Grande fête de la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem.
Vendredi 14 janvier 2011 - Fête hindoue : Pongal ou Makara Samkranti.
Solstice d'hiver et Nouvel An solaire; vénération du soleil.
Le Pongal, appelé aussi Makara Samkranti dans certains endroits de l'Inde, est une fête des moissons et d'action de grâce. Elle souligne l’arrivée de la nouvelle récolte et correspond au premier jour du mois thai du calendrier tamoul. La fête est l’occasion de décorer les maisons, de participer à des concours de cerfs-volants et de partager des repas en famille et entre amis.
Mardi 18 janvier 2011 - Fête chrétienne : semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Prière oecuménique sur l'initiative de l'abbé Couturier en 1935 (du 18 au 25 janvier).
Jeudi 20 janvier 2011 - Fête hindoue : Vasanta Panchami / Sarasvati Puja.
Fête de Sarasvati, déesse de l'éducation et des arts.
Jeudi 20 janvier 2011 - Fête juive : Tu Bishevat.
Tu Bishevat, qui est le 15e jour du mois de shevat, marque le premier jour de l'an pour les arbres. On célèbre cette fête en plantant des arbres.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
Photo de Denise T.

FEVRIER 2011
Mercredi 2 février 2011 - Fête chrétienne : Présentation au Temple Fête de la Chandeleur ; le 15 février en calendrier Julien.
Fête orthodoxe et catholique de la purification de la Vierge et de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.
Jeudi 3 février 2011 - Fête religieuse chinoise : Nouvel An.
Le Nouvel An chinois est célébré habituellement entre les mois de janvier et de février du calendrier occidental. Les Vietnamiens fêtent également le Nouvel An ou Têt à cette date. En 2011, l'année chinoise débute le 3 février sous le signe du Lièvre.
Mercredi 9 février 2011 - Fête chrétienne maronite : Saint-Maron.
Fête en l'honneur du fondateur de la religion maronite qui est l'une des branches des Églises orientales catholiques.
Mardi 15 février 2011 - Fête musulmane : Mawlid an Nabi , date variable selon l'observation de la lune.
Naissance du Prophète Muhammad le 20 août 570 de l’ère Chrétienne. Cette fête se célèbre par des processions et des cérémonies qui rappellent la vie et les enseignements du Prophète.
Mardi 15 février 2011 - Fête bouddhique : Parinirvana
Cette fête de la tradition bouddhiste mahayana commémore l’entrée de Bouddha dans le nirvana complet, à l'âge de 80 ans.
Jeudi 17 février 2011 - Fête religieuse chinoise : Yuan Xiao
Yuan Xiao, ou Fête des Lanternes, a lieu le quinzième jour du premier mois du calendrier lunaire. On l'appelle aussi chang yuan et hiao kouo nien, le petit Nouvel An.
Vendredi 18 février 2011 - Fête bouddhique : Magha Puja
Le Magha Puja ou Makha Bucha commémore le grand rassemblement de Bouddha et de ses 1 250 disciples au cours duquel il a donné les principes de son enseignement. Cette fête importante rend hommage à Bouddha. C’est le jour du Dharma. Elle est célébrée par les bouddhistes cambodgiens, laotiens, thaïlandais et srilankais. À cette occasion, les communautés offrent des fleurs et des cadeaux aux moines.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses, nous les publierons volontiers.
Photo de Bernard Reber.

MARS 2011
Mercredi 2 mars 2011 - Fête bahá´ íe : Jeûne du mois de `Ala, du 2 au 20 mars.
Jeûne du dernier mois baha'i, qui précède la fête du Nouvel An le 21 mars.
Jeudi 3 mars 2011- Fête hindoue : Mahashivaratri.
Fête du dieu Shiva, l'une des principales divinités auxquelles les hindous adressent leur dévotion.
La danse cosmique de ce dieu crée, protège, détruit et recrée le monde. Les fidèles jeûnent durant la journée et, la nuit, ils veillent dans les temples dédiés au dieu.
Jeudi 3 mars 2011 - Fête shintoïste : Hina Matsuri
Hina Matsuri ou le Festival des fleurs s’appelle aussi la Fête des petites filles ou Fête des poupées.
Samedi 5 mars 2011 - Fête bouddhique : Losar.
Nouvel An tibétain. Il coïncide avec le premier jour de la nouvelle année lunaire. C'est l'une des deux fêtes les plus importantes au Tibet. À cette occasion, on organise des festivités pendant une quinzaine de jours.
Lundi 7 mars 2011 - Fête orthodoxe. : Le Grand Jeûne.
Pour les Églises orientales, ce Grand Carême est observé pendant les six dernières semaines de la période de dix semaines menant à la Semaine sainte et à la Pascha ou Pâques orthodoxe, .
Mercredi 9 mars 2011 - Fête chrétienne : Mercredi des cendres.
Pour les catholiques, mercredi des Cendres, jour de repentir, de jeûne et d'abstinence. Marque le début du Carême, qui dure 40 jours (sans les dimanches) et s'achève à Pâques (4 avril). Son nom vient de la cérémonie qui consiste à tracer une croix avec des cendres sur le front des fidèles. C'est un temps de prière et de partage. D'autres fidèles de religions chrétiennes observent ce temps de jeûne.
Dimanche 13 mars 2011 - Fête chrétienne : 1er dimanche de Carême.
Pour les Orthodoxes : Dimanche de l'Orthodoxie.
Pour les Catholiques : 1er dimanche des 40 jours de Carême.
Lundi 14 mars 2011 - Fête sikhe : Nouvel An sikh 542
Le calendrier Nanakshahi, nommé en l’honneur du premier gourou Nanak, amorcera sa 542e année le 14 mars 2011.
Samedi 19 mars 2011 - Fête hindoue : Holi.
Ce carnaval du printemps est la fête la plus gaie de toutes les fêtes hindoues. Des personnes de tous âges s’amusent à se lancer de la poudre et de l'eau colorée. On y échange des vœux et des sucreries.
Dimanche 20 mars 2011 - Fête juive : Pourim.
Célébrée à la fin de l’hiver, Pourim ou Fête des sorts commémore le salut de la communauté juive tel qu’il est décrit dans le Livre d’Esther . fête joyeuse inspirée par l'atmosphère de jubilation du peuple d'Israël au moment de l'exaucement de la prière d'Esther pour son père Modekhaï et de la victoire sur Haman, l'ennemi du peuple de Dieu.
Lundi 21 mars 2011 - Fête bahá´íe : Naw-Rúz.
Nouvel An baha'i 168, sous le signe de la joie; à l'équinoxe de printemps, symbolise le renouveau spirituel et la croissance.
Lundi 21 mars 2011 - Fête zoroastrienne : Now Ruz.
Nouvel An mazdéen 1379. Cette fête du Nouvel An, célébrée par les Iraniens et la diaspora zoroastrienne, date de l’antiquité perse (600 av. J.-C). Elle est associée à l’équinoxe du printemps et au renouveau de la nature.
Mardi 22 mars 2011 - Fête hindoue : Nava-Varsha / Sithrabahnu-Varsha.
Nouvel An solaire (1933 de l'ère saka), souvent célébré le 13 ou 14 avril.
Vendredi 25 mars 2011 - Fête chrétienne : Annonciation (7 avril, en calendrier julien)
Fête catholique et orthodoxe de l'annonce faite à Marie de la naissance de Jésus.
Samedi 26 mars 2011 - Fête zoroastrienne : Khordad Sal (27 août pour les parsis indiens).
En Iran, les mazdéens fêtent la naissance de Zarathoustra.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
Photo de Jean-Pierre Martin : Alpes du Sud

AVRIL 2011
Mardi 5 avril 2011 - Fête chinoise : Ch'ing Ming.
Festival de la lumière et fête de la commémoration des ancêtres.. Visite et nettoyage des tombes familiales, dépots d'offrandes.
Jeudi 7 avril 2011 - Fête chrétienne : Annonciation, en calendrier julien.
Fête religieuse orthodoxe de l'annonce de la naissance de Jésus faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel.
Vendredi 8 avril 2011 - Fête bouddhiste : Naissance du Bouddha Gautama
C'est une fête de la tradition bouddhiste mahayana qui commémore la naissance de Bouddha. Cette tradition est pratiquée en Chine, au Tibet, au Népal, au Vietnam, en Corée et au Japon.
Vendredi 8 avril 2011 - Fête shintô :Hanamatsuri.
Festival des fleurs
Mardi 12 avril 2011 - Fête hindoue : Rama Navami.
Rama Navami, ou Naissance de Rama, célèbre l'anniversaire de Rama, la septième incarnation du dieu Vishnou. Pendant les huit jours précédant cette fête, les hindous lisent le Ramaya, une épopée hindoue qui raconte l'histoire de Rama.
Mercredi 13 avril 2011 - Fête bouddhiste : Nouvel An theravada 2555
Le nouvel an du calendrier Saka est une fête religieuse et culturelle pour les Hindous, les Birmans, les Laotiens, les Thaïlandais, les Cambodgiens et les Cingalais de l'École Therevada.
Jeudi 14 avril 2011 - Fête hindoue : Nava-Varsha.
Nava-Varsha marque le début du Nouvel An solaire. C'est aussi la fête de la célébration des moissons. Pour l’occasion, les maisons sont décorées de fleurs, des cortèges arpentent les rues et des friandises sont distribuées.
Jeudi 14 avril 2011 - Fête sikhe :Vaïsakhi.
La Fête des moissons qui annonce le retour du printemps, marque aussi pour les vingt-cinq millions de Sikhs répartis dans le monde, l’anniversaire de la révélation de l’Ordre des Khalsa (les Purs, c’est-à-dire celles et ceux qui vouent leur existence à la purification spirituelle et à la lutte contre l’ego) qui eût lieu en 1699.
Samedi 16 avril 2011 - Fête jaïne : Mahavir Jayanti.
Mahavir Javanti est un festival qui marque l’anniversaire du Vardhamana Mahavira, le vingt- quatrième tirthankara, né en -599.
Dimanche 17 avril 2011 - Fête chrétienne : Dimanche des Rameaux.
Fête l'entrée de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes.
C'est le début de la semaine sainte, du 17 avril au 24 avril (fête de Pâques).
Les dates sont les mêmes, cette année, en calendrier julien et grégorien.
Mardi 19 avril 2011 - Fête juive : Pessah, 19 et 20 avril. Le 8e jour : 26 avril.
Cette fête commémore l’exode des Hébreux de l’Égypte et leur libération miraculeuse de l’esclavage. Cette fête, célébrant la liberté, a une durée de huit jours.
On consomme des pains azymes c'est à dire sans levain, pour rappeler que les hébreux n'eurent pas le temps de faire lever le pain avant leur départ.
Jeudi 21 avril 2011 - Fête bahá´ íe : Ridvan, du 21 avril au 2 mai.
Proclamation en 1863 de Baha'u'llah
Jeudi 21 avril 2011 - Fête chrétienne : Jeudi Saint.
Commémoration de la Cène, le dernier repas de Jésus pris avec ses disciples à l’occasion de la Pâque juive. l'Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis les fidèles s'unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint- Sacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit.
Vendredi 22 avril 2011 - Le Vendredi saint commémore la mort de Jésus sur la croix. Les chrétiens sont appelés au jeûne.
L'office de la nuit du samedi saint s'appelle la vigile pascale. C'est le prélude à la fête de Pâques. À cette occasion, le cierge pascal, symbolisant le Christ ressuscité, est allumé dans les églises à partir du feu nouveau.
Dimanche 24 avril 2011 - Fête chrétienne : Pâques ou Pascha pour les orthodoxes, en 2011 la date est la même pour tous les chrétiens.
Cette fête commémore la résurrection de Jésus, espérance de vie éternelle pour tous les croyants.
Dans l’Église orthodoxe, l'année religieuse commence avec Pascha. 24/4 Pâques
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
Photo de Jean-Pierre Martin : Alpes du Sud

MAI 2011
Du jeudi 21 avril au lundi 2 mai 2011 - Fête bahá´ íe : Ridvan.
Proclamation en 1863 de Baha'u'llah
Dimanche 1er mai 2011 - Commémoration : Yom HaShoah.
Journée à la mémoire des victimes de la Shoah
Vendredi 6 mai 2011 - Fête jaïne : Akshaya-tritiya.
Akshaya-tritiya célèbre le jour où le premier Tirthankara, Rishabha, dont la tradition fait le fondateur du jaïnisme, mit fin à son premier jeûne.
Mardi 17 mai 2011 - Fête bouddhique : Wesak.
La fête commémore la naissance, l’éveil et la mort de Siddhartha Gautama dit Bouddha (566-486 av. J.-C.). Elle a lieu le jour de la pleine lune de mai. Selon la tradition bouddhique, les trois événements majeurs de sa vie ont eu lieu le même jour, signe de sa destinée hors du commun.
Lundi 23 mai 2011 - Fête bahá´ íe : Déclaration du Bab.
Anniversaire de la proclamation du Bab précurseur de Baha'u'llah.
Vendredi 29 mai 2011 - Fête zoroastrienne : Zartusht-no Diso
Les parsis indiens commémorent la mort de Zarathoustra.
Vendredi 29 mai 2011 - Fête bahá´ íe : Ascension de Baha'u'llah.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
Photo de Denise Torgemane : Rosée de mai.

JUIN 2011
Jeudi 2 juin 2011 - Fête chrétienne : Ascension - (Comme pour la date de Pâques, les fêtes qui s'y rattachent coïncident cette année chez les catholiques et les orthodoxes.)
L’Ascension célèbre l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, c’est-à-dire la fin de sa présence visible sur terre et son entrée dans le royaume de Dieu, après 40 jours d'apparitions.
Mercredi 8 juin 2011 - Fête juive : Shavouot, 8 et 9 juin.
Fête des Semaines, elle est célébrée à la date se trouvant sept semaines à partir du 2e soir de Pessah. Shavouot est également appelée : "époque du don de la Torah."
Le jour de Shavouot sont lus les dix commandements qui ont été donnés au pied du mont Sinaï, non seulement aux hébreux, mais à toute l'humanité, qui évoque l'universalité des 10 commandements.
Dimanche 12 juin 2011 - Fête chrétienne : Pentecôte.(Comme pour la date de Pâques, les fêtes qui s'y rattachent coïncident cette année chez les catholiques et les orthodoxes.)
Célébrée 50 jours après Pâques, c'est la fête du Don de l'Esprit de Dieu aux apôtres et à l'Église, suivie du dimanche de la Trinité le 30 mai.
Orthodoxie: fête de la Trinité suivie, le lundi 24 mai, du don de l'Esprit à l'Eglise.
Mercredi 15 juin 2011 - Fête bouddhique : Poson (sous réserve de confirmation officielle).
Fête de l'arrivée du bouddhisme au Sri Lanka.
Mercredi 15 juin 2011 - Fête bouddhique : Sangyepa / Saga dawa (sous réserve de confirmation officielle).
La fête commémore la naissance, l’éveil et la mort de Siddhartha Gautama dit Bouddha (566-486 av. J.-C.). Elle a lieu le jour de la pleine lune de mai. Selon la tradition bouddhique, les trois événements majeurs de sa vie ont eu lieu le même jour, signe de sa destinée hors du commun.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
Fontaine : Photo de Jean-Pierre Martin : Alpes du Sud

JUILLET 2011
Vendredi 1er juillet 2011 - Fête catholique : le Sacré-Coeur de Jésus.
C'est la Fête de l'Amour de Dieu manifesté en "Jésus, doux et humble de coeur".
Samedi 9 juillet 2011 - Fête bahá´íe : Martyre du Bab
Commémoration par des lectures et des prières de l'exécution du Bab à Tabriz en Iran le 9 juillet 1850.
Mercredi 13 juillet 2011 - Fête shintô : O-bon, du 13 au 15 juillet.
Cérémonie en l’honneur de l’esprit des morts, qui est accueilli avec des danses dans les maisons et les villages pendant trois jours.
Vendredi 15 juillet 2011 - Fête bouddhique : Asala Puja.
Asala Puja est une fête bouddhiste créée en souvenir du premier sermon de Bouddha à Bénarès. Début de la retraite monacale de trois mois à la mousson.
Lundi 25 juillet 2011 Fête Catholique : Saint-Jacques-de-Compostelle
Appelé par le Christ avec son frère Jean, saint Jacques le Majeur fut témoin de la Transfiguration et de Gethsémani. Il fut le premier apôtre à subir le martyre. Son culte culmine à Compostelle, point de convergence de quatre chemins d'un pèlerinage qui, depuis le Moyen Âge, attire les randonneurs de toutes croyances et origines.
Vendredi 29 juillet 2011 - Fête islamique : Lailat al Miraj (La nuit du voyage et de la montée au ciel) Date variable selon l'observation de la lune.
Fête du voyage du Prophète Muhammad de la Mecque à Jérusalem et de là vers le ciel dans la même nuit. Durant ce voyage, lui fut révélé le commandement des cinq prières quotidiennes. Aujourd’hui, à Jérusalem, la mosquée du Rocher s’élève sur le rocher d’où le Prophète s’est élevé. (oumma.com)
Annonce anticipée :
Du lundi 1er août au 31 août 2011 - Fête islamique : Ramadan, dates variables selon l'observation de la lune.
Mois où l’on jeûne à partir du lever du soleil jusqu’à son coucher. Interdiction totale de se nourrir, de boire, de fumer.
Photo de Jacqueline Martin : statue de Saint-Jacques-de-Compostelle, au Puy en Velay.

AOUT 2011
Lundi 1er août 2011 - Fête islamique : mois de Ramadan.
Le ramadan est la période durant laquelle les musulmans vivent une période de jeûne, de l'aube jusqu'au crépuscule. Temps de recueillement, de prières et de maîtrise de soi, il est sacré pour les musulmans parce que c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé au Prophète Mohamed. Le jeûne du ramadan est le quatrième pilier de l'islam.
Mercredi 3 août 2011 - Fête bouddhique : Chökhor.
Dans la tradition bouddhiste tibétaine, cette fête commémore le premier sermon de Bouddha.
Samedi 6 août 2011 - Fête chrétienne : la Transfiguration.
Apparition du Christ Jésus transfiguré, dans l'éclat de sa divinité, à ses trois disciples Pierre, Jacques et Jean, tel qu'il est relaté dans les Evangiles.
Très grande fête en Orient. Fêtée le 19 août dans le calendrier julien.
Mardi 9 août 2011 - Fête juive : Jeûne du 9 Av
Jour de jeûne et de deuil afin de souligner la destruction du saint Temple de Jérusalem. Ce jour est précédé de trois semaines d'évocation des catastrophes de l'histoire juive.
Samedi 13 août 2011 - Fête chinoise : Chung Yüan.
Festival des ancêtres ou "esprits affamés" pour qui l'on confectionne des simulacres de papier.
Les esprits qui ne peuvent trouver la paix se voient offrir des repas réconfortants et des cérémonies pour leur délivrance.
Samedi 13 août 2011 - Fête hindoue : Raksha Bandhan.
Raksha Bandhan, ou Festival des frères et sœurs, est un festival qui célèbre l'amour entre frères et sœurs. Il est symbolisé par un bracelet tissé, appelé « rakhi », que chaque jeune fille, mariée ou non, offre à son frère.
Lundi 15 août 2011 - Fête chrétienne : Assomption (catholique) / Dormition (orthodoxe) , le 28 août pour le calendrier julien.
Pour les catholiques: Célébration de la montée au ciel de l'âme et du corps de la Vierge Marie.
Pour les orthodoxes: mystère de son endormissement. Grande fête précédée par un jeûne de deux semaines. La croyance est que le corps de Marie n'a pas connu la corruption qui suit la mort . Marie ressuscitée a été transportée au ciel par les anges
Lundi 22 août 2011 - Fête hindoue : Janmashtami / Krishna Jayanti
Fête de la naissance de Krishna. Selon les épopées hindoues, Krishna était la huitième incarnation du dieu Vishnou.
Lundi 22 août 2011 - Fête zoroastrienne : Now Rouz [21 mars pour les mazdéens iraniens]
Nouvel An mazdéen 1380 pour les parsis indiens.
Vendredi 26 août 2011 - Fête jaïne : Paryushana-parva.
Paryushan est la période la plus sacrée de l'année pour le groupe ascétique Shvetambara. C'est une période où les adeptes se vouent encore plus intensément aux idéaux du jaïnisme par le jeûne, la vénération de Jina et la lecture publique de l'histoire de la vie de Mahâvira décrite dans le Kalpasutra. La fête dure huit jours et se termine au Samvatsari.
Samedi 27 août 2011 - Fête zoroastrienne : Khordad Sal.
Les parsis indiens fêtent la naissance de Zarathoustra.
Samedi 27 août 2011 - Fête islamique : Lailat al-Qadr. Date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune.
Nuit du Destin, Laylat al Qadr est la nuit où le Coran, le livre sacré des musulmans, a été révélé au Prophète Mohamed lorsqu'il était en méditation dans la grotte de Hira à La Mecque. C'est une nuit bénie, une nuit de grande ferveur religieuse que les musulmans pieux passent à la mosquée en priant et en récitant le Coran, pour que Dieu leur accorde une bonne destinée.
Mardi 30 août 2011 - Fête islamique : Aïd al-Fitr. Date variable (1 à 2 jours) en fonction de l'observation de la lune
Cette fête marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Une prière solennelle est célébrée dans les mosquées après le lever du soleil.
Jour de joie, de rencontre des frères, de tolérance, de piété, d'aumône et de pardon. Ce jour-là, les fidèles mettent des habits neufs, présentent leurs voeux aux membres de leur famille et donnent des cadeaux aux enfants.
Photo : Cap Bon, de H. de La Salle.

SEPTEMBRE 2011
Jeudi 1er septembre 2011 - Fête sikhe : Guru Grant Sahib.
Fête du Livre sacré des sikhs, elle commémore la reconnaissance officielle du Livre saint sikh l'Adi Granth.C'est le gourou Arjan Dev qui a constitué la première édition des textes sacrés sikhs et qui les a installés officiellement en 1604 de l'ère chrétienne dans le Temple d'or. Ce livre sacré des sikhs, nommé depuis 1708 Guru Granth Sahib, a été désigné plus tard par le dixième gourou Gobind Singh comme le maître spirituel des sikhs après sa mort.
Jeudi 1er septembre 2011 - Fête chrétienne : Début de l'année liturgique orthodoxe
Jeudi 1er septembre 2011 - Fête hindoue : Ganesha Chaturthi
Naissance du fils de Shiva, Ganesha, dieu du savoir, reconnaissable à sa tête d'éléphant. Il est invoqué au commencement de toute nouvelle entreprise.
Samedi 3 septembre - Fête jaïne : du 26 août au 3 septembre 2011 :
Paryushana-parva est une période de jeûne et de prière, un temps de pénitence et de pardon. Elle se termine le 3 septembre par le Samvatsari, qui est la plus grande fête du calendrier jaïn, avec la demande de pardon à tous les êtres vivants, pour le mal que les adeptes ont pu leur causer au cours de l’année, volontairement ou involontairement, et par l’expression de leur propre pardon à tous. ( jainworld.com)
Jeudi 8 septembre 2011 - Fête chrétienne : Nativité de Marie. (le 21/9 en calendrier julien)
Grande fête orthodoxe et catholique de la naissance de Marie, mère du Christ.
Mercredi 14 septembre 2011 - Fête chrétienne : Exaltation de la croix ( 27/9 en calendrier julien )
Grande fête orthodoxe de la découverte de la Croix par Hélène en 326.
Mercredi 21 septembre : Journée internationale de la Paix (O.N.U.)
Jeudi 22 septembre 2011 - Fête chinoise : Chung Ch'iu.
Chung Ch'iu, ou Festival de la lune est une fête de la Chine ancienne. Elle coïncide avec la pleine lune de la huitième lune et avec la saison des pluies. C'est aussi une occasion de rendre grâce pour l'abondance des récoltes.
Vendredi 23 septembre 2011 - Fête shintô : Shubun no hi / Higan.
Fête japonaise de l'équinoxe: les bouddhistes visitent les temples et les cimetières.
Mercredi 28 septembre 2011 - Fête chinoise : naissance de Confucius.
Cette fête célèbre l'anniversaire de naissance du grand penseur et philosophe chinois Confucius, Kongfuzi (551 à 479 av. J.-C.). Sa philosophie morale et politique est à l'origine du confucianisme.
Mercredi 28 septembre 2011 - Fête hindoue : Navaratri / Durga Puja ( du 28 septembre au 7 octobre] ).
Navaratri / Durga Puja célèbre le Dieu Rama et la déesse Durga-Kali (la déesse aux 10 bras), qui symbolisent la victoire du bien sur le mal après leurs combats pendant 9 nuits contre les démons ; la fête se termine par Dassera le 7 octobre.
Jeudi 29 septembre et 30 septembre 2011 - Fête juive : Roch ha-Chanah, 1er et 2e jour
Nouvel An (1er Tishri) 5772. Cette fête de deux jours est un temps de réflexion pour la communauté et l’individu. Dieu juge les actes de l'année écoulée. C’est également un moment pour célébrer joyeusement la création.
Photo de Jean-Pierre Martin.

OCTOBRE 2011
Du 28 septembre au 7 octobre 2011 - Fête hindoue : Navaratri / Durga Puja.
Navaratri / Durga Puja célèbre le Dieu Rama et la déesse Durga-Kali (la déesse aux 10 bras), qui symbolisent la victoire du bien sur le mal après leurs combats contre les démons ; la fête se termine par Dassera le 7 octobre.
Dimanche 2 octobre 2011 - Journée ONU : Journée internationale de la non-violence .
En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a fait de cette journée l’occasion de diffuser le message de la non-violence notamment par des actions d’éducation et de sensibilisation. La résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence.
Samedi 8 octobre 2011 - Fête juive : Yom Kippour.
Jour des Expiations, la plus respectée des fêtes juives.
La période d'introspection commencée par les Juifs le jour de Roch Hachana (Nouvel An le 29 septembre) se termine avec le Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, marqué par un jeûne et un service religieux prolongé.
Mercredi 12 octobre 2011 - Fête bouddhiste : Kathina, date dépend selon les pays de la fin de la saison des pluies.
Fête theravada marquant la fin de la retraite monacale par le don aux moines d'une robe dite Kathina.
Jeudi 13 octobre 2011 - Fête juive : Soukkot , 13 et 14 octobre et jusqu'au 21 octobre.
Fête des Tentes, en souvenir des 40 ans de traversée du désert
Soukkot ou Fête des Tabernacles est une fête joyeuse qui célèbre l’abondante récolte de Dieu. En cette occasion, les Juifs prient pour avoir des récoltes abondantes dans la nouvelle année et aussi pour que la générosité de Dieu soit partagée avec toute l’humanité.
Jeudi 13 octobre, 1er jour de fête. Vendredi 14 octobre : 2e jour de fête.
Mercredi 19 octobre : procession de Hochaana Rabba.
Jeudi 20 octobre : Chemini Atsérèt : fête qui clôt le temps de Soukkot.
Vendredi 21 octobre 2011: Simhat Torah
Simchat Torah est le dernier jour de Soukkot ou Fête des Tentes, rappelant la fuite des Juifs de l’Égypte. C’est le jour où se termine la lecture annuelle de la Torah (le Pentateuque) pour la recommencer aussitôt. Cette lecture sera poursuivie chaque semaine et se terminera à Simhat Torah de l'année suivante. C'est une fête joyeuse autour des rouleaux de la Torah.
Jeudi 20 octobre 2011 - Fête bahá´íe : Naissance du Bab.
Anniversaire de la naissance (20 octobre 1819) du Bab, précurseur de Baha'u'llah à Shiraz en Iran.
Mercredi 26 octobre 2011 - Fête sikhe : Bandi Chor Divas, Jour de la libération du prisonnier.
Cette fête commémore la libération de prison du 6e gourou Sri Hargobind et son retour à la ville sainte d'Amristar.
Mercredi 26 octobre 2011 - Fête jaïne : Divali et Vira-Nirvana.
Fête indienne également célébrée par les jaïns, qui correspond aussi à l'accession au nirvana de Mahavira.
Mercredi 26 octobre 2011 - Fête hindoue : Diwali/Deepavali
Le Festival des lumières ou Diwali est célébré 21 jours après Dassera et marque le retour du dieu Rama à Ayodhya, la capitale, pour récupérer son royaume après quatorze années d'exil. Lors de cette fête, les demeures et les espaces publics sont illuminés.
Jeudi 27 octobre 2011 - Fête jaïne : Nouvel an jaïn 2538.
A cette occasion, les Jaïns se rassemblent et se souhaitent mutuellement une heureuse nouvelle année. Ils glorifient Gautam Swami et écoutent avec dévotion les neuf stotras (hymnes sacrés) et le rasa (poème épique)de Gautama Swami.
Dimanche 30 octobre 2011 - Fête chrétienne : Fête de la Réformation
(30 octobre 2011)
Célébrée le dernier dimanche d'octobre, la fête de la Réformation rappelle le geste de Martin Luther affichant, le 31 octobre 1517, quatre-vingt-quinze thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Celles-ci ont donné naissance par la suite au mouvement religieux de la Réforme dont l'Église luthérienne est issue.
Photo : Lac au Canada, de Jean-Pierre MARTIN.

NOVEMBRE 2011
Mardi 1er novembre 2011 - Fête chrétienne : Toussaint
La Toussaint est la fête de tous les saints connus et inconnus. Elle témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. C'est la fête de la vie éternelle, la fête du ciel.
Mercredi 2 novembre 2011 - Fête chrétienne : Fête des défunts.
Journée de commémoraison et journée de prière pour les morts.
Dimanche 6 novembre 2011 - Fête musulmane : Aïd al-Adha / Aïd el-kebir, date variable (1 à 2 jours) en fonction de l'observation de la lune.
Aïd Al Adha , Eïd El Kebir, ou fête du sacrifice est une importante célébration musulmane. Elle est appelée également fête du Mouton en raison du sacrifice pratiqué ce jour-là pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim. Elle symbolise la foi et l'obéissance à Allah. Elle constitue également le couronnement du pèlerinage de La Mecque.
Le tiers de la viande sacrifiée est distribuée aux pauvres, le reste est mangé en famille.
Jeudi 10 novembre 2011 - Fête sikhe : Naissance du Guru Nanak
Cette fête célèbre l'anniversaire de naissance du gourou Nanak (1469-1538), fondateur de la religion sikhe et le premier des dix gourous. Il était un poète accompli : 974 de ses cantiques se trouvent dans le livre sacré sikh, Guru Granth Sahib. On le lit durant les deux jours et nuits qui précèdent la fête. Le jour de la fête, ce livre est porté en procession.
Samedi 12 novembre 2011 - Fête bahá´ íe : Naissance de Bahá’u’lláh
Anniversaire de la naissance du fondateur de la foi baha'ie le 12 novembre 1817 à Téhéran.
Jeudi 17 novembre 2011 - Fête bouddhique : Lhabab [Sous réserve de confirmation officielle]
Fête tibétaine du retour du Bouddha du royaume célèste où il a enseigné.
Samedi 26 novembre 2011 - Fête islamique : 1er Muharram 1433, Date variable (1 à 2 jours) en fonction de l'observation de la lune
Mois sacré, Muharram ou Nouvel An de l'hégire commémore l'exode de Mohamed et de ses adeptes de La Mecque à Médine, en 622, pour établir la première communauté musulmane.
Le 1er Muharram est le 1er jour de l'année lunaire. Nouvel an musulman 1433.
Dimanche 27 novembre 2011 - Fête chrétienne : 1er dimanche de l'Avent
Préparation à la naissance de Jésus à Noël et attente de son retour.
Les quatre semaines précédant Noël sont connues sous le nom d'Avent. Elles représentent le début de l'année liturgique et célèbrent la révélation de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Dans les églises, un cierge spécial est allumé chaque dimanche précédant Noël.
Lundi 28 novembre 2011 - Fête bahá´ íe : Ascension d’Abdu’l-Bahá
Photo : Le temple du Lotus, à New Delhi. Cette maison d'adoration est représentée dans le cadre de la "campagne internationale du gouvernement indien mettant en évidence la diversité culturelle et les réalisations spécifiques de son pays."
"Le temple bahá’í est le premier endroit où les personnes appartenant à n’importe quelle foi ou religion peuvent aller pour méditer et prier."
DECEMBRE 2011
Samedi 3 décembre 2011 - Fête orthodoxe : Présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem.
Lundi 5 décembre 2011 - Commémoration musulmane : Achoura (date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune)
Achoura est le dixième jour du mois de Muharram. Il est marqué par un jeûne que le Prophète Mohamed a recommandé aux musulmans. Achoura est aussi le jour du martyre d'Hussein, fils d’Ali et petit-fils du Prophète, à la bataille de Kerbela en 61 de l’hégire ou en 680 de l'ère chrétienne. Les chiites commémorent sa mort en organisant des processions.
Les Sunnites rappellent Moïse sauvé des mains de Pharaon.
Dimanche 4 décembre 2011 - Fête chrétienne : Avent. 4 dimanches avant Noël : 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2011
Préparation à la naissance de Jésus à Noël et attente de son retour.
Les quatre semaines précédant Noël sont connues sous le nom d'Avent. Elles représentent le début de l'année liturgique et célèbrent la révélation de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Dans les églises, un cierge spécial est allumé chaque dimanche précédant Noël.
Jeudi 8 décembre 2011 - Fête bouddhique : Bodhi
Bodhi signifie Éveil. C'est la fête de l' Eveil de Bouddha sous l'arbre de l'illumination.
L'Eveil est l’objectif ultime de la vie d’un bouddhiste. Il tend à se libérer du cycle des renaissances et des passions, le samsara.
Jeudi 8 décembre 2011 - Fête chrétienne : Immaculée Conception de Marie
Fête catholique de l'Immaculée-Conception de Marie, conçue sans la marque du péché originel.
Dogme catholique défini par Pie IX en 1854, après sa célébration régulière depuis le XIIIe siècle.
Mercredi 21 décembre 2011 - Fête juive : Hanouccah (du 21 au 28 décembre 2011)
Hanouccah, ou Fête des lumières, commémore le miracle qui s'est produit lorsque le Temple de Jérusalem fut repris après sa profanation et purifié il y a plus de deux mille ans ( -165). Le peu d'huile qui restait pour allumer les lumières du Temple dura huit jours. Cette fête est marquée de cérémonies particulières à la maison et à la synagogue. Les festivités durent huit jours et ont pour symbole un chandelier à huit branches appelé hanoukia. Chaque jour, il est allumé une bougie supplémentaire.
Dimanche 25 décembre 2011 - Fête chrétienne : Noël (7 janvier pour le calendrier julien )
Grande fête célébrée dès le 24 au soir.
Noël commémore la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. C'est aussi l'annonce de son retour.
Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Ce nom même révèle son identité et sa mission, sauver les hommes et les conduire vers Dieu.
Jeudi 29 décembre 2011 - Fête zoroastrienne : Zartusht-no Diso (29 mai pour les parsis indiens ).
En Iran: commémoration de la mort de Zarathoustra.
Photo : Icône de la Nativité de Patmos.


SEPTEMBRE 2010
Mercredi 1er septembre 2010 - Fête sikhe : Guru Granth Sahib
Fête du Livre sacré des sikhs, elle commémore la reconnaissance officielle du Livre saint sikh l'Adi Granth. C'est le gourou Arjan Dev qui a constitué la première édition des textes sacrés sikhs et qui les a installés officiellement en 1604 de l'ère chrétienne dans le Temple d'or. Ce livre sacré des sikhs, nommé depuis 1708 Guru Granth Sahib, a été désigné plus tard par le dixième gourou Gobind Singh comme le maître spirituel des sikhs après sa mort.
Mercredi 1er septembre 2010 - Fête chrétienne : Début de l'année liturgique orthodoxe
Jeudi 2 septembre 2010 - Fête hindoue : Janmashtami / Krishna Jayanti
Fête de la naissance de Krishna. Selon les épopées hindoues, Krishna était la huitième incarnation du dieu Vishnou.
Dimanche 5 septembre 2010 - Fête jaïne : Paryushana-parva, du 5 au 12 septembre
Période la plus sacrée de l'année pour le groupe ascétique Shvetambara. Les adeptes se vouent intensément aux idéaux du jaïnisme par le jeûne, la vénération de Jina et la lecture publique de l'histoire de la vie de Mahâvira décrite dans le Kalpasutra. La fête dure huit jours et se termine au Samvatsari, le 12 septembre.
Lundi 6 septembre 2010 - Fête islamique : Lailat al-Qadr. Date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune.
Nuit du Destin, Laylat al Qadr est la nuit où le Coran, le livre sacré des musulmans, a été révélé au Prophète Mohamed lorsqu'il était en méditation dans la grotte de Hira à La Mecque. C'est une nuit bénie, une nuit de grande ferveur religieuse que les musulmans pieux passent à la mosquée en priant et en récitant le Coran, pour que Dieu leur accorde une bonne destinée.
Mercredi 8 septembre 2010 - Fête chrétienne : Nativité de la Vierge Marie. 21 septembre en calendrier julien.
Grande fête orthodoxe et catholique de la naissance de Marie, mère du Christ.
Jeudi 8 septembre 2010 - Fête juive : Roch Hachana, du 8 septembre au soir, au 10 septembre.
Nouvel An (1er Tishri) 5771. Cette fête de deux jours est un temps de réflexion pour la communauté et l’individu. Dieu juge les actes de l'année écoulée. C’est également un moment pour célébrer joyeusement la création.
Vendredi 10 septembre 2010 - Fête islamique : Aïd al-Fitr. Date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune.
Cette fête marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Une prière solennelle est célébrée dans les mosquées après le lever du soleil.
Jour de joie, de rencontre des frères, de tolérance, de piété, d'aumône et de pardon Ce jour-là, les gens revêtent des habits neufs, présentent leurs voeux aux membres de leur familleet donnent des cadeaux aux enfants.
Samedi 11 septembre 2010 - Fête hindoue : Ganesha Chaturthi.
Naissance du fils de Shiva, Ganesha, dieu du savoir, reconnaissable à sa tête d'éléphant. Il est invoqué au commencement de toute nouvelle entreprise.
Samedi 11 septembre 2010 - Fête jaïne : Samvatsari. Dernier jour de la période de Paryushana.
Le groupe jaïne Shvetambara observe le Samvatsari par l'introspection, la confession et la pénitence.
Mardi 14 septembre 2010 - Fête chrétienne : Exaltation de la croix. 27 septembre en calendrier julien.
Exaltation de la croix ou Croix glorieuse.
Jour de jeûne rigoureux chez les orthodoxes.
Samedi 18 septembre 2010 - Fête juive : Yom Kippour. Du 17 sept. au soir au 18 sept.
Jour des Expiations, la plus respectée des fêtes juives.
La période d'introspection commencée par les Juifs le jour de Roch Hachana (Nouvel An le 8 septembre) se termine avec le Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, marqué par un jeûne et un service religieux prolongé.
Mardi 21 septembre 2010 - Journée de l'ONU : Journée internationale de la paix.
Le 7 septembre 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 21 septembre, Journée internationale de la paix. Le but est d'offrir au monde entier l'occasion d'observer une journée de paix et de non-violence durant laquelle toutes les nations et tous les peuples sont invités à cesser les hostilités.
Mercredi 22 septembre 2010 - Fête chinoise : Chung Ch'iu.
Le Festival de la lune est une fête de la Chine ancienne. Elle coïncide avec la pleine lune de la huitième lune et avec la saison des pluies. C'est aussi une occasion de rendre grâce pour l'abondance des récoltes.
Jeudi 23 septembre 2010 - Fête shintô : Shubun no hi / Higan.
Fête japonaise de l'équinoxe: les bouddhistes visitent les temples et les cimetières.
Jeudi 23 septembre 2010 - Fête jaïne : Ksamavani .
Jour du pardon universel dans la tradition religieuse jaïne.
Jeudi 23 septembre 2010 - Fête juive : Soukkot . Du 22 sept. au soir au 1er octobre.
Fête des Tentes, souvenir des 40 ans de traversée du désert
Jeudi 23 septembre, 1er jour de fête.
Mercredi 24 septembre : procession de Hochaana Rabba.
Jeudi 30 septembre : Chemini Atsérèt : fête qui clot le temps de Soukkot. Le dernier chapitre de la Torah est lu ce jour là, avant la reprise du cycle de lecture le 1er octobre, lors de Sim'hat Torah
Soukkot ou Fête des Tabernacles est une fête joyeuse qui célèbre l’abondante récolte de Dieu. En cette occasion, les Juifs prient pour avoir des récoltes abondantes dans la nouvelle année et aussi pour que la générosité de Dieu soit partagée avec toute l’humanité.
Mardi 28 septembre 2010 - Fête chinoise :Naissance de Confucius
Cette fête célèbre l'anniversaire de naissance du grand penseur et philosophe chinois Confucius, Kongfuzi (551 à 479 av. J.-C.). Sa philosophie morale et politique est à l'origine du confucianisme.
Photo de Bernard Reber : Fontaine du jardin public interreligieux de Saverne.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
.


Contribution
sur "L'esprit de Ramadhan"
de Kamel MEZITI
Cliquez ICI.
Docteur en Histoire (Paris-Sorbonne)
Directeur du culte musulman de la Marine
Membre du Groupe de Recherche Islamo-Chrétien (I.C.P. Paris)
Membre de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix


JANVIER 2010
Vendredi 1er janvier 2010 - Fête shintôiste : Ganjitsu (du 1er au 3 janvier) .
Nouvel An japonais, fait de décorations, de réjouissances et de visites aux temples shintô.
Depuis 1873, le Nouvel An japonais est fêté selon le calendrier grégorien. Les Japonais offrent des prières ainsi que des vœux de santé et de prospérité. Ils fréquentent les temples, portent leurs plus beaux vêtements et nettoient leur demeure. Ils offrent des étrennes et la fête s’étend sur plusieurs jours.
Dimanche 3 janvier 2010 - Fête catholique : Epiphanie.
Cette fête, appelée aussi jour des Rois, célèbre l'arrivée des Rois mages à Bethléem pour adorer l'Enfant Jésus. Plus largement, elle célèbre la manifestation de Dieu aux païens.
Mardi 5 janvier 2010 - Fête sikhe : Naissance de Guru Gobind.
Le gourou Gobind Singh Ji (1666-1708) est le dixième maître spirituel sikh. Il a fondé la confrérie des Purs (Khalsa) dont les membres portent cinq attributs (kesh, kachera, kirpan, kangha et kara). Il a transmis sa succession spirituelle dans le Guru Granth Sahib, le livre sacré des sikhs.
Mercredi 6 janvier 2010 - Fête chrétienne : Théophanie (orthodoxe) [19 janvier en calendrier julien]
En Orient: révélation de Jésus comme fils de Dieu lors de son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain et, plus généralement, la manifestation publique du Verbe incarné au monde.
Jeudi 7 janvier 2010 - Fête chrétienne orthodoxe : Noël en calendrier julien.
Fête de la Nativité du Christ.
Jeudi 14 janvier 2010 - Fête hindoue : Pongal ou Makara Samkranti.
Solstice d'hiver et Nouvel An solaire; vénération du soleil.
Le Pongal, appelé aussi Makara Samkranti dans certains endroits de l'Inde, est une fête des moissons et d'action de grâce. Elle souligne l’arrivée de la nouvelle récolte et correspond au premier jour du mois thai du calendrier tamoul. La fête est l’occasion de décorer les maisons, de participer à des concours de cerfs-volants et de partager des repas en famille et entre amis.
Lundi 18 au 25 janvier 2010 - Fête chrétienne : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Prière oecuménique sur l'initiative de l'abbé Couturier en 1935.
Mercredi 20 janvier 2010 - Fête hindoue : Vasanta Panchami / Sarasvati Puja.
Fête de Sarasvati, déesse de l'éducation et des arts.
Samedi 30 janvier 2010 - Fête juive : Thu Bichevat, nouvel an des arbres.
Tu Bishevat, qui est le 15e jour du mois de shevat, marque le premier jour de l'an pour les arbres. On célèbre cette fête en plantant des arbres.
Photo : Aiguilles de glace, de Chrisalyon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FEVRIER 2010
Mardi 2 février 2010 - Fête chrétienne : Présentation au Temple, le 15 janvier en calendrier julien.
Fête orthodoxe et catholique de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalen et de la purification de la Vierge.
Pour les orthodoxes, cette fête s'appelle aussi Sainte Rencontre.
Mardi 9 février 2010 - Fête catholique orientale : Saint Marron.
Fête en l'honneur du fondateur de la religion maronite qui est l'une des branches des Églises orientales catholiques.
Vendredi 12 février 2010- Fête hindoue : Mahashivaratri.
Fête du dieu Shiva, l'une des principales divinités auxquelles les hindous adressent leur dévotion.
La danse cosmique de ce dieu crée, protège, détruit et recrée le monde. Les fidèles jeûnent durant la journée et, la nuit, ils veillent dans les temples dédiés au dieu.
Dimanche 14 février 2010 - Fête bouddhique : Losar.
Nouvel An tibétain. Il coïncide avec le premier jour de la nouvelle année lunaire. C'est l'une des deux fêtes les plus importantes au Tibet. À cette occasion, on organise des festivités pendant une quinzaine de jours.
Dimanche 14 février 2010 - Nouvel an : Chun Jie, fête chinoise, Têt, fête vietnamienne.
Fête en l'honneur des morts, annonciatrice du printemps.
En 2010, l'année chinoise est placée sous le signe du Tigre.
Lundi 15 février 2010 - Fête orthodoxe. : Le Grand Jeûne.
Pour les Églises orientales, ce Grand Carême est observé pendant les six dernières semaines de la période de dix semaines menant à la Semaine sainte et à la Pascha ou Pâques orthodoxe, .
Lundi 15 février 2010 - Fête bouddhique : Parinirvana.
Fête mahayana du départ du Bouddha pour le nirvana complet.
Mercredi 17 février 2010 - Fête chrétienne : Mercredi des cendres.
Pour les catholiques, mercredi des Cendres, jour de repentir, de jeûne et d'abstinence. Marque le début du Carême, qui dure 40 jours (sans les dimanches) et s'achève à Pâques (4 avril). Son nom vient de la cérémonie qui consiste à tracer une croix avec des cendres sur le front des fidèles. C'est un temps de prière et de partage. D'autres fidèles de religions chrétiennes observent ce temps de jeûne.
Dimanche 21 février 2010 - Fête chrétienne : 1er dimanche de Carême.
Pour les Orthodoxes : Dimanche de l'Orthodoxie.
Pour les Catholiques : 1er dimanche des 40 jours de Carême.
Vendredi 26 février 2010 - Fête musulmane : Mawlid an Nabi.
Mawlid al-Nabi. marque l’anniversaire de naissance du Prophète Mohamed le 20 août 570 de l’ère Chrétienne. Cette fête a été créée plusieurs siècles après sa mort et elle a été officialisée en 691 de l'hégire ou en 1292 de l'ère chrétienne. Des cérémonies commémoratives ont lieu dans les mosquées. Elles rappellent la vie et les enseignements du Prophète. C'est une occasion de réjouissances intenses particulièrement pour les enfants. On allume des bougies et on prépare des gâteaux et des plats spéciaux.
Dimanche 28 février 2010 - Fête hindoue : Holi.
Ce carnaval du printemps est la fête la plus gaie de toutes les fêtes hindoues. Des gens de tous les âges s’amusent à se lancer de la poudre et de l'eau colorée. On y échange des vœux et des sucreries.
Dimanche 28 février 2010 - Fête bouddhique : Magha Puja
Le Magha Puja commémore le Grand Rassemblement de Bouddha et de ses 1250 disciples durant lequel il leur a fait sa prédiction et leur a donné un aperçu de son enseignement. Dans la tradition bouddhique thaïlandaise, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge, la fête de Magha Puja est celle de la Toussaint ou jour du Dharma. Elle rappelle la règle des moines.
Dimanche 28 février 2010 - Fête juive : Pourim.
Célébrée à la fin de l’hiver, Pourim ou Fête des sorts commémore le salut de la communauté juive tel qu’il est décrit dans le Livre d’Esther . fête joyeuse inspirée par l'atmosphère de jubilation du peuple d'Israël au moment de l'exaucement de la prière d'Esther pour son père Modekhaï et de la victoire sur Haman, l'ennemi du peuple de Dieu.
Photo de Jean-Pierre MARTIN.
-----------------------------------------------------------------------------------------

MARS 2010
Mardi 2 mars 2010 - Fête bahá´ íe : Jeûne du mois de `Ala, du 2 au 20 mars.
Jeûne du dernier mois baha'i.
Mercredi 3 mars 2010 - Fête shintoïste : Hina Matsuri
Hina Matsuri ou le Festival des fleurs s’appelle aussi la Fête des petites filles ou Fête des poupées.
Dimanche 14 mars 2010 - Fête sikhe : Nouvel An sikh 541
Le calendrier Nanakshahi, nommé en l’honneur du premier gourou Nanak, amorcera sa 541e année le 14 mars 2010.
Samedi 20 mars 2010 - Fête shintô : Shubun no hi / Higan (équinoxe)
Fête du printemps, visites des temples et des cimetières.
Dimanche 21 mars 2010 - Fête bahá´ íe : No Rouz.
Nouvel An baha'i 166, sous le signe de la joie; à l'équinoxe de printemps, symbolise le renouveau spirituel et la croissance.
Dimanche 21 mars 2010 - Fête zoroastrienne : Now Ruz.
Nouvel An mazdéen 1379. Cette fête du Nouvel An, célébrée par les Iraniens et la diaspora zoroastrienne, date de l’antiquité perse (600 av. J.-C). Elle est associée à l’équinoxe du printemps et au renouveau de la nature.
Lundi 22 mars 2010 - Fête hindoue : Nava-Varsha / Sithrabahnu-Varsha.
Nouvel An solaire (1932 de l'ère saka), souvent célébré le 13 ou 14 avril.
Mercredi 24 mars 2010 - Fête hindoue : Rama Navami
Rama Navami, ou Naissance de Rama, célèbre l'anniversaire de Rama, la septième incarnation du dieu Vishnou. Pendant les huit jours précédant cette fête, les hindous lisent le Ramaya, une épopée hindoue qui raconte l'histoire de Rama.
Jeudi 25 mars 2010 - Fête chrétienne : Annonciation (7 avril, en calendrier julien)
Fête catholique et orthodoxe de l'annonce faite à Marie de la naissance de Jésus.
Vendredi 26 mars 2010 - Fête zoroastrienne : Khordad Sal (27 août pour les parsis indiens).
En Iran, les mazdéens fêtent la naissance de Zarathoustra.
Dimanche 28 mars 2010 - Fête chrétienne : Dimanche des Rameaux.
Fête l'entrée de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes.
C'est le début de la semaine sainte, du 28 mars au 4 avril (fête de Pâques).
Les dates sont les mêmes, cette année, en calendrier julien et grégorien.
Dimanche 28 mars 2010 - Fête jaïne : Mahavira Jayanti
Mahavir Javanti est un festival qui marque l’anniversaire du Vardhamana Mahavira, le vingt- quatrième tirthankara, né en -599.
Mardi 30 mars 2010 - Fête juive : Pessah (30 et 31 mars)
Pâque juive, libération des enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte.
La Pâque juive commémore l’exode des Hébreux de l’Égypte et leur libération miraculeuse de l’esclavage. Cette fête, célébrant la liberté, a une durée de huit jours.
On consomme des pains azymes c'est à dire sans levain, pour rappeler que les hébreux n'eurent pas le temps de faire lever le pain avant leur départ.
Photo de Bernard Reber.
------------------------------------------------------------------------------

AVRIL 2010
Du mardi 30 mars au mardi 6 avril 2010 - Fête juive : Pessah.
La Pâque juive commémore l’exode des Hébreux de l’Égypte et leur libération miraculeuse de l’esclavage. Cette fête, célébrant la liberté, a une durée de huit jours.
On consomme des pains azymes c'est à dire sans levain, pour rappeler que les hébreux n'eurent pas le temps de faire lever le pain avant leur départ.
Jeudi 1er avril 2010 - Fête chrétienne : Jeudi Saint.
Commémoration de la Cène, le dernier repas de Jésus pris avec ses disciples à l’occasion de la Pâque juive. l'Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis les fidèles s'unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint- Sacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit.
Le Vendredi saint commémore la mort de Jésus sur la croix. Les chrétiens sont appelés au jeûne.
L'office de la nuit du samedi saint s'appelle la vigile pascale. C'est le prélude à la fête de Pâques. À cette occasion, le cierge pascal, symbolisant le Christ ressuscité, est allumé dans les églises à partir du feu nouveau.
Dimanche 4 avril 2010 - Fête chrétienne : Pâques ou Pascha pour les orthodoxes, en 2010 la date est la même pour tous les chrétiens.
Cette fête commémore la résurrection de Jésus, espérance de vie éternelle pour tous les croyants.
Dans l’Église orthodoxe, l'année religieuse commence avec Pascha.
Lundi 5 avril 2010 - Fête chinoise : Ch'ing Ming.
Festival de la lumière et fête de la commémoration des ancêtres.. Visite et nettoyage des tombes familiales, dépots d'offrandes.
Mercredi 7 avril 2010 - Fête chrétienne : Annonciation en calendrier julien.
Fête catholique et orthodoxe de l'annonce faite à Marie de la naissance de Jésus.
Jeudi 8 avril 2010 - Fête bouddhiste : Naissance de Bouddha.
Fête de tradition mahayana qui commémore la naissance de Bouddha. Cette tradition est pratiquée en Chine, au Tibet, au Népal, au Vietnam, en Corée et au Japon.
Jeudi 8 avril 2010 - Fête shintô : Hanamatsuri.
Festival des fleurs
Dimanche 11 avril 2010 - Commémoration juive : Yom Hashoah.
Commémoration de la Shoah et rappel de la mort de millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Yom Hashoah correspond à la date anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie.
Mardi 13 avril 2010 - Fête sikhe : Vaisakhi.
Fête des moissons qui annonce le retour du printemps, marque aussi pour les vingt-cinq millions de Sikhs répartis dans le monde, l’anniversaire de la révélation de l’Ordre des Khalsa (les Purs, c’est-à-dire celles et ceux qui vouent leur existence à la purification spirituelle et à la lutte contre l’ego) qui eût lieu en 1699.
Mercredi 14 avril 2010 - Fête bouddhiste : Nouvel An theravada 2554.
Mercredi 14 avril 2010 - Fête hindoue : Nava-Varsha.
Début du Nouvel An solaire. C'est aussi la fête de la célébration des moissons. Pour l’occasion, les maisons sont décorées de fleurs, des cortèges arpentent les rues et des friandises sont distribuées.
Samedi 17 avril 2010 - Fête jaïne : Akshaya-tritiya.
Fête de l'aumône au 1er Tîrtankara.
Mercredi 21 avril 2010 - Fête bahá´ íe : Ridvan (du 21 avril au 2 mai)
Proclamation en avril 1863 de sa mission par Baha'u'llah.
------------------------------------------------------------------------------------------------

MAI 2010
Dimanche 2 mai 2010 - Fête bahá´ íe : Ridvan ( 12e jour)
Proclamation en avril 1863 de sa mission par Baha'u'llah.
Jeudi 13 mai 2010 - Fête chrétienne : Ascension (Comme pour la date de Pâques, les fêtes qui s'y rattachent coïncident cette année chez les catholiques et les orthodoxes.)
L’Ascension célèbre l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, c’est-à-dire la fin de Sa présence visible sur terre et Son entrée dans le royaume de Dieu.
Dimanche 16 mai 2010 - Fête jaïne : Akshaya-tritiya.
Akshaya-tritiya célèbre le jour où le premier tirthankara, Rishabha, fondateur traditionnel du jaïnisme, mit fin à son premier jeûne.
Mercredi 19 mai 2010 et jeudi 20 - Fête juive : Chavouot [1er et 2e jour]
Fête des Semaines, elle est célébrée sept semaines, à partir du 2e soir de Pessah.
Shavouot est également appelée : "époque du don de la Torah."
Le jour de Shavouot sont lus les dix commandements qui ont été donnés au pied du mont Sinaï, non seulement aux hébreux, mais à toute l'humanité, qui évoque l'universalité des 10 commandements.
Dimanche 23 mai 2010 - Fête bahá´ íe : Déclaration du Bab.
Anniversaire de la déclaration du Báb, qui en 1844 annonça qu’Il était un nouveau Messager de Dieu, dont la mission sur terre était d’annoncer une nouvelle ère pour l’humanité, ainsi que de préparer l’avènement de Bahá’u’lláh, le messager universel de Dieu attendu par les disciples toutes les religions.
Dimanche 23 mai 2010 - Fête chrétienne : Pentecôte (Comme pour la date de Pâques, les fêtes qui s'y rattachent coïncident cette année chez les catholiques et les orthodoxes.)
Célébrée 50 jours après Pâques, c'est la fête du Don de l'Esprit de Dieu aux apôtres et à l'Église, suivie du dimanche de la Trinité le 30 mai.
Orthodoxie: fête de la Trinité suivie, le lundi 24 mai, du don de l'Esprit à l'Eglise.
Jeudi 27 mai 2010 - Fête bouddhique : Sangyepa / Saga dawa.
Au Tibet, grande fête de la naissance du Bouddha, de son éveil et de son extinction.
Fête bouddhique : Wesak .
La fête commémore la naissance, l’éveil et la mort de Siddhartha Gautama dit Bouddha (566-486 av. J.-C.). Elle a lieu le jour de la pleine lune de mai. Selon la tradition bouddhique, les trois événements majeurs de sa vie ont eu lieu le même jour, signe de sa destinée hors du commun.
Samedi 29 mai 2010 - Fête bahá´ íe : Ascension de Baha'u'llah.
Mort de Baha'u'llah, le 29 mai 1892 à Bahji près d'Akka en Israël.
Les bahá’ís reconnaissent Bahá’u’lláh comme étant la Manifestation de Dieu pour cette époque.
L’Ascension de Bahá’u’lláh est l’un des neuf jours saints du calendrier annuel bahá’í
Samedi 29 mai 2010 - Fête zoroastrienne : Zartusht-no Diso (29 décembre pour les mazdéens iraniens)
Les parsis indiens commémorent la mort de Zarathoustra.
Dimanche 30 mai 2010 - Fête chrétienne : Fête de la Trinité
Fête religieuse chrétienne
La Trinité est fêtée par les chrétiens le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire le huitième dimanche après Pâques. Ce jour là est fêtée la réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans l’unité d’amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit. (cef.fr)
Dimanche 30 mai 2010 - Fête chrétienne orthodoxe : Dimanche de tous les Saints.
En l'honneur des saints, des martyrs et des docteurs de l'Église.
Les Saints sont ceux qui ont répondu à l’amour par l’amour, ceux qui réalisent que si quelqu’un peut mourir pour eux, la seule réponse de leur reconnaissance est de devenir tels que celui-ci n’est pas mort pour rien.
Photo : Denise T.
.

JUIN 2010
Dimanche 6 juin 2010 - Fête catholique : Fête du Saint sacrement du corps et du sang du Christ".
Cette fête commémore l'institution du sacrement de l'eucharistie. Célébration du Dieu d'amour qui se révèle en se donnant aux hommes comme nourriture de vie éternelle. Les chrétiens sont appelés à servir tous leurs frères humains, sur toute la terre.
Vendredi 11 juin 2010 - Fête catholique : Le Sacré Coeur de Jésus.
Fête de l'amour de Jésus, doux et humble de coeur.
Mercredi 16 juin 2010 - Fête chinoise :Tuan Yang Chien
Duan Wu ou Festival des bateaux-dragon commémore le suicide de l'homme politique et grand poète Qu Yuan (295 av. J.-C.) qui voulut ainsi protester contre la corruption politique du gouvernement. De là vient la coutume de manger des gâteaux de riz et de faire des courses de bateaux-dragons ce jour-là.
Mercredi 16 juin 2010 - Fête sikhe : Martyre du 5e gourou Arjan Dev
Arjan fut le cinquième gourou et le premier martyr sikh. Il rassembla les hymnes pour constituer le livre sacré des sikhs, le Guru Granth Sahib.
Samedi 26 juin 2010 - Fête bouddhique : Poson [sous réserve de confirmation officielle]
Fête de l'arrivée du bouddhisme au Sri Lanka.
Mardi 29 juin 2010 - Célébration juive : Jeûne du 17 Tamouz.
Commémore le début de la destruction du 1er et du 2ème temple de Jérusalem. C'est le début d'une période de 3 semaines de deuil, jusqu'au 9 Av ( 20 juillet 2010).
Photo : Jean-Pierre Martin.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
.

JUILLET 2010
Vendredi 9 juillet 2010 - Fête bahá´ íe : Martyre du Bab.
Commémoration par des lectures et des prières de l'exécution du Bab à Tabriz en Iran le 9 juillet 1850.
Vendredi 9 juillet 2010 - Fête islamique : Lailat al Miraj (date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune).
Fête du voyage du Prophète de La Mecque à Jérusalem, suivi de son ascension (Al-Miraj) vers le trône divin, puis de son retour à La Mecque dans la même nuit.
Mardi 13 au jeudi 15 juillet 2010 - Fête shintô : O-bon.
Il est dit que vers le 13 du mois, les esprits des ancêtres reviennent chez eux pour trois jours. Ils sont accueillis avec des danses dans les maisons et les villages pendant trois jours. Les pierres tombales sont nettoyées et une nourriture spéciale est laissée en offrande.
Jeudi 15 juillet 2010 - Fête bouddhique : Chökhor.
Dans la tradition bouddhiste tibétaine, cette fête commémore le premier sermon de Bouddha, avec de grandes processions.
Mardi 20 juillet 2010 - Fête juive - Jeûne du 9 Av.
Au terme de trois semaines d'évocation des catastrophes de l'histoire juive, jour de jeûne et de deuil afin de souligner la destruction du saint Temple de Jérusalem.
Lundi 26 juillet 2010 - Fête bouddhique : Asala.
Fête theravada du 1er sermon du Bouddha dans un parc près de Bénarès et début de trois mois de retraite monacale à la mousson.>
Vendredi 3 juillet 2010 - Fête shintoïste : Oh-harai-taisai.
Oh-harai-taisai ou Cérémonie de la grande purification a lieu depuis les temps anciens pour que les adeptes soient purifiés des fautes et des infractions commises pendant la première moitié de l'année lunaire. Dans le cadre des cérémonies, les fidèles japonais marchent à travers un grand anneau d’herbes et de roseaux, placé à l'entrée des sanctuaires, qui symbolise la purification.
Photo : Cap Bon, de H. de La Salle
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
.

AOÛT 2010
Vendredi 6 août 2010 - Fête chrétienne : Transfiguration.
Apparition du Christ transfiguré, dans l'éclat de sa divinité, à ses trois disciples Pierre, Jacques et Jean.
Très grande fête en Orient. Fêtée le 19 août dans le calendrier julien.
Mercredi 11 août 2010 - Fête islamique : Mois de Ramadan, du 12 août au 21 septembre; date variable de 1 à 2 jours en fonction de l'observation de la lune.
Les musulmans vivent une période de jeûne, de l'aube jusqu'au crépuscule. Temps de recueillement, de maîtrise de soi et de partage, il est sacré pour les musulmans parce que c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé au Prophète Mohamed. Le jeûne du ramadan est le quatrième pilier de l'islam.
Dimanche 15 août 2010 - Fête chrétienne : Assomption (catholique) / Dormition (orthodoxe) , le 28 août pour le calendrier julien.
Pour les catholiques: Célébration de la montée au ciel de l'âme et du corps de la Vierge Marie.
Pour les orthodoxes: mystère de son endormissement. Grande fête précédée par un jeûne de deux semaines. La croyance est que le corps de Marie n'a pas connu la corruption qui suit la mort . Marie ressuscitée a été transportée au ciel par les anges
Dimanche 22 août 2010 - Fête zoroastrienne : Now Rouz.
Nouvel An mazdéen 1379 pour les parsis indiens.
Mardi 24 août 2010 - Fête chinoise : Chung Yüan
Festival des ancêtres ou "esprits affamés" pour qui l'on confectionne des simulacres de papier.
Les esprits qui ne peuvent trouver la paix se voient offrir des repas réconfortants et des cérémonies pour leur délivrance.
Mardi 24 août 2010 - Fête hindoue : Raksha Bandhan.
Raksha Bandhan, ou Festival des frères et sœurs, est un festival qui célèbre l'amour entre frères et sœurs. Il est symbolisé par un bracelet tissé, appelé « rakhi », que chaque jeune fille, mariée ou non, offre à son frère.
Vendredi 27 août 2010 - Fête zoroastrienne : Khordad Sal.
Fête de la naissance de Zarathoustra chez les parsis indiens.
Photo de Bernard Reber : "Jardin public interreligieux de Saverne, témoignage de la volonté de vivre ensemble des communautés juive, chrétiennes, musulmanes."

SEPTEMBRE 2010
Mercredi 1er septembre 2010 - Fête sikhe : Guru Granth Sahib
Fête du Livre sacré des sikhs, elle commémore la reconnaissance officielle du Livre saint sikh l'Adi Granth. C'est le gourou Arjan Dev qui a constitué la première édition des textes sacrés sikhs et qui les a installés officiellement en 1604 de l'ère chrétienne dans le Temple d'or. Ce livre sacré des sikhs, nommé depuis 1708 Guru Granth Sahib, a été désigné plus tard par le dixième gourou Gobind Singh comme le maître spirituel des sikhs après sa mort.
Mercredi 1er septembre 2010 - Fête chrétienne : Début de l'année liturgique orthodoxe
Jeudi 2 septembre 2010 - Fête hindoue : Janmashtami / Krishna Jayanti
Fête de la naissance de Krishna. Selon les épopées hindoues, Krishna était la huitième incarnation du dieu Vishnou.
Dimanche 5 septembre 2010 - Fête jaïne : Paryushana-parva, du 5 au 12 septembre
Période la plus sacrée de l'année pour le groupe ascétique Shvetambara. Les adeptes se vouent intensément aux idéaux du jaïnisme par le jeûne, la vénération de Jina et la lecture publique de l'histoire de la vie de Mahâvira décrite dans le Kalpasutra. La fête dure huit jours et se termine au Samvatsari, le 12 septembre.
Lundi 6 septembre 2010 - Fête islamique : Lailat al-Qadr. Date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune.
Nuit du Destin, Laylat al Qadr est la nuit où le Coran, le livre sacré des musulmans, a été révélé au Prophète Mohamed lorsqu'il était en méditation dans la grotte de Hira à La Mecque. C'est une nuit bénie, une nuit de grande ferveur religieuse que les musulmans pieux passent à la mosquée en priant et en récitant le Coran, pour que Dieu leur accorde une bonne destinée.
Mercredi 8 septembre 2010 - Fête chrétienne : Nativité de la Vierge Marie. 21 septembre en calendrier julien.
Grande fête orthodoxe et catholique de la naissance de Marie, mère du Christ.
Jeudi 8 septembre 2010 - Fête juive : Roch Hachana, du 8 septembre au soir, au 10 septembre.
Nouvel An (1er Tishri) 5771. Cette fête de deux jours est un temps de réflexion pour la communauté et l’individu. Dieu juge les actes de l'année écoulée. C’est également un moment pour célébrer joyeusement la création.
Vendredi 10 septembre 2010 - Fête islamique : Aïd al-Fitr. Date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune.
Cette fête marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Une prière solennelle est célébrée dans les mosquées après le lever du soleil.
Jour de joie, de rencontre des frères, de tolérance, de piété, d'aumône et de pardon Ce jour-là, les gens revêtent des habits neufs, présentent leurs voeux aux membres de leur familleet donnent des cadeaux aux enfants.
Samedi 11 septembre 2010 - Fête hindoue : Ganesha Chaturthi.
Naissance du fils de Shiva, Ganesha, dieu du savoir, reconnaissable à sa tête d'éléphant. Il est invoqué au commencement de toute nouvelle entreprise.
Samedi 11 septembre 2010 - Fête jaïne : Samvatsari. Dernier jour de la période de Paryushana.
Le groupe jaïne Shvetambara observe le Samvatsari par l'introspection, la confession et la pénitence.
Mardi 14 septembre 2010 - Fête chrétienne : Exaltation de la croix. 27 septembre en calendrier julien.
Exaltation de la croix ou Croix glorieuse.
Jour de jeûne rigoureux chez les orthodoxes.
Samedi 18 septembre 2010 - Fête juive : Yom Kippour. Du 17 sept. au soir au 18 sept.
Jour des Expiations, la plus respectée des fêtes juives.
La période d'introspection commencée par les Juifs le jour de Roch Hachana (Nouvel An le 8 septembre) se termine avec le Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, marqué par un jeûne et un service religieux prolongé.
Mardi 21 septembre 2010 - Journée de l'ONU : Journée internationale de la paix.
Le 7 septembre 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 21 septembre, Journée internationale de la paix. Le but est d'offrir au monde entier l'occasion d'observer une journée de paix et de non-violence durant laquelle toutes les nations et tous les peuples sont invités à cesser les hostilités.
Mercredi 22 septembre 2010 - Fête chinoise : Chung Ch'iu.
Le Festival de la lune est une fête de la Chine ancienne. Elle coïncide avec la pleine lune de la huitième lune et avec la saison des pluies. C'est aussi une occasion de rendre grâce pour l'abondance des récoltes.
Jeudi 23 septembre 2010 - Fête shintô : Shubun no hi / Higan.
Fête japonaise de l'équinoxe: les bouddhistes visitent les temples et les cimetières.
Jeudi 23 septembre 2010 - Fête jaïne : Ksamavani .
Jour du pardon universel dans la tradition religieuse jaïne.
Jeudi 23 septembre 2010 - Fête juive : Soukkot . Du 22 sept. au soir au 1er octobre.
Fête des Tentes, souvenir des 40 ans de traversée du désert
Jeudi 23 septembre, 1er jour de fête.
Mercredi 24 septembre : procession de Hochaana Rabba.
Jeudi 30 septembre : Chemini Atsérèt : fête qui clot le temps de Soukkot. Le dernier chapitre de la Torah est lu ce jour là, avant la reprise du cycle de lecture le 1er octobre, lors de Sim'hat Torah
Soukkot ou Fête des Tabernacles est une fête joyeuse qui célèbre l’abondante récolte de Dieu. En cette occasion, les Juifs prient pour avoir des récoltes abondantes dans la nouvelle année et aussi pour que la générosité de Dieu soit partagée avec toute l’humanité.
Mardi 28 septembre 2010 - Fête chinoise :Naissance de Confucius
Cette fête célèbre l'anniversaire de naissance du grand penseur et philosophe chinois Confucius, Kongfuzi (551 à 479 av. J.-C.). Sa philosophie morale et politique est à l'origine du confucianisme.
Photo de Bernard Reber : Fontaine du jardin public interreligieux de Saverne.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
.

OCTOBRE 2010
Vendredi 1er octobre 2010 - Fête juive : Simhat Torah.
Simchat Torah est le dernier jour de Soukkot ou Fête des Tentes, rappelant la fuite des Juifs de l’Égypte. C’est le jour où se termine la lecture annuelle de la Torah (le Pentateuque) pour la recommencer aussitôt. Cette lecture sera poursuivie chaque semaine et se terminera à Simhat Torah de l'année suivante. C'est une fête joyeuse autour des rouleaux de la Torah.
Samedi 2 octobre 2010 Journée internationale de la non-violence.
En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a fait de cette journée l’occasion de diffuser le message de la non-violence notamment par des actions d’éducation et de sensibilisation. La résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence.
Vendredi 8 octobre 2010 - Fête hindoue : Navaratri / Durga Puja , du 8 au 17 octobre.
Navaratri / Durga Puja célèbre le Dieu Rama et la déesse Durga-Kali (la déesse aux 10 bras), qui symbolisent la victoire du bien sur le mal après leurs combats contre les démons ; la fête se termine par Dassera le 17 octobre.
Mercredi 20 octobre 2010 - Fête bahaie : Naissance du Bab.
Anniversaire de la naissance (20 octobre 1819) du Bab, précurseur de Baha'u'llah à Shiraz en Iran.
Vendredi 23 octobre 2010 - Fête bouddhique : Kathina , Date variable selon les pays.
Fête marquant la fin de la retraite monacale, par le don aux moines d'une robe dite Kathina.
Vendredi 29 octobre 2010 - Fête bouddhique : Lhabab .
Retour du Bouddha du Royaume céleste : Assayuja (Théravâda) et Lhabab Duchen (Mahayana/Tibétain)
Samedi 30 octobre 2010 - Fête de la Réformation
Célébrée le dernier dimanche d'octobre, la fête de la Réformation rappelle le geste de Martin Luther affichant, le 31 octobre 1517, quatre-vingt-quinze thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Celles-ci ont donné naissance par la suite au mouvement religieux de la Réforme dont l'Église luthérienne est issue.
Photo de Jean-Pierre Martin : Couleurs au Canada.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
.

NOVEMBRE 2010
Lundi 1er novembre 2010 - Fête chrétienne : Toussaint.
La Toussaint est la fête de tous les saints connus et inconnus. Elle témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. C'est la fête de la vie éternelle, la fête du ciel.
Mardi 2 novembre 2010 - Fête chrétienne : Journée de la commémoration des défunts.
Journée de commémoraison et journée de prière pour les morts.
Vendredi 5 novembre 2010 - Fête sikhe : Jour de la libération du prisonnier.
Cette fête commémore la libération de prison du 6e gourou Sri Hargobind et son retour à la ville sainte d'Amristar. ( voir au 21 novembre).
Vendredi 5 novembre 2010 - Fête hindoue : Divali / Deepavali [3 à 5 jours]
Fête de la lumière et de la déesse de la prospérité Lakshmi.
Vendredi 5 novembre 2010 - Fête jaïne : Divali et Vira-Nirvana.
Au VIe siècle avant l'ère chrétienne, le vingt-quatrième prophète, Tirthankara, atteint le nirvana et est libéré du cycle des naissances (moksha).
Samedi 6 novembre 2010 - Fête jaïne : Nouvel an.
Nouvel An jaïn 2537
Samedi 6 novembre 2010 - Fête hindoue : nouvel an 2067 de l'ère samvat .
Vendredi 12 novembre 2010 - Fête bahá´íe : Naissance de Baha'u'llah.
Naissance de Bahá’u’lláh Fondateur de la religion bahaïe, né en 1817 à Nur en Perse.
Lundi 15 novembre 2010 - Fête orthodoxe : Début du carême de Noël
Temps de 40 jours de jeûne et de conversion, en préparation à la fête de Noël.
Carême de Noël
Lundi 15 novembre 2010 - Fête musulmane : Jour de Arafat, date prévisionnelle.
Jour important de l'année, pendant le grand pélerinage. C'est au mont Arafat que le Prophète Mohamed a prononcé son dernier discours lors de son pèlerinage dit d'adieu (Hadjat Al-Wadae). Il a rappelé à ses fidèles les principes fondamentaux de l'islam et leur a fait ses dernières recommandations.
Mercredi 17 novembre 2010 - Fête musulmane : Aïd al Adha , date prévisionnelle, selon l'observation de la lune. – 4 jours.
Aïd Al Adha , Eïd El Kebir, ou fête du sacrifice est une importante célébration musulmane. Elle est appelée également fête du Mouton en raison du sacrifice ordinairement pratiqué ce jour-là pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim. Elle symbolise la foi et l'obéissance à Allah. Aïd Al Adha constitue également le couronnement du pèlerinage de La Mecque.
Le tiers de la viande sacrifiée est distribuée aux pauvres, le reste est mangé en famille.
Dimanche 21 novembre 2010 - Fête chrétienne : Présentation de la Vierge [3 déc., cal julien]
Fête orthodoxe de la présentation de Marie au Temple de Jérusalem.
Dimanche 21 novembre 2010 - Fête sikhe : Naissance du Guru Nanak.
Cette fête célèbre l'anniversaire de naissance du gourou Nanak (1469-1538), fondateur de la religion sikhe et le premier des dix gourous. Il était un poète accompli : 974 de ses cantiques se trouvent dans le livre sacré sikh, Guru Granth Sahib. Durant les deux jours et nuits qui précèdent la fête, on le lit. Le jour de la fête, ce livre est porté en procession.
>
Mercredi 24 novembre 2010 : Fête sikhe : Martyre du 9e gourou Tegh Bahadur.
Ce jour commémore le martyre du gourou Tegh Bahadur Ji (1621-1675), le neuvième des dix gourous sikhs. Les sikhs honorent sa mémoire parce qu'il a défendu non seulement la foi sikhe mais également l'hindouisme et la liberté religieuse.
Jeudi 25 novembre 2010 : Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes : Les journées de l'O.N.U.
Le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et a invité les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités conçues pour sensibiliser l'opinion publique à ce problème. Campagne en cours.
Dimanche 28 novembre 2010 - Fête chrétienne : 1er dimanche de l'Avent.
Préparation à la naissance de Jésus à Noël et attente de son retour.
Les quatre semaines précédant Noël sont connues sous le nom d'Avent. Elles représentent le début de l'année liturgique et célèbrent la révélation de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Dans les églises, un cierge spécial est allumé chaque dimanche précédant Noël.
Dimanche 28 novembre 2010 - Fête chrétienne, orthodoxe : Début du carême de Noël, en calendrier julien.
Période de jeûne et de conversion pendant les 40 jours qui précèdent Noël.
Dimanche 28 novembre 2010 - Fête baha'ie : Ascension d’Abdu’l-Bahá le 28 novembre 1921.
Photo de Jean-Pierre Martin : Alpes du Sud
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.

DECEMBRE 2010
Mercredi 1er au 9 décembre 2010 - Fête juive : Hanouccah.
Hanouccah, ou Fête des lumières, commémore le miracle qui s'est produit lorsque le Temple de Jérusalem fut repris après sa profanation et purifié il y a plus de deux mille ans ( -165). Le peu d'huile qui restait pour allumer les lumières du Temple dura huit jours. Cette fête est marquée de cérémonies particulières à la maison et à la synagogue. Les festivités durent huit jours et ont pour symbole un chandelier à huit branches appelé hanoukia. Chaque jour, il est allumé une bougie supplémentaire.
Vendredi 3 décembre 2010 - Fête orthodoxe : Présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem.
Mardi 7 décembre 2010 - Fête musulmane : Premier Muharram, (date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune)
Mois sacré, Muharram ou Nouvel An de l'hégire (article de Kamel Meziti ) commémore l'exode de Mohamed et de ses adeptes de La Mecque à Médine, en 622, pour établir la première communauté musulmane.
Le 1er Muharram est le 1er jour de l'année lunaire. Nouvel an musulman 1432.
Mercredi 8 décembre 2010 - Fête bouddhiste : Bodhi.
Bodhi signifie Éveil. C'est la fête de l' Eveil de Bouddha sous l'arbre de l'illumination.
L'Eveil est l’objectif ultime de la vie d’un bouddhiste. Il tend à se libérer du cycle des renaissances et des passions, le samsara.
Mercredi 8 décembre 2010 - Fête catholique de l'Immaculée-Conception
Fête de Marie, conçue sans la marque du péché originel.
Dogme catholique défini par Pie IX en 1854, après sa célébration régulière depuis le XIIIe siècle.
Vendredi 17 décembre 2010 - Commémoration musulmane : Achoura (date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune)
Achoura est le dixième jour du mois de Muharram. Il est marqué par un jeûne que le Prophète Mohamed a recommandé aux musulmans. Achoura est aussi le jour du martyre d'Hussein, fils d’Ali et petit-fils du Prophète, à la bataille de Kerbela en 61 de l’hégire ou en 680 de l'ère chrétienne. Les chiites commémorent sa mort en organisant des processions.
Les Sunnites rappellent Moïse sauvé des mains de Pharaon.
Mardi 21 décembre 2010 - Fête shintoïste : Tohji-taisai
Selon la tradition shintoïste japonaise, le Tohji-taisai célèbre la cérémonie du solstice d'hiver où un culte particulier est rendu à l'esprit (kami) du Soleil.
Samedi 25 décembre 2010 - Fête chrétienne : Noël ( 7 janvier, en calendrier julien)
Grande fête célébrée dès le 24 au soir.
Noël commémore la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. C'est aussi l'annonce de son retour.
Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Ce nom même révèle son identité et sa mission, sauver les hommes et les conduire vers Dieu.
Mercredi 29 décembre 2010 - Fête zoroastrienne : Zartusht-no Diso.
En Iran, commémoration de la mort de Zarathoustra.
Vendredi 31 décembre 2010 - Fête chrétienne : Saint-Sylvestre.
Veille du jour de l’An, la Saint-Sylvestre commémore le pape Sylvestre 1er (314-335) sous le pontificat duquel l’Empire romain adopta le christianisme. On célèbre le dernier jour du calendrier civil.
Photo de Christiane.
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.


JUILLET 2010
Vendredi 9 juillet 2010 - Fête bahá´ íe : Martyre du Bab.
Commémoration par des lectures et des prières de l'exécution du Bab à Tabriz en Iran le 9 juillet 1850.
Vendredi 9 juillet 2010 - Fête islamique : Lailat al Miraj (date variable de 1 à 2 jours selon l'observation de la lune).
Fête du voyage du Prophète de La Mecque à Jérusalem, suivi de son ascension (Al-Miraj) vers le trône divin, puis de son retour à La Mecque dans la même nuit.
Mardi 13 au jeudi 15 juillet 2010 - Fête shintô : O-bon.
Il est dit que vers le 13 du mois, les esprits des ancêtres reviennent chez eux pour trois jours. Ils sont accueillis avec des danses dans les maisons et les villages pendant trois jours. Les pierres tombales sont nettoyées et une nourriture spéciale est laissée en offrande.
Jeudi 15 juillet 2010 - Fête bouddhique : Chökhor.
Dans la tradition bouddhiste tibétaine, cette fête commémore le premier sermon de Bouddha, avec de grandes processions.
Mardi 20 juillet 2010 - Fête juive - Jeûne du 9 Av.
Au terme de trois semaines d'évocation des catastrophes de l'histoire juive, jour de jeûne et de deuil afin de souligner la destruction du saint Temple de Jérusalem.
Lundi 26 juillet 2010 - Fête bouddhique : Asala.
Fête theravada du 1er sermon du Bouddha dans un parc près de Bénarès et début de trois mois de retraite monacale à la mousson.>
Vendredi 3 juillet 2010 - Fête shintoïste : Oh-harai-taisai.
Oh-harai-taisai ou Cérémonie de la grande purification a lieu depuis les temps anciens pour que les adeptes soient purifiés des fautes et des infractions commises pendant la première moitié de l'année lunaire. Dans le cadre des cérémonies, les fidèles japonais marchent à travers un grand anneau d’herbes et de roseaux, placé à l'entrée des sanctuaires, qui symbolise la purification.
Photo : Cap Bon, de H. de La Salle
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements sur vos fêtes religieuses.
.
 P. Obert - Février 2010
P. Obert - Février 2010
Une fiche de lecture
Profession Imâm
De Tareq OUBROU – Albin Michel 2009
L’essentiel me semble tenir page 43 « un de mes objectifs est qu’un musulman n’ait pas, ou plus, à choisir entre la pratique de sa religions musulmane et la citoyenneté française » et qu’il puisse ainsi « réaliser la double citoyenneté, céleste et terrestre ».
Ou encore, page 111-112, « Ce qui m’intéresse maintenant, c’est un islam pensé dans son monde actuel… C’est de préparer une doctrine pour les générations musulmanes futures, dans et pour un monde à venir. Voilà ce qui m’intéresse ! Penser l’objet de la foi et de l’éthique dans la culture occidentale, comme l’a fait le Coran avec la culture du moment coranique »
Ou encore, page 116 « il s’agit de répondre à cette double posture qui nécessite un grand écart : l’écoute confessante de la Parole de Dieu et l’exercice de l’intelligence pour saisir les significations du Texte qui en est la traduction écrite »
Et la dernière page ( page 216) synthétise son objectif
L’enjeu est essentiel car, il indique, page 197, que « seuls survivront spirituellement les musulmans qui savent modérer, adapter et négocier leur pratique avec la réalité de la société française »
*
De cet objectif émerge dans le chapitre 2 « Le monde de la laïcité et de la sécularisation » le concept de « sharia de minorité ». La sharia de minorité (page 40 et suivantes) est une théorie restreinte, qui prévoit un ensemble de méthodes permettant de suivre l’évolution de la société française et qui propose des outils méthodologiques, « une boîte à outils offerte aux imams, aux prédicateurs et aux muftis de France, …afin que s’élabore un discours qui favorise une religiosité intelligente et harmonieuse »
Cette sharia l’a amené à développer deux types de fatwa.
La fatwa positive, qui est la simple énonciation de l’application d’un texte (verset ou hadith) ou d’un canon déjà élaboré, « à condition que son contenu soit univoque et que le cadre juridique français et le contexte social le permettent »
Cette fatwa peut être positive commune quand elle concerne toute la communauté ou individuelle, et dans ce cas, elle cherche « à éviter la fracture sociale entre la vie du musulman au quotidien et son environnement sociétal ». « Cette dernière forme de fatwa affine, particularise, adapte, atténue, suspend ou annule la première fatwa, commune, selon les cas individuels qui se présentent »
« La fatwa négative par omission volontaire ou mutisme canonique principiel ». Elle consiste à s’abstenir d’énoncer certains contenus. « Elle peut aller jusqu’à développer une anti-fatwa et interdire et contrer des fatwas nuisibles répandues dans la communauté, des « boulets normatifs », encombrant la vie des musulmans, les empêchant de prendre un essor social, matériel et même spirituel » (p 43)
TO indique page 46 qu’il applique là la démarche coranique elle-même car les lois juridiques « sont venues répondre à un contexte précis qui s’est développé au long de vingt trois années » Il ajoute «Si certains regards n’arrivent pas à percevoir cela, c’est qu’ils sont conditionnés par un système de pensée qui, depuis très longtemps, est congelé et qu’il faudrait alors décongeler, fluidifier, et mettre dans le moule de notre condition contemporaine »
De façon générale, « toute loi doit rester au service de l’Homme, d’une façon ou d’une autre » (p 99) et il cite plusieurs fois Ibn Taymiyya qui disait « Si tu veux être obéi, demande ce qui est possible »
On retrouve dans ce jugement un élément qui court dans tout ce livre d’entretien, à savoir une critique assez dure d’une communauté musulmane qui peine à évoluer et qui reste prisonnière d’une tradition qu’elle ne comprend pas bien mais qu’elle applique. Il donne des exemples : le mariage (page 47 et 51)la dote (p 48) , les rapports entre l’homme et la femme ( page 57 et s), le fait pour chaque musulman de prendre ses responsabilités(page 71), le voile (p 81 à 85)
*
Un autre aspect important du livre est la condition de l’imam, la vie quotidienne de Tareq Oubrou lui-même, son itinéraire. Ceci est fortement évoqué dans le chapitre 1 sur « à la rencontre de Tareq Oubrou », au chapitre 5 « foi musulmane et raison critique : le rôle de l’imam » et le chapitre 7 « L’imam et le magistère ». De façon générale, il regrette la précarité de la situation matérielle de l’imam, le fait que la communauté lui demande beaucoup et sur tous les sujets et le considère trop peu, le manque de formation des imams et le fait qu’ils sont débordés. Sur sa vie, je retiens (page 183) « Moi, j’ai découvert la liberté ici, la dignité ici, la religiosité ici… et je suis redevable à la société française »
Il évoque aussi le rôle de l’imam dans les trois derniers chapitres « « portes ouvertes sur l’islam carcéral ch 8, », « les nouvelles générations de musulmans et le radicalisme ch 9 », et « L’imam face aux modèles républicains et multiculturaliste ch 10 »
*
Un troisième volet de ce livre traite du Dialogue inter religieux , dans le chapitre 6, pages 153 et suivantes. Les raisons du dialogue tout d’abord : il aime les gens, et l’injonction coranique Coran (13 :49).
Ce dialogue ne doit pas se faire contre les non-croyants ( p 154)
P 155 « … le dialogue inter religieux est d’abord une rencontre d’hommes et de femmes, d’individus, pas une rencontre des religions. Ce ne sont que des êtres humains qui dialoguent, traversés par des traditions religieuses certes différentes, mais partageant la même humanité, le même monde et généralement la même culture, la même condition sociale, la même langue et la même mentalité… »
Ce dialogue est important pour (p 156) « effacer cette image de la religion comme source de conflits qu’on a ici en Europe et notamment en France » et aussi afin de « fabriquer la paix entre les peuples, de contribuer à la paix civile des sociétés et d’éviter ainsi les conflits… »
P 159 « l’interreligieux comme éthique de l’altérité ».
Dans ce chapitre, il évoque l’exemple de Bordeaux, où le maire, Alain Juppé, vient d’installer un espace interreligieux (p 157) et son dialogue avec Mgr Ricard, évêque de Bordeaux. (p 160).
La fin de ce chapitre est marquée par l’évocation du conflit israëlo-palestinien (« qu’il faut éviter à tout prix d’importer en France »)
*
L’analyse faite ici reste très personnelle et j’ai sans doute omis de signaler des éléments importants du livre mais qui m’auront moins touché. Il ressort de ce livre un homme convaincu, qui travaille pour l’avenir en essayant de simplifier et faciliter la vie du français musulman, qui cherche à vivre pleinement dans son pays tout en pratiquant sa religion. Tareq Oubrou apparait comme un intellectuel, avec parfois un vocabulaire compliqué, mais surtout comme un homme simple et de coeur, ancré dans la vie et les soucis quotidiens des gens.

Fiche de lecture
établie par Patrice Obert, président de La fontaine aux religions
Le Christ autrement
Essai de théologie interreligieuse-
de Philippe LECLERCQ
Edition de l’Harmatan,2009
Difficile de parler du dernier livre de Philippe Leclercq. Difficile et pourtant indispensable.
Le parti pris est en fait démesuré : créer les conditions d’un dialogue plus facile avec le judaïsme et l’islam en partant d’une vision différente de ce qui est au cœur du christianisme, la personne même du Christ. Ce pavé dans la mare est lancé en page 169 qui ouvre le chapitre 5. Tout ce qui précède a pour but d’arriver à ce point central. Tout ce qui suit tient dans la conclusion qui succède directement à ce chapitre 5.
Le cœur est donc ce chapitre 5. 84 pages denses pour nous expliquer lumineusement que Jésus, l’homme, fils de Marie, n’est devenu le Christ, fils de Dieu, que lors de sa résurrection. Avec des néologismes d’une poésie totale. Tant que le Christ ne s’est pas révélé en Jésus, Jésus n’est que l’Insu de Dieu parmi nous. La Christité de Dieu se révèle pleinement dans le visage du ressuscité. Mais ce ressuscité, comme il est difficile de le reconnaître, même pour ceux et celles qui étaient ses amis. Il y faut du temps, la compréhension progressive des écritures, le long discernement lié à la relecture de ce qu’il a dit et fait, le long cheminement qui fait comprendre que derrière ce jardinier aperçu se profile le maître vénéré, le compagnon fabuleux, celui là même dont la vie et les mots étaient emprunts d’une si extraordinaire humanité pour les gens.
Ce long développement permet à Philippe Leclercq d’ouvrir une brèche phénoménale quand il dit « C’est en cela que nous pouvons dire en chrétiens que Jésus n’était pas le Christ » (p186). Puisque Jésus, homme, n’est pas le Christ révélé tant qu’il ne franchit pas la mort et la résurrection. De même que le Christ ressuscité, revêtu de la Christité de Dieu, dépasse largement le Jésus humain.
Voilà le cœur
Pour en arriver là, il aura fallu s’imprégner de ce qui précède. Ces 168 pages s’organisent en plusieurs développements.
Le premier est une réflexion extrêmement lumineuse sur les enjeux de l’interreligieux avec des phrases chocs.
Aller au bout de l’interreligieux nécessite que « les membres des différentes traditions relisent la particularité de leur propre démarche à partir du regard d’estime et d’interrogation des autres traditions en présence (p17).
« La frontière est au pays ce que la peau est au corps. L’une et l’autre se donnent à lire comme des lieux de fermeture, mais aussi comme des lieux d’ouverture » (p23)
« Il est plus réaliste et plus vrai d’apprendre à aimer avec sa tête et à réfléchir avec son cœur » (p31)
Avec les deux pages 48 et 49, dont on ne citera ici que quelques passages mais qui cernent la réalité essentielle de la rencontre interreligieuse « Le dialogue interreligieux contraint ainsi la raison à descendre du théorique au concret par une conversion de l’intelligence. C’est une démarche d’humilité qui impose le renoncement à la prétention d’élever la vérité au niveau du rationnel pur. Or la vérité n’est pas une raison à sauver, mais une vie à partager. » et plus loin (p49) « Faire le bon choix : comprendre plutôt que savoir, écouter plutôt que dicter, patienter plutôt qu’exiger…… Descendre de sa chaire de vérité pour aller à la rencontre de la chair de l’autre, qui est le lieu de sa vérité… puisque tout est grâce… »
Le second développement préliminaire est une réflexion sur la notion de « vérité ».(chapitre 2). Pour résumé, disons qu’il y a d’un côté la vérité du savoir, l’adéquation entre le mot et la chose, ce que Philippe Leclercq appelle « le pôle de l’adéquation binaire » ; et de l’autre côté, la vérité du discernement, d’une construction progressive, de l’expérience, ce qu’il nomme « le pôle de la symbolisation temporelle ». Comme illustration, notre monde occidental s’est fait le champion de la vérité-savoir. Philippe Leclercq interroge alors chacun des monothéismes dans son rapport à la vérité.
Le troisième développement est double et commence à nous perdre. Nous voici d’abord partis, au chapitre 3 « le parcours originaire », sur la trace des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Passionnant ! On retrouve le sens subtil de Philippe Leclercq pour éclairer les textes sous un regard nouveau. Précision des termes, poésie des images, avec cet attachement qu’il a, et qu’il nous fait si bien partager, pour Jacob. Il avait déjà consacré 55 pages à Jacob dans son précédent livre « Comme un veilleur annonce l’aurore » paru en 2006 à l’Harmattan. Avec cette notation finale « la parole de Dieu au fil du temps tisse notre vie sur la trame de l’histoire, histoire sainte et histoire humaine tout à la fois », notation qui nous renvoie indirectement au statut de la vérité évoqué précédemment.
L’autre axe de ce troisième développement tient à une longue tirade sur « le sang versé » qui constitue le chapitre 4. On ne sait plus trop où on va car la question de la page 157 reste en suspens. Patience, on aura la réponse à la page 203.
C’est alors que Philippe Leclercq fait se rejoindre dans une brassée ces différents préliminaires pour entamer le fameux chapitre 5.
Au passage, quelques mots forts happés
Sur la virginité « Rattacher la visée du dogme de la virginité à la christité de Dieu plutôt qu’à la personne de Jésus permettrait un recentrement sur l’essentiel de ce qui s’accomplit » (p 199) (propos assez iconoclastes mais tellement attendus de notre époque scientifique).
« Dieu féconde l’humanité par une parole qui se donne à recevoir comme un baiser, pour que cette parole, en pénétrant jusqu’au cœur, redonne à l’humanité un corps nouveau (p202)
« La logique humaine est d’engendrer par le sexe, dans la chair et le sang, tandis que Dieu n’engendre pas par le bas, mais par la parole qui sort de la bouche (p 202).
« …les textes nous donnent à comprendre que la finalité ultime de sens pour la vie de l’homme est au-delà de l’horizon de la loi du sang » (p 205). C’’est ici la réponse au chapitre 4. Ce faisant, Philippe Leclercq met en œuvre dans son propre livre le processus de la vérité-discernement qu’il exposait plus haut. Le lecteur comprend peu à peu, en s’imprégnant, en acceptant de ne pas tout visualiser du premier coup. Cheminement qui est celui de la foi et celui de l’humanité. Faire confiance, progresser et discerner peu à peu quand les écailles tombent des yeux.
Puis on bascule dans la conclusion. En quelques pages, Philippe Leclercq renvoie chacun à sa tâche :
Les juifs, qu’ils choisissent entre sionisme et judaïsme en faisant retour sur la figure de Jacob/Israël !
Les musulmans, qu’ils aménagent un espace d’interprétation s’ils ne veulent pas que « leur construction religieuse vole en éclat sur la pierre d’achoppement irréductible de la Trinité chrétienne » !
Les chrétiens ( d’ailleurs, il devrait plutôt ici parler des catholiques), qu’ils préfèrent l’amour à l’idéologie, qu’ils soient « dans le monde et non face au monde », qu’ils cessent de défendre « un supermarché du salut » et qu’ils découvrent rapidement un vaccin contre « le pouvoir hiérarchique, le dogmatisme et le moralisme ».
Peut-être, peut-être, mais est ce le propos, a-t-on envie de crier à Philippe Leclercq ? Il nous avait emmenés si loin, si haut !
Revenons au cœur et dessinons la vraie conclusion, celle qui reste à écrire. Si le Christ se dit autrement, avec les termes qu’emploie Philippe Leclercq, si Jésus n’est pas le Christ, selon la façon dont il présente l’Insu de Dieu qui ne révèle sa Christité que dans la croix et la résurrection, alors, qu’en disent nos amis juifs et musulmans ? Ce livre se termine en fait par un appel aux juifs et aux musulmans (sans d’ailleurs exclure les athées grâce à un lecture, encore une fois lumineuse, de l’Evangile du fils prodigue) qui veulent discuter avec les chrétiens, et ils sont nombreux. Vous, vous qui croyez en un Dieu unique, comment entendez vous l’appel de Philippe Leclercq, comment lisez vous sa démarche audacieuse, comment répondez vous à son invitation au dialogue ? Ce sont leurs réponses qui écriront la vraie conclusion de ce livre proprement révolutionnaire.

Fiche de lecture
établie par Patrice Obert, président de La fontaine aux religions
LE CORAN DECHIFFRE SELON L’AMOUR
de Khaled ROUMO
Editions Koutounia
L’amour est un : Khaled Roumo a fait le pari difficile, en ce siècle de raison et d’indifférence envers l’humain, de nous parler d’amour. Il a choisi de nous en parler en nous invitant à un voyage plein de poésie mais aussi d’érudition à travers les lettres du Coran. Dès le début, (pages 13 et 14), il nous livre un système de transcription et chaque sous-chapitre, qui identifie des aspects de l’amour, s’accompagne d’une référence à un ou plusieurs groupes de lettres renvoyant à la même racine mais se déclinant en sens différents, voire parfois opposés. Il nous donne la clé de sa lecture en fin de parcours, en page 159 « en résumé, le jeu des racines, leur richesse sémantique, le lien de parenté qu’elles maintiennent entre des réalités proches ou opposées et la manière dont le tout se déploie, dans le contexte coranique, démontre, encore une fois, que l’amour est un – même s’il varie d’une personne à l’autre et chez la même personne – selon l’accueil qui lui est réservé ».
Faille ontologique et faillite civilisationnelle : Impossible de résumer cet hymne à l’amour, cet hymne aux manifestations de l’amour, qui débordent des sourates du Coran. N’hésitez pas à vous reporter à la table des matières. La seconde partie, qui est le cœur de ce livre, court de la page 59 à la page 209 et décrit, comme son titre l’indique, « les facettes infinies de l’amour ». Au cœur de ce long cheminement, la page 102 m’a livré une clé que je voudrais vous faire partager. « Faille, faillite, perfection : Les bouleversements internationaux qu’activent actuellement nos débats, trahissent la faillite de nos sociétés ; et cette faillite traduit une défaillance d’amour. Mais alors quel est cet amour qui serait capable de nous sortir de telles impasses ? Comment le régénérer ? Dans le verset coranique (Coran 41, 53), il est question d’extériorité (horizons) et d’intériorité (intimité). Et entre les deux dimensions se creuse une faille dont est faite la condition humaine ! En réalité cette faille n’est pas fonction d’une diversité quelconque (ethnique, religieuse, sexuelle, générationnelle, sociale…) ; elle est plutôt la traduction d’une rupture de soi à soi, d’une distance ontologique. »
Oubli – Rappel : J’y vois le cœur du message de Khaled Roumo. L’humain s’est coupé de lui-même, en oubliant Dieu, son Créateur. Il nous le redit page 68 « La beauté est un hymne au Créateur ! Et si notre époque est désenchantée, c’est parce qu’elle manque d’émerveillement, conséquence inévitable d’une rupture avec Celui qui préside à l’invention de la beauté, à son maintien et à son renouvellement : « Ils ont oublié Dieu : et du coup, Dieu leur a fait oublier qui ils sont » (Coran 59, 19) ». Et page 79 « L’acte d’adorer est le but ultime de la création des humains et des esprits ». Notre société oublie Dieu et se perd, telle est la mise en garde que nous adresse l’auteur. Mais il ne nous laisse pas sur ce constat triste. Il nous donne les outils pour nous retrouver en comprenant mieux combien le Coran est le livre par lequel Dieu, « Celui qui interfère entre l’être humain et son propre cœur (p84) », n’en finit pas de nous inviter à Le lire.
Une lecture à mille voix : Car l’Islam est né sous le signe de la lecture, nous indique l’auteur en page 47. «: Répétons que le nom de son livre fondateur est qur’ân, ce qui veut dire entre autres, lecture ! de même, le premier mot de la révélation coranique est une injonction à la lecture : Iqra’, lis, à l’impératif ». Et Khaled Roumo lit pour nous, lit avec nous et nous pénétrons peu à peu dans cette lecture à mille voix, nous enchantant de ce voyage entre les sons, les consonnes et les voyelles, un peu « sonnés » sans doute de cette diversité tourbillonnante, un peu ahuris devant le savoir si précis, si sensible de l’auteur et devant la facilité trompeuse avec laquelle il exprime chaque nuance, tant en arabe qu’en français.
Ainsi, le ton est donné dès la page 8 « la racine bada’a (créer des merveilles) se transforme en ‘abada (adorer) ! Si bien que, le matériau lexical commun aux deux racines (BD’/’BD) rétablissant le lien sémantique entre les deux termes, nous fonde à dire « seules les merveilles suscitent l’adoration ! ou encore : l’émerveillement en soi est un acte d’adoration. » Ainsi des deux racines FKR/KFR qui jouent sur les deux verbes réfléchir et renier (ou enfouir), ce qui revient à dire que le kufr, reniement, c’est l’enfouissement des fruits du fikr, la réflexion (page 88/89). Ainsi « la même racine KLM suggère en arabe, la parole et la blessure » (p 109), ce qui lui fait dire « l’amour naît dans cette faille qui représente une blessure d’amour, kalm, kulûm au pluriel, par laquelle s’insinue la parole Kalima : nom de Jésus dans le Coran, Kalimatu’l-Lah, Verbe de Dieu »(p 111). Et ainsi de suite…
Hymne à l’universel : l’auteur cite bien sûr souvent le Coran, des auteurs soufis, mais aussi de nombreux auteurs s’inscrivant dans d’autres traditions, chrétienne, hindoue et aussi des romanciers, plus souvent athées, car Khaled Roumo est avant tout un poète, comme il se définit en 4ème de couverture.
N’hésitez pas à ouvrir ce livre rare et à vous laisser surprendre. Chacun s’arrêtera sur un sens qui réveille en lui une émotion, un souvenir, un regret, une espérance. Chacun sera séduit par cette façon si libre et si rigoureuse en même temps de jouer avec les significations des mots.
Dans une dernière partie, l’auteur nous parle de « L’amour à l’œuvre ». C’est l’occasion pour lui de nous donner le sens universel de l’islam (unicité de Dieu et de l’espèce humaine, diversité de la création, dualité), [on notera page 221 : Le mal voile la face de ce qui est différent pour en altérer le sens et le transformer en différend], de différencier l’islam spirituel, l’islam universel et l’islam historique. Nous retrouvons (page 202) Khaled Roumo en fervent acteur du dialogue interreligieux : « Etant donné les similitudes de cet itinéraire avec celui d’innombrables chercheurs du vrai, issus d’autres communautés religieuses ou non, il serait absurde d’assimiler l’islam – dans son acception spirituelle- à une religion définie par de simples caractéristiques socio-historiques.»
L’être d’abord : Khaled Roumo n’ignore pas le poids du présent. En page 252, il rappelle que Modernité et Ouverture des portes de l’ijtihad (l’interprétation) sont deux nécessités posées devant l’islam contemporain. Mais il nous met en garde page 262 « Le danger réel n’est pas l’affaiblissement ou la mort des religions en tant qu’institutions, mais plutôt le peu de valeur accordé à l’être humain. Contrairement à ce qui est reçu dans certains milieux religieux, cette mort du sujet n’est pas le fait exclusif de l’athéisme mais plutôt d’une certaine idolâtrie qui mine l’esprit humain. Et cette maladie gît d’une manière occulte ou latente dans l’expérience religieuse elle-même… Autrement dit, désobéit à Dieu celui qui croit y obéir en excluant les autres du champ de l’amour divin ».
Khaled Roumo termine ce bel ouvrage sur une sorte d’appel inquiet « La question demeure : comment faire face à notre faillite en amour, cause de nos maux, que les mots seuls ne sauraient jamais résorber ? » Appel qui s’adresse à chacun de nous, croyants comme incroyants.
Qu’il sache que ses mots, en tous cas, nous auront aidés à mieux comprendre la Source qui l’anime.

Le CORAN déchiffré selon l'AMOUR, de Khaled ROUMO.
L'AUTEUR
Franco-syrien, Khaled ROUMO est un poète engagé dans le dialogue des cultures et des religions. Il travaille, par ses écrits, ses conférences, à étendre la recherche du sens à toutes les visions du monde, qu'elles se référent au divin ou non. Administrateur du Groupe d'amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), il a fondé et anime les Cercles de controverses dans l'esprit de ce qui se faisait à l'âge d'or de Bagdad, et le Café de la Diversité.
RÉSUMÉ DU LIVRE
Le choix de l'amour comme thème central de la lecture du Coran permet de déchiffrer les secrets relatifs au lien intime entre Dieu, Allah et l'être humain. L'étude s'intéresse aux mots de la relation amoureuse utilisés dans le Coran et invite à découvrir la spiritualité de l'islam dont la dimension universelle est commune aux multiples expériences spirituelles.
QUATRIÈME DE COUVERTURE
Nous voici invités à un voyage à travers les mots d'une autre langue, l'arabe, et d'une spiritualité peu ou mal connue, l'islam. Est-ce un hasard si parole et blessures procèdent d'une même racine en arabe, langue de Révélation ? Parler, serait-ce blesser ? Est-ce la blessure qui génère la parole ? Y aurait-il autant de mots d'amour que de blessures ? Et l'amour n'est-il pas indicible ? «Si l'amour est savouré, dit Ibn Arabi, son essence est incomprise.» De mot en mot, de questionnement en questionnement, l'auteur nous entraîne de cet islam, qui est une vision du monde, à Dieu, dont le Nom, Allah, évoque en arabe désir d'union et de connaissance, afin que vie et monde reprennent enfin sens. Un essai passionnant, inattendu, générateur de découvertes, d'énigmes et d'interrogations.

L’HISTOIRE DE LA FÊTE DE VAÏSAKHI
Le jour de Vaïsakhi, la fête des moissons qui annonce le retour du printemps, marque aussi pour les vingt-cinq millions de Sikhs, répartis aujourd’hui dans plus de cinquante pays et formant le cinquième groupe ethnique et religieux au plan mondial, l’anniversaire de la révélation de l’Ordre des KHALSA (les Purs, c’est-à-dire celles et ceux qui vouent leur existence à la purification spirituelle et à la lutte contre l’ego) qui eût lieu en 1699.
Guru Teg Bahadur, le neuvième des onze Gourous (les dix incarnés sous forme humaine et le Siri Guru Granth Sahib, notre recueil d’Ecritures Saintes) historiques des Sikhs, prit la décision de subir le martyre pour aider l’Inde de son époque à se libérer de la tyrannie et du fanatisme des dictateurs qui l’opprimaient.
Avant de mourir, il insuffla son esprit de sacrifice dans le cœur de son fils alors âgé d’une dizaine d’années : Gobind Raï. C’est à l’âge de trente-trois ans que ce dernier reçut à son tour l’inspiration divine d’instiller ces conceptions du courage et de l’abnégation dans le cœur de tous et de toutes les Sikhs.
Il les dota pour cela d’une identité qui les inciterait à jamais à résister à l’injustice, à la tyrannie et à l’oppression.
Chaque année à l’approche du premier jour du mois de Vaïsakh, les fidèles se réunissaient traditionnellement par milliers dans sa ville d’Anandpur Sahib au Pendjab pour recevoir les bénédictions du Gourou. Au début de 1699, plusieurs mois auparavant, Guru Gobind Raï avait envoyé des édits spéciaux à tous les membres de sa congrégation, jusqu’aux plus éloignés. Il les avait enjoints à ne plus couper leurs cheveux et de les porter relevés sous le turban. Il avait aussi demandé que les hommes viennent avec des barbes intactes.
Le jour de Vaïsakhi 1699, alors que des centaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées autour de sa résidence d’Anandpur Sahib, le Guru s’adressa solennellement aux membres de la congrégation pour leur rappeler leur mission divine et les exhorter à reconstruire leur foi et à préserver l’intégrité du Dharma (la Voie spirituelle) des Sikhs.
Dès la fin de son discours, il tira son épée et rappela que chaque grande Alliance doit toujours être précédée d’un sacrifice d’égale grandeur : il exigea donc une tête humaine pour l’oblation à Dieu.
L’agitation s’empara de l’assistance, mais un homme finit par offrir sa tête au Guru.
Celui-ci l’emmena à l’intérieur de sa tente puis réapparut un peu plus tard portant à la main son épée trempée de sang. La scène se reproduisit quatre fois encore. Le Guru demanda quatre autres têtes et quatre fidèles fervents se sacrifièrent.
Pensant leur guide spirituel frappé de démence meurtrière, ses disciples (la signification première du mot sikh) commencèrent à se disperser pour s’enfuir.
Mais le Guru sortit alors de la tente accompagné des cinq hommes parés des signes corporels et vestimentaires qui symbolisent depuis ce jour la piété et la noblesse des Sikhs.
Il baptisa ces cinq hommes par une cérémonie que nous nommons Khande Da Pahul (l’épée à double tranchant utilisée pour le baptême initiatique) ou Amrit (le Nectar divin) et leur fit jurer de rester fidèles à cette manière de vivre.
Puis il demanda à ces cinq premiers initiés, les cinq Bien-aimés, de le baptiser de la même manière et il devint Guru Gobind Singh.
Depuis lors, toutes celles et ceux qui reçoivent ainsi l’Amrit de l part de cinq Sikhs initiés se voient insuffler l’esprit du courage et la force du sacrifice.
C’est en s’appuyant sur ces principes que notre dixième Maître spirituel à révélé le Kahlsa Panth, l’Ordre des Purs.
En même temps, il donna aux Khalsa une identité unique, indiscutable et distincte : le Bana, la forme corporelle et vestimentaires des Sikhs initiés qui comprend cinq articles de foi portés aussi bien par les hommes que par les femmes et universellement connus aujourd’hui comme les Cinq K : Kesh, cheveux et barbes non coupés sous le turban ; Kangha , un peigne de bois ; Kara, un bracelet de fer ; Kirpan, une dague ou épée non nécessairement tranchante de nos jours ; Kachera un vêtement.
Tous les Sikhs, hommes, femmes et enfants gardent ainsi présent à l’esprit qu’ils ont à vivre une vie faite de courage, de décence, d’abnégation et d’égalité.
Dans le Dharma des Sikhs, on considère que l’être humain n’est pas né libre mais qu’il est né pour se libérer. Cette libération spirituelle s’obtient par la pratique des enseignements qui se transmettent au sein de la confrérie. Cette transmission est conditionnée bien évidemment par le respect des vœux et de l’engagement contractés lors du baptême initiatique. Au cours de ce processus, des centres spirituels situés dans le crâne deviennent actifs et le rôle des cheveux longs soigneusement peignés, ramenés sur la fontanelle pour les hommes ou le sommet du crâne pour les femmes, puis recouverts et maintenus par un turban serré qui en est de ce fait indissociable est de favoriser cette activité en captant, filtrant, équilibrant et consolidant les énergies concernées.
Les Sikhs respectent toutes les croyances autant que l’absence de croyance. Ils considèrent que l’humanité entière ne forme qu’une seule famille.
Aussi toutes celles et tous ceux qui désirent se joindre aux festivités que les Sikhs organisent pour Vaïsakhi sont-ils les bienvenus.
Kudrat Singh Khalsa
 Institut catholique de Toulouse
Institut catholique de Toulouse ISTR, Institut de Science et de Théologie des Religions
PROGRAMME DU SECOND SEMESTRE
CONNAISSANCE DES RELIGIONS
COURS : Marie-Thérèse URVOY, Le Coran : étude et lecture, (2è semestre, mardi 16h15-18h00, option ISTR pour la Faculté de Théologie).
COURS : Bernadette ESCAFFRE et Monique Lise COHEN, Approche du Judaïsme, ( 2e semestre, lundi 18h15-20h00).
SESSION : Moïz RASIWALA, Introduction à l’Hindouisme, 27-28 mars 09. 9h30/12h30-14h00/17h00.
SCIENCE DES RELIGIONS
COURS : Pascale MANUELLO, Les religions premières, ( 2e semestre, jeudi, 18h15-19h45,)
SESSION : Marie-Claude LUTRAND, Aspects des mutations culturelles contemporaines, 5-6 mars 09 (à la Faculté de Philosophie, Master Éthique & Société). 9h30/12h30-14h00/16h00.
SESSION : Bernard UGEUX et Marie-Claude van den BOSSCHE, Sexualité et religions, 25 avril 09, (avec des intervenants de différentes traditions religieuses). 9h30/12h30-14h00/17h00.
Site : www.ict-toulouse.fr
THEOLOGIE DES RELIGIONS
COURS : Bernard UGEUX, Missiologie, ( 2e semestre, mardi, 10h30-12h15).
COURS : Jean-Jacques ROUCHI, Le document Nostra Aetate (Vatican II, sur les religions) revisité à partir de l’actualité, ( 2e semestre, mercredi, 16h15-18h00).
Partenariat avec le centre Notre-Dame de TEMNIAC
Bernard Ugeux, Comment interpréter la montée des intégrismes et des fondamentalismes religieux ? 28 mars 09.
Arlette Fontan, L’expérience mystique dans les religions, 16 mai 09.
 L’HOMME N’EST PAS NÉ LIBRE IL EST NÉ POUR SE LIBÉRER
L’HOMME N’EST PAS NÉ LIBRE IL EST NÉ POUR SE LIBÉRER « l ‘Homme n’est pas né libre, il est né pour se libérer ! » Cette phrase est attribuée au fondateur du sikhisme : Gourou Nanak. C’est sans doute celle qui est restée la plus célèbre dans tout le sous-continent indien et en tout cas celle qui résume le mieux à mes yeux son héritage.
Je me suis révélé comme Sikh au fil d’une relation traditionnelle de maître à disciple entretenue pendant de longues années avec un représentant de cette tradition. Le mot sikh signifie d’ailleurs disciple. Un ou une disciple est quelqu’un qui, avant tout, est capable de reconnaître un maître : « Les êtres humains aiment Dieu ; un maître est aimé par Dieu. Cela fait une différence ! » Mais tout disciple qui ne dépasse pas son maître, le meurtrit.
Des Brahm Gyani, littéralement « qui ont la connaissance de Dieu », où plus exactement de ce que nous concevons comme Dieu, sont envoyés au monde pour aider l’humanité par un Hukam, décret divin. Le sikhisme, chemin universel et témoignage vivant de l’unicité de la voie spirituelle, reconnaît tous ces envoyés. Mais dans le sikhisme, aucun être humain n’a de préséance sur un autre. L’Ego ne peut présider ni directement ni indirectement. Le sikhisme est par conséquent une Voie très ardue pour la grande majorité des gens. Car on ne peut pas simplement l’adopter comme un ensemble de croyances, on doit le vivre.
Adolescent, j’étais persuadé que la liberté, c’était n’avoir ni Dieu ni maître. En fin de compte, j’ai rencontré un homme que j’ai accepté comme mon maître spirituel, connu sous le surnom de Yogi BHAJAN (1929-2004), et une fois que ce dernier m’eût conduit face à une expérience sur laquelle je ne pus mettre d’autre mot que Dieu, il me dit simplement : « Rentre chez toi libéré ! »
Il avait parfois coutume d’expliquer à quelques privilégiés :
« Dieu est l’expérience qui survient lorsque la totalité de la psyché humaine se déploie. Et personne ne peut dire si c’est Dieu qui a créé l’homme ou bien si c’est l’homme qui a créé Dieu ! »
ou encore :
« Les électrons, les protons et les neutrons qui composent nos atomes dansent en permanence une petite danse. Et bien, le rythme de cette danse, c’est Dieu ! »
À celles et ceux qui demandent sincèrement : « Où trouver Dieu? »
Nous sommes donc désolés de devoir répondre : « Il n’y a qu’un endroit en ce bas monde où vous pouvez trouver Dieu : Dans le dictionnaire, à la lettre D ! »
Voici tout d’abord une définition du fait religieux qui a l’avantage d’être à la fois simple et immédiatement utile : être religieux, cela signifie être relié. Pour nous cela se traduit concrètement par « regarder vers l’Origine ».
« Amrit velaa sach naa-o, vadi-a-ee veechar
Karmee aavai kaparaa nadaree mukh duaar
Naanak ayavay jaaneeai sabh aapay sachiaar »
Gourou Nanak, Japji Sahib, 4th Pauri
Aux heures de l’aube, lorsque vous adressez vos prières à l’Infini et lui rendez grâce, vous vous connectez avec quelque chose au-delà de vous. Et Nanak nous a dit : « C’est la seule voie que je connaisse ». « Nanak ayavay jaaneeai sabh aapay sachiaar » « Dieu réalise toute chose » dit ce verset « mais la voie que je connais est cette voie ».
Si votre discipline spirituelle, quelle qu’elle soit, ne vous a pas octroyé cette faculté que les yogi nomment Anubhava et qui est celle de vous sentir spontanément face à l’infini dès que vous vous commencez de vous recueillir, la suite de ce texte ne vous sera pas directement utile.
Cependant, une des conclusions auxquelles nous ont conduit nos expériences est que, dans le domaine de la spiritualité, ce qui ne fonctionne pas pour vous de manière directe fonctionne de manière indirecte.
La libération spirituelle est l’objectif ultime autour duquel s’organise toute la vie d’un(e) Sikh. Elle s’obtient par la pratique de divers enseignements qui se transmettent au sein de la confrérie. Nous ne prétendons pas être les seuls à les détenir encore. Nous estimons même qu’aucun groupe humain particulier n’est ou n’a été fondé à revendiquer de tels enseignements comme sa propriété.
Selon notre compréhension, ces enseignements n’appartiennent qu’à celles et ceux qui les mettent en pratique. Ils nous donnent les moyens de nous hisser au sommet de nous-mêmes dans un apprentissage au quotidien et sont organisés en un Système qui se protège lui-même et que nous nommons le Jeu de l’Amour. Tous ses participants sont en effet liés par une chaîne d’Amour : on l’appelle la Chaîne d’Or. Plus stricte que la tradition orale et inaliénable, c’est une tradition silencieuse.
Il s’agit d’un sentier extrêmement ancien et d’un jeu dont les règles sont parfaitement connues. Il assigne à chacun d’entre Nous la tâche d’en amener un autre jusqu’à la lumière :
« Celui qui veut jouer le jeu de l’Amour
Qu’il place sa tête dans la paume de sa main et marche sur ma Voie
Si vous voulez placer vos pas sur ce sentier
Alors n’hésitez pas à donner votre tête »
Gourou Nanak
Nous reconnaissons l’humanité entière comme ne formant qu’une seule race et ne faisons donc aucune distinction de genre, de caste, de condition, nationalité, ni même de système de croyance. Mon guide spirituel ne m’a jamais demandé de « devenir » sikh pour me transmettre ce qu’il avait à me transmettre. Il m’a déclaré un jour :
« Ne te laisse pas appeler Juif si tu ne peux servir toute l’humanité, ne te laisse pas appeler Chrétien si tu ne peux aimer toute l’humanité et ne te laisse pas appeler Musulman si tu ne peux te montrer humble devant toute l’humanité. »
Mais si vous ne pouvez abandonner votre tête pour écouter votre cœur, choisissez un autre chemin.
L’unicité de l’humanité est un principe essentiel. Le premier enseignement délivré par Gourou Nanak après sa révélation, à une époque qui présentait bien des analogies avec la nôtre, fût : « Il n’y a pas d’hindous, il n’y a pas de musulmans. Il n’y a que des êtres humains »
Tous les êtres humains naissent avec le même équipement. Nous sommes traversés par des souffles, des flux d’énergie selon une terminologie contemporaine. Leur unisson constitue la vibration primordiale de l’être : le Verbe.
« À la cime de l’être résonne le Verbe. Le Verbe est consubstantiel à l’Esprit de l’infini. Le Verbe est l’Esprit de l’infini. »
Mais lorsque nous le transformons en mots, ces derniers sont différents. Hari est l’un des plus couramment employés par les Sikhs. Mais toutes les communautés de destin spirituel ont forgé leur terminologie propre.
À cause de cela, nous ne nous comprenons plus et nous pouvons même devenir ennemis.
Et c’est aussi pourquoi le terme de « libération spirituelle » peut paraître si étrange à certains.
Il s’agit pourtant tout à la fois d’un art et d’une science que l’humanité n’a jamais cessé de pratiquer.
Tous les hommes ont donc donné un ou des noms à cette force primale, Mais la Conscience Universelle de cet Esprit Universel possède un nom universel : Vérité. C’est pourquoi les Sikhs l’appellent également Sat et se la remémorent comme Sat Nam.
Beaucoup de gens, particulièrement les Occidentaux, n’arrivent pas de nos jours à appréhender spontanément la vraie nature de la recherche spirituelle. Ils considèrent que maîtriser intellectuellement les concepts énoncés dans les Écritures Saintes au sujet de la « vérité », c’est la connaissance spirituelle. Le plus tragique est qu’ils pensent sincèrement que c’est suffisant. Ils croient que la vérité dont il est question ici peut se comprendre au moyen de l’intellect. Or cette vérité n’est connaissance spirituelle que lorsqu’elle est devenue expérience personnelle.
Et tout ce qui, au cours de notre vie, peut nous guider vers elle, fait déjà partie de cette connaissance. Un maître spirituel, un Gourou, peut vous montrer la bonne voie. Mais il ne peut en aucun cas vous faire cadeau de cette vérité, car elle est son expérience à lui. Et vous, vous devez faire la vôtre.
Toutes les « religions majeures» et les grands penseurs à travers l’histoire ont reconnu la présence en chacun d’entre nous d’un « Soi » bien plus vaste; même si les corridors de ce Soi ne sont pas si aisés à franchir. Certains le nomment « Dieu », d’autres le décrivent comme « un Océan infini de félicité éternelle » et d’autres encore s’y réfèrent comme à une source de « créativité illimitée ». Dans les cercles du Yoga, on l’appelle souvent Atman. J’apprécie particulièrement de le définir comme « l’Esprit de l’Infini » car, par définition, l’Esprit de l’Infini ne saurait être étroit,
Tout individu se déplace par conséquent en permanence sur une orbite spirituelle. La spiritualité, être spirituel, ce n’est donc rien de plus que de sentir l’esprit en nous. Sur le long terme, c’est l’esprit en vous qui vous fait vaincre, qui vous donne le courage, qui vous donne l’endurance, qui vous donne l’intuition, l’amour-propre et la connaissance de soi.
Un être humain qui se lance dans la quête de sa libération spirituelle le fait parce qu’il a pris ou plutôt repris conscience d’être pareil à un poisson dans un lac qui pourrait nager en eaux plus profondes.
Dès lors, il peut être considéré comme un(e) Sikh du Gourou. Son plus grand ennemi devient l’égocentrisme, que nous nommons Haumai. Celui-ci se manifeste à travers les valeurs temporelles, les variations et combinaisons sans limites et sans fin de l’attachement, de la colère, de la concupiscence, de l’avidité et du matérialisme.
Tout cela forme un voile d’illusion maya, qui lui masque la profondeur du réel et le tire continuellement vers le bas, dans le Samsara, cycle des renaissances conditionnées par ses actions passées, son Karma.
Mais, en dehors de Maya, existent les valeurs naturelles de la création divine, auxquelles chacun et chacune peut s’accorder par une conduite juste.
Un des instruments utilisés par les Sikhs pour atteindre ce but est Kirt Karo, le labeur. Faire son devoir de père ou de mère de famille.
Mais de surcroît, ils accomplissent de manière désintéressée leur Seva, le service de l’humanité et du Sadh Sangat, la confrérie des Saint(e)s, la communauté spirituelle des Sikhs qui possède une influence mystique dans le Sikh Dharma, la Voie des Sikhs.
Le seva peut consister à préparer le repas au Gurdwara, le lieu de culte toujours flanqué d’un réfectoire, ou à coordonner la lutte pour le droit à la différence. Au tout début de cette histoire, je me suis pourtant un jour posé, au sortir de l’une de mes séances de méditation quotidienne, la question suivante : « Mais pourquoi la tâche de mener ce combat m’est-elle échue à moi qui ai déjà tant bataillé ? » Ce matin-là, du fond de ma conscience se leva une fois encore la petite voix que j’aime tant : « C’est ta récompense ! » me sembla-t-il saisir.
Il y a aussi Vand Chako qui consiste à aider ceux qui ont besoin d’aide et protéger ceux qui ont besoin de protection.
Ensuite, il y a Nam Japo, la vénération du Seigneur sans forme à l’aide de Simran, la répétition de mots qui aident à concentrer le mental sur la conscience la plus élevée.
Un privilège particulier caractérise enfin la demeure de notre Gourou : en son sein, le père comme la mère de famille doit se comporter à la fois comme un(e) saint(e) et comme un(e) soldat(e), des saints maîtres d’eux et des soldats qualifiés.
Si un(e) Sikh du Gourou maîtrise ce qui précède, il est ouvert au Prasad , la Grâce de Dieu, quel que soit le nom qu’on lui donne qui est décrit comme Sat, la vérité, Kal, au-delà de la mort, et par bien d’autres noms encore qui expriment l’indescriptible essence de la conscience suprême qui imbibe la création.
On ne peut la comprendre, mais on peut l’expérimenter comme une présence intérieure sous la forme du Shabd, le Verbe, du Nam, l’essence, et du Guru, ce qui donne la lumière. Cet état d’expérience du divin est appelé Samadhi, Sahaj, Liv ou encore Vismud , l’émerveillement et il confère Jiwan Mukta, la libération spirituelle de son vivant. Alors la réincarnation n’est plus nécessaire et l’âme demeure dans la présence de Dieu.
La méditation est une transe hypnotique auto-invoquée qui comporte plusieurs degrés et la méditation a un but. Il s’agit d’une pratique très subtile, précise et intelligente qui aboutit par-delà la confusion, l’agitation et les humeurs du mental à la conquête d’une âme éternelle et divine. Nous ne disons pas que le processus est aisé, nous disons que ses résultats sont fantastiques. La personnalité d’un(e) Sikh est très humble, tout à fait normale mais produit une extraordinaire élévation de la psyché. Nous appelons ce phénomène Cherdi Kala.
« Mais qu’est-ce que l’âme ? » rétorqueront certains. Tout le monde le sait ! C’est un animal qui ressemble à un petit cheval et qui a de grandes oreilles.
Une fois que vous avez eu votre expérience, il reste à adopter une discipline de vie afin de la renforcer et de la rafraîchir sur une cadence quotidienne.
L’objet de la religion et du Yoga, que vous pratiquiez l’une ou bien l’autre ou encore les deux, est de vivre consciemment. C’est de développer une personnalité telle que vous tombiez amoureux de votre conscience, de votre propre conscience et non de celle de quelqu’un d’autre. Cela, c’est vivre libre. Parce que vous ne vous déconnectez plus jamais de l’infini; ne pas sentir Sa présence c’est dès lors se sentir absent. À dater de cet instant, vous êtes placés sous le joug et votre voyage de retour débute.
Progressivement le méditant averti, dont le calibre intuitif est suffisant pour comprendre les instructions du Gourou, le Yogi, devient capable de pressentir l’attaque de la mort. À sa dernière heure, juste avant qu’elle ne le frappe, il libère une fois pour toutes son âme. Et, parce que c’était la volonté de Dieu depuis le début, il la fixe entre fini et infini.
Le jour et la nuit sont comme deux nourrices dans le giron desquelles se déroule le jeu de toute la création. Les bonnes et les mauvaises actions seront contées et comptées devant leur juge. Certains seront appelés et d’autres repoussés selon leurs actes. Ceux qui ont accompli le plus dur des labeurs en méditant à l’aide du Verbe divin en ont fini avec la souffrance. Ils partiront la face radieuse et beaucoup seront émancipés avec eux.
Puisse la paix prévaloir en l’homme. Puisse la paix prévaloir entre les hommes. Puisse la paix prévaloir entre l’homme et son environnement.
Kudrat Singh MÉNIR
3 rue du Pastur Wagner
75011 Paris
06 67 71 95 00

LA FRATERNITÉ
partagée par treize voix religieuses

Une même estime pour l’homme,
une même soif de Dieu :
Treize voix
Treize regards
Tendus dans une même direction :
Une communauté traversée
Par une infinité de liens
Cela s’appelle…
… la fraternité
Fascicule vendu au prix de 7€50 (frais de port compris)
à commander à :
Comité interreligieux
de la Famille franciscaine de France
27 rue Sarrette 75014 Paris
06 23 70 91 21
comite-interreligieux@franciscain.net
Lorsque au mois de mars 2003, le comité interreligieux de la famille franciscaine de France fut fondé, nous ne pouvions imaginer que nous irions aussi loin dans la réflexion et le partage communs.
Après trois années de tâtonnements, durant lesquelles nous avons pris le temps de nous apprivoiser, de nous connaître, de tisser des liens d’amitié, nous avons jugé que le moment était venu pour échanger autour de thèmes qui nous interpellaient, en nous appuyant sur nos traditions et nos Ecritures respectives.
Depuis deux ans, nous travaillions sur un sujet qui nous tenait à cœur : la fraternité, thème essentiel à la spiritualité franciscaine.
Ce livret n’est pas le fruit du hasard. Il est le résultat de la rencontre et du partage de treize personnes qui s’apprécient et sont toujours heureuses de se retrouver.
Au fur et à mesure de nos discussions, parfois un peu vigoureuses, mais en restant toujours respectueux envers l’autre – nous pouvons parler de « correction fraternelle » - , nous avons pensé que l’expression de cette richesse devait être retransmise au-delà de notre groupe.
St François disait : « Dieu m’a donné des frères à aimer » ; dans la Bible, il est écrit : « tu aimeras ton prochain comme toi-même.»
La fraternité est le lien qui nous unit les uns aux autres. Elle est notre force lorsque nous nous découvrons à travers nos partages. Elle anime la vie de notre groupe. La foi exprimée par chacun d’entre nous renforce notre propre conviction religieuse.
Dans les textes qui suivent, vous retrouverez tout ce qui nous fait vivre.
Nous souhaitons que ce document aide chaque lecteur à approfondir sa conception de la fraternité, en ayant une meilleure compréhension de la vie spirituelle des autres croyants.
Pour le comité interreligieux
de la famille franciscaine
Josette Gazzaniga

ISTR- Toulouse - PROGRAMME 08-09 ,
Institut de Science et de Théologie des Religions de Toulouse.
EVENEMENTS
Mardi 30 septembre 08, à 20h30. Conférence de rentrée : Hindous, chrétiens et sikhs dans l'Inde d'hier et d'aujourd'hui. avec Catherine Clémentin et Denis Matringe, en partenariat avec les éditions Albin Michel. Salle Léon XIII, 31, rue de la Fonderie.
24 (9h30-18h00) -25 (9h00-13h00) janvier 09, Colloque ISTR en partenariat avec la Chaire Jean Rodhain (Faculté de Théologie) et l’Arche de Jean Vanier : Fragilités interdites ? Plaidoyer pour un droit à la fragilité, à l’Universités des Sciences Sociales.
CONNAISSANCE DES RELIGIONS
Premier semestre
COURS : Olivier CARREROT, Initiation à la civilisation chinoise, ( 1er semestre, lundi 18h15-20h00).
CYCLE DE CONFERENCES : Bernard UGEUX (coordinateur) L’expérience mystique dans les traditions religieuses, Jeudi 9, 16, 23 octobre et 13, 27 novembre, 11 décembre 08, 18h30-20h00.
Inscription obligatoire à l’ensemble du cycle.
SESSION : Jean MONCELON, Voyage spirituel et Guide intérieur dans le christianisme et l'islam. 5-6 février 09, (proposée dans le cadre des multisessions de la Faculté de Théologie). 9h00/12h00-14h30/17h30.
Second semestre
COURS : Marie-Thérèse URVOY, Le Coran : étude et lecture, (2è semestre, mardi 16h15-18h00, option ISTR pour la Faculté de Théologie).
COURS : Bernadette ESCAFFRE et Monique Lise COHEN, Approche du Judaïsme, ( 2e semestre, lundi 18h15-20h00).
SESSION : Moïz RASIWALA, Introduction à l’Hindouisme, 27-28 mars 09. 9h30/12h30-14h00/17h00.
SCIENCE DES RELIGIONS
Premier semestre
SESSION : Marie-Claude LUTRAND, La médiation interculturelle, L'attitude de médiation: un "art de l'être avec", 4 et 5 décembre 08, 9h30/12h30-14h00/17h00.
Second semestre
COURS : Pascale MANUELLO, Les religions premières, ( 2e semestre, jeudi, 18h00-19h45, commun avec la Faculté de Lettres : premier cours le 29 janvier 09 !)
SESSION : Marie-Claude LUTRAND, Aspects des mutations culturelles contemporaines, 5-6 mars 09 (à la Faculté de Philosophie, Master Éthique & Société). 9h30/12h30-14h00/16h00.
SESSION : Bernard UGEUX et Marie-Claude van den BOSSCHE, Sexualité et religions, 25 avril 09, (avec des intervenants de différentes traditions religieuses). 9h30/12h30-14h00/17h00.
THEOLOGIE DES RELIGIONS
Premier semestre
COURS : Bernard UGEUX, Théologie chrétienne des religions, ( 1er semestre, mardi 10h30-12h15).
COURS : Gérard REYNAL, A la rencontre de quelques pionniers du dialogue interreligieux, option ISTR pour la Faculté de Théologie, ( 1er semestre, mardi 18h15-20h00). Attention, le premier cours est remplacé par la conférence de rentrée à 20h30.
Second semestre
COURS : Bernard UGEUX, Missiologie, ( 2e semestre, mardi, 10h30-12h15).
COURS : Jean-Jacques ROUCHI, Le document Nostra Aetate (Vatican II, sur les religions) revisité à partir de l’actualité, ( 2e semestre, mercredi, 16h15-18h00).
Pour le Certificat d’Etudes Religieuses et Théologiques (CERT), consulter le livret des études.
Partenariat avec le centre Notre-Dame de TEMNIAC
Bernard Ugeux, Comment interpréter la montée des intégrismes et des fondamentalismes religieux ? 28 mars 09.
Arlette Fontan, L’expérience mystique dans les religions, 16 mai 09.
ISTR, 8 place du Parement, 31000 Toulouse, 05 61 36 81 22, istr@ict-toulouse.fr,
Site : www.ict-toulouse.fr Programme à télécharger.
 GURDWARA, la maison du Guru.
GURDWARA, la maison du Guru.Le 09 février dernier, rue de la Ferme à Bobigny, a eu lieu la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau Gurdwara qui devrait voir le jour d’ici un peu plus d’un an, à la place de l’ancien Gurdwara devenu trop petit.

Intérieur d'un Gurdwara
IL existe cinq Gurdwara en France, tous sont installés en Seine Saint Denis, le plus ancien et le plus important de part sa taille et ses activités se trouve donc à Bobigny. Ouvert à l’initiative des premières familles sikhes arrivées en France dans les années 80, ce lieu fait peau neuve et va se transformer en un lieu de culte spacieux et confortable. Le mot Gurdwara peut être littéralement traduit par le portail, la porte, la maison du Guru. Le mot Gurdwara est formé de deux mots : Gur ou Guru, le guide spirituel et « dwara » qui signifie la porte ou le seuil d’une maison.
Dans la première période du sikhisme, le mot « Dharamsala » était utilisé pour faire référence au lieu de culte sikh. On raconte que Guru Nanak (1469-1539), le fondateur du sikhisme, durant ses nombreux et lointains voyages, invitait ses disciples à construire des Dharamsalas afin qu’ils s’y réunissent pour prier. A l’époque de Guru Hargobind (1595-1644), le sixième Guru, les Dharamsalas ont commencé à être appelées Gurdwara. L’utilisation de ce nouveau nom est significative d’un important changement. En effet, Guru Arjan Dev (1563-1606), le cinquième Guru, avait compilé les hymnes sacrés de ses prédécesseurs spirituels, les siens et les compositions de saints indous et de soufis indiens, en un livre ( l’Adi Granth) qui deviendra ensuite le Guru Granth Sahib, le livre sacré des sikhs. A partir de cette période, des copies du Livre Saint furent installées dans les différentes Dharamsalas. Les Dharamsalas où le Guru Granth Sahib fut installé furent alors appelés Gurdwara. Cette désignation devint universelle lorsque Guru Gobind Singh (1666-1708), le dixième et dernier Guru vivant, instaura le Guru Granth Sahib comme le Guru éternel des sikhs.

Granthi lisant le Guru Granth Sahib
Un lieu de prière et de recueillement devient un Gurdwara uniquement par la présence du livre saint, qui est la manifestation visible des Paroles et de l’Enseignement des Gurus. Une famille peut tout à fait installer le Guru Granth Sahib chez elle dans une pièce de la maison réservée à cet effet, cette pièce devient alors un Gurdwara. Pour que l’assemblée des fidèles puissent se réunirent en grand nombre, de grands Gurdwara ont été construits en Inde et dans le monde entier, là où la communauté sikhe s’est établie.
La fonction principale du Gurdwara est donc de fournir à la communauté un lieu de prière où l’on reçoit l’enseignement des Gurus à travers la lecture des paroles contenues dans le Guru Granth Sahib : les Gurbani. On y chante aussi les hymnes tirés du Livre Saint.
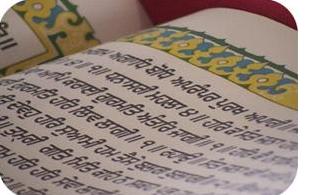
Une page du Guru Granth Sahib
Le Gurdwara est un lieu ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de religion, de sexe, de classe sociale. Dans la maison du Guru, nous sommes tous égaux. Lors de sa venue au temple, le fidèle ou le simple visiteur doit se couvrir la tête et se déchausser avant d’entrer. Il n’y a pas de clergé dans le sikhisme et toute personne respectueuse de la foi sikh peut venir chanter les hymnes, participer à la vie du temple, et toute personne pouvant lire le Gurmukhi, écriture dans laquelle est écrit le Livre Saint, peut lire le Guru Granth Sahib. Cependant, tous les Gurdwaras emploient un prêtre, appelé Granthi, cette personne est complètement dévouée à l’entretien du Gurdwara et c’est lui qui conduit les différentes cérémonies. Le Granthi peut être une femme même si cela est assez rare. La femme dans la religion sikhe a la même place spirituelle et sociale que celle de l’homme et dans le Gurdwara elle a les mêmes droits et elle peut participer à toutes les activités du temple.

Jeunes sikhs chantant des Kirtans et jouant d’instruments traditionnels
C’est l’argent versé régulièrement par les fidèles qui finance les frais du Gurdwara, cette obligation de donner une partie de ses ressources est un élément très important dans la foi sikhe et se nomme Wand chakna.
Un groupe de quelques personnes s’occupe de gérer les différentes fonctions et activités du Gurdwara (l’administration, la trésorerie, la maintenance…). Ces comités sont formés par des membres de la communauté.
Les activités quotidiennes du Gurdwara commencent tôt le matin, dans certain temple à deux heures du matin, parfois plus tard. Le Guru Granth Sahib est porté de la pièce où il réside la nuit, appelée Sachkhand, pour être installé dans la salle principale du temple. Cette cérémonie est appelée Prakash, ce moment correspond à la première ouverture du livre sacré de la journée. L e Guru Granth Sahib est l’élément principal du Gurdwara, et une attention particulière est donnée à l’emplacement où il réside durant la journée. Le Livre saint est recouvert de tissus et repose sur des coussins, le tout étant installé sur une sorte d’estrade surmontée d’un dé de tissu. Ensuite les prières du matin sont récitées et un passage du Guru Granth Sahib est lu, cette parole est appelée HUKAMNAMA. Chaque matin c’est un nouveau Hukamnama qui est lu. Le Hukamnama est une prière, un commandement à méditer pour la journée. Le visiteur reçoit des mains du Granthi ou d’un Sevadar (personne offrant ses services occasionnellement ou régulièrement et de façon spontanée pour la réalisation des diverses activités du temple) le Karah Parshad (offrande, préparée avec du sucre, de la farine et du beurre).
Tout au long de la journée et tous les jours de l’année, les fidèles et toute personne non sikh peuvent venir se recueillir dans le Gurdwara pour quelques minutes, simplement pour s’incliner respectueusement devant le Guru Granth Sahib ou rester plusieurs heures, ou prendre en repas dans la cuisine communautaire ouverte à tous, le Langar. A la tombée de la nuit, Rehras Sahib, la prière du soir est récitée, elle est souvent suivie de chants, des Kirtans, puis la journée s’achève avec la cérémonie appelée Sukhasan, durant laquelle le Guru Granth Sahib est reconduit dans sa pièce pour y reposer pendant la nuit.

Cérémonie de Sukhasan
On reconnait la présence d’un Gurdwara par la présence d’un drapeau triangulaire orange (le Nishan Sahib) qui flotte en haut d’un haut mât, planté prés de chaque temple.
Pour la communauté sikhe, le Gurdwara n’est pas seulement un lieu de culte c’est aussi un lieu qui joue un rôle social important et notamment pour les communautés installées à l’étranger. En occident, les familles s’y retrouvent surtout le dimanche, jour de congés pour tous. Les enfants peuvent étudier le Punjabi et recevoir un enseignement religieux. Les femmes s’y retrouvent pour faire du Seva (service désintéressé), lire et réciter ensemble des prières, échanger entre elles sur leur quotidien. De nombreux membres de la communauté viennent prendre quotidiennement un repas dans le Langar. Le Gurdwara est aussi un lieu d’accueil pour les visiteurs de passage qui peuvent y passer une nuit ou deux, ce service d’hébergement est offert dans les Gurdwara disposant de chambres prévues à cet effet.

Le Langar, la cuisine communautaire.
La communauté sikhe installée en France attend beaucoup de ce nouveau Gurdwara
Il devrait offrir, en plus de la salle de culte proprement dite, une bibliothèque, un centre culturel et bien entendu un Langar. Ce nouvel espace permettra à la communauté d’organiser et de développer de nouvelles activités religieuses et culturelles, ce qui devrait lui offrir une meilleure visibilité et faciliter les rencontres avec les personnes désireuses de mieux connaitre ou de découvrir la religion sikh et la culture Punjabi.
Raphaëlle Sundri KAUR

Groupe Inter-religieux pour la Paix 93
Saint-Denis 15 janvier 2008
Interreligieux et laïcité
Feuille de route pour une action commune
Religion et laïcité ne sont pas incompatibles, à condition de s’entendre sur le contenu des termes.
Les religions sont liées structurellement à l’absolu de Dieu. C’est pourquoi elles se prêtent à toutes les entreprises de récupération idéologique. Il y a donc une distinction à faire entre la dynamique religieuse elle-même et les usages détournés que l’on en fait, qui sont des perversions.
La perversion de la religion est dans sa réduction à une fonction strictement utilitariste au plan humain :
- pour les puissants, la religion ne peut pas être une légitimation du pouvoir en vue de la réalisation d’ambitions personnelles ;
- pour les pauvres et les faibles, la religion ne peut pas être une consolation illusoire qui incite à l’acceptation de conditions de vie indignes ;
- pour les craintifs, la religion ne peut pas être un réconfort sécurisant qui conduise au repli dans des groupes fermés, hostiles à toute altérité ;
- pour l’intelligence, la religion ne doit pas être un carcan intellectuel qui empêcherait l’homme de prospecter dans tous les domaines inconnus du savoir ;
- pour la volonté, la religion ne doit pas être un obstacle à la créativité, empêchant l’homme de gérer l’univers et d’aménager ses conditions d’existence ;
- pour tous, la religion ne doit pas être un étouffoir d’humanité en se réduisant à la compensation sacralisée d’une frustration.
Et pourtant, par sa référence à une altérité radicale, la religion interroge l’homme en profondeur dans sa volonté de puissance, ses limites, ses peurs, ses relations à l’autre et au monde, sa capacité à connaître et à maîtriser ses conditions de vie. Mais nous pensons que la religion n’est à la hauteur de sa réalité que lorsqu’elle se fait interrogation suggestive plutôt que censure et interdit.
D’un mot : la religion se pervertit lorsqu’elle s’érige en instance de pouvoir et de contrôle immédiat des conduites individuelles et collectives. Au contraire, la religion est fidèle à elle-même et au Dieu auquel elle renvoie lorsqu’elle se présente à l’homme comme force de proposition et suggestion de sens, à niveau personnel comme au plan relationnel. La dimension institutionnelle de la religion est au service de cette force de proposition et ne peut aller au-delà. Nous pensons que la normativité religieuse ne découle pas du corps religieux lui-même, mais seulement de la personne qui, face à la proposition de sens qui lui est faite, prend la liberté de se déterminer raisonnablement elle-même en fonction de ce qu’elle estime juste.
C’est en cela que la religion n’est pas antinomique par rapport à la laïcité.
Car dans le cadre de la laïcité, l’Etat ne nie pas le fait religieux en tant que tel, mais décide de ne reconnaître et de ne financer aucun culte, tout en réaffirmant la liberté de pensée, d’expression, d’association et de culte. La laïcité pose ainsi un principe d’indépendance de la société dans son travail d’organisation et dans son devenir collectif. En même temps, la laïcité garantit aussi la liberté individuelle en faisant barrage à l’ingérence directe du religieux dans la vie sociale : nul ne peut être inquiété ou subir de contraintes pour des questions religieuses.
Cependant, la séparation de l’Eglise et de l’Etat s’est produite à un moment historique où tous les membres de la société, religieux ou laïques, participaient de la même manière à des réseaux de sens collectifs et structurants. Qu’il s’agisse de la religion, de la patrie, d’un idéal de classe sociale ou d’un idéal de prospérité matérielle, il était entendu que la vie individuelle ne pouvait avoir de sens qu’au regard d’une destinée collective, quelle qu’elle soit. La valeur de l’individu était dans sa capacité d’agréger ses propres richesses personnelles à un ensemble qui le dépassait. Il y a plus dans le « tous » que dans « l’unique ». C’est le fondement de la démocratie au plan politique et de la cohésion sociale au plan national.
Or aujourd’hui, nous sommes sortis du monde fédérateur que constituaient la chrétienté et les grandes idéologies porteuses. L’épanouissement individuel concurrence directement l’utilité publique. L’intérêt individuel prédomine et s’exprime de manière ambivalente : dans le registre de la puissance, chacun voudra convaincre l’autre de son génie propre dans un domaine particulier, fût-il des plus restreints. Chacun rêve d’accéder à une position monopolistique par rapport à autrui. Dans le registre de la frustration, chacun revendiquera pour soi-même un statut de victime innocente et impuissante, comme pour mieux légitimer l’élimination de l’autre, diabolisé en bourreau coupable et tout-puissant. Le narcissisme de chacun postule ainsi la présence de l’autre, requis comme témoin du triomphe de la puissance individuelle ou de l’innocence de l’impuissance individuelle ou d’un groupe particulier. Le besoin de l’autre à des fins narcissiques est aujourd’hui le seul rempart contre l’éclatement social. Car en dehors de cet « usage » réducteur, l’autre n’est plus qu’un concurrent à éliminer.
Dans ce contexte largement conflictuel, la laïcité a sainement posé en France un principe de tolérance et de respect de chacun qui sauve théoriquement la culture de tout arbitraire idéologique et de toute violence individuelle. La laïcité se présente en cela comme un cadre juridique neutre garantissant à tous des conditions de vie possibles. Mais devant la fuite en avant de l’individualisme le plus exacerbé, devant la frénésie du gain, du matérialisme et du consumérisme, la laïcité, en raison même du cadre de neutralité idéologique qu’elle impose, semble mal outillée pour proposer des modèles renouvelés de valeurs individuelles et plurielles, aptes à produire de nouvelles synergies au cœur même de nos cultures diversifiées.
C’est à ce niveau que la religion peut avoir un rôle à jouer, à la condition impérative que ce rôle soit différent de celui du passé. Entre le contrôle omniprésent de la religion sur la société et la simple relégation du religieux dans la sphère du privé, n’y a-t-il pas de place pour une tierce voie constructive pour tous ? Nous pensons en particulier que l’interreligieux a modestement une carte à jouer puisque le dialogue interreligieux développe structurellement l’ouverture aux modes de pensée et de pratiques des autres traditions, dans une confrontation respectueuse, à la fois gratifiante et exigeante.
Nous pensons que la paix ne pourra se construire qu’en oeuvrant concrètement dans le sens de l’évolution qui se dessine. Nous pensons aussi qu’à niveau fondamental, la paix ne triomphera pas d’une lutte ouverte contre les forces contraires. Le bien ne doit pas se faire plus fort que le mal. Car dans une dialectique d’opposition frontale, chacun des opposants finit par faire sienne la stratégie de domination violente du mal. Il ne s’agit donc pas de con - vaincre l’autre à coups d’arguments probants, mais de s’investir concrètement dans un travail positif et constructif. Et ce travail commence par la conversion de son propre regard sur la réalité de l’autre. Car ce serait trop peu encore que de reconnaître le droit de l’autre à l’existence. Il faut aller jusqu’à faire renaître en soi l’estime pour l’autre par la reconnaissance assumée de sa particularité, de son mérite, de son honnêteté. Cela suppose que les uns et les autres travaillent durement à l’assainissement de leur propre démarche. Sur ce chemin, on ne peut qu’avancer ensemble, et au rythme du plus lent et du plus faible. Le plus violent est en réalité le plus faible et le plus lent. Mais à travers et au-delà de sa violence, c’est la part de dignité de l’autre qui doit être entendue et reconnue.
C’est dans cette perspective que le GIP 93 souhaite entreprendre une action modeste auprès des jeunes, en collaboration avec les réseaux scolaires existants.
Il ne s’agit pas de prêcher une idéologie de la paix, et certainement pas une idéologie religieuse, fût-elle positive dans son intention. Cette tentative relèverait encore de la perspective religieuse ancienne d’influence directe sur les consciences au nom d’une certaine idée du bien collectif.
Il s’agit de proposer des thématiques de réflexion susceptibles de produire de la créativité expressive et artistique. Et nul ne peut préjuger à l’avance ni de la forme, ni du contenu des œuvres à produire.

Enquête en vue du colloque :
"Nos valeurs et notre identité européennes communes"
Rovereto (Italie) 22-25 mai 2008
A tou(te)s celles et ceux qui pratiquent le dialogue interreligieux, qui s’y intéressent ou qui veulent s’exprimer sur le sujet,
Religions for Peace Europe, qui fédère les différentes associations européennes de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix, dont la section française (le présent site), est co-organisatrice d’un colloque à Rovereto en mai 2008, dont l’intitulé figure au-dessus.
Afin de préparer cette rencontre, les organisateurs s’adressent à vous pour réaliser une enquête.
Pour télécharger un exemplaire de notre questionnaire sur lequel vous pourrez écrire vos réponses, cliquez ici.(enregistrez sur disque).
Merci pour vos suggestions et le temps que vous prendrez à répondre à ces questions.
1) Pour vous qu’est-ce qu’une valeur ?
1.1. Dans le sens général ?
1.2. Y a-t-il selon vous des valeurs spécifiquement religieuses, et si oui lesquelles ?
2) Quelles sont les valeurs qu’évoque ce titre Nos valeurs et notre identité européennes communes ?
2.1. Sont-elles trop abstraites ?
2.2. Sont-elles trop nombreuses ?
3) Quelle est l’importance et « la valeur » des valeurs ?
Sont-elles simplement des beaux sentiments que personne ne contesterait, sont-elles si banales dans leur universalité, pour être finalement sans signification, vides, gentillettes ?
4) Les valeurs conduisent-elles à des actions, des listes de droits humains, des lois, des credos quand elles acquièrent un sens ?
5) Les valeurs sont-elles spécifiques à des communautés ?
6) Les religions ont-elles les mêmes valeurs ?
7) Toutes les personnes de bonnes volonté, quelle que soit leur foi, ont-elles les mêmes valeurs ?
8) Les valeurs sont-elles spécifiques à une culture ? A une région ?
9) Quel est le lien entre les valeurs et l’identité ?
Cette enquête vous laisse libres de répondre nominalement ou pas, en choisissant d’indiquer votre religion ou pas, et de même le type de dialogue que vous pratiquez, le cas échéant.
Vous pouvez répondre jusqu’au 15 janvier 2008.
Pour cela, envoyez le questionnaire rempli à l'adresse suivante :
questionnaire.valeurs@yahoo.fr
Vous pouvez répondre aussi longuement que vous le souhaitez.
Les résultat de cette enquête pan-européenne figureront dans une brochure intitulée “Towards Building Our Common European Values and Identity”
(Vers la construction de nos valeurs et de notre identité européennes communes).
Merci beaucoup pour vos réponses.
------------------------------------------------
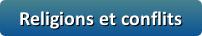
ISRAELIENS ET PALESTINIENS
« D’UNE SEULE VOIX, LA TOURNEE FRANCAISE »
Projection du film et concert exceptionnel au conservatoire de Sarcelles.
L’association sarcelloise d’amitié franco-algérienne (l’ASAFA), le consistoire israélite d’Ile de France de sarcelles et la ville de Sarcelles sont heureux de présenter la projection événement du film
« D’une seule voix "pour la paix
ainsi que deux artistes venu d’Israël « Hezy Levy »
et de Palestine « Atef Okasha ».
Du 14 au 31 mai 2006, « D’une seule voix » réunissait une centaine de musiciens israéliens et palestiniens dans toutes les grandes villes de France pour une série de quatorze concerts exceptionnels pour un même message de dignité, de respect mutuel et d’espérance.
Il s’agissait pour eux de présenter au public français une autre image que celle de la violence et de la haine, généralement associée au Proche Orient, de montrer et de démontrer l’existence d’une autre réalité. De ce point de vue, la culture, tout particulièrement la musique, langage universel, tient un rôle de tout premier plan.
Un DVD présente la tournée « D’une seule voix », dans un document filmé comprenant des captations de différents concerts et des moments de la vie des musiciens (filmés en France mais également en Israël et dans les Territoires palestiniens). Il permet de faire partager ce témoignage artistique et humain - et de le faire vivre.
Aujourd’hui, les organisateurs de cette tournée, Anne Dieumegard et Jean Yves Labat de Rossi (ainsi que le réalisateur de ce film Xavier de Lausanne), vous offre 58 minutes de ce grand moment à travers une projection à sarcelles :
Le Dimanche 2 Décembre 2007 à 15h. (Entrée gratuite)
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (avenue pierre Langevin 95200 Sarcelles)
Après cette projection, Mr Labat de Rossi et Mme Dieumegard répondront aux questions et nous feront part des détails de cette rencontre multiculturelle autour d’une collation.
Contact:
Leila Abdiche
06 25 59 80 82
leila.abdiche@hotmail.fr

L'Association "ARTISANS DE PAIX"
TRAVAIL INTERSCRIPTURAIRE 2007 - 2008
En complément du cycle de conférences sur « La prière des Artisans de paix », nous vous proposons de vous engager cette année, dans un travail interscripturaire confrontant nos textes fondateurs à partir de l’originalité de notre projet ; lequel puise sa force dans l’inspiration du Sinaï. C’est cette inspiration qui a animé notre recherche à travers nos cycles de conférences inaugurés en 1997. Elle habite « La prière des artisans de paix » explorée cette année à partir de trois orientations. S’acheminer aux frontières évoque le passage du Buisson ardent au Sinaï opéré par Moïse avec la révélation du Nom imprononçable de Dieu. Entendre la voix du silence semblable à un souffle, rappelle la révélation faite à Elie sur le Mont Horeb qui est une autre appellation du Mont Sinaï. Accueillir l’événement signifiant avec lequel chacun prend corps selon le nom propre qui est le sien et donne ainsi consistance au monde, relève de la mémoire de la transfiguration. Nous explorerons ces pistes dans la vie quotidienne qui est la nôtre, mais aussi à partir de nos textes fondateurs.
Nos rencontres interscripturaires auront toutes lieu
au Centre Sèvres, 35bis rue de Sèvres, 75006 Paris, de 17 heures à 20 heures.
A chaque réunion, nous serons invités à laisser résonner les textes proposés à l’étude, avec ceux de nos traditions respectives. Le dialogue sera largement ouvert.
1.Notre première réunion aura lieu le
Mardi 30 janvier 2007, salle 7.
Raphaël Draï nous proposera un découpage de textes bibliques et une méthode pour travailler le passage
« Du Buisson ardent au Sinaï ».
2.Notre seconde réunion est prévue
Mardi 27 février, salle 1.
Mahmoud Azab (égyptien, Al Azhar) comparera le récit coranique du Mont Sinaï avec celui de la Bible où il est question de Moïse et d’Elie), sans oublier la dimension archéologique des lieux.
3.Notre troisième réunion aura lieu
Mardi 24 avril 2007, salle 7.
François Marty nous proposera alors un découpage de textes et une méthode pour travailler
« Les récits évangéliques de la Transfiguration ».
4.Notre quatrième réunion sera
Mardi 15 mai, salle 7.
Nous approfondirons le travail entrepris le 24 avril avec des bouddhistes.
Nous aurons quatre autres rencontres interscripturaires en 2008, aux mêmes mois.
Nous espérons qu’à partir de l’exploration interscripturaire de l’inspiration du Sinaï en groupe interreligieux, interdisciplinaire et international, émergera une polyphonie de nos traditions, inaugurant une anthropologie nouvelle, créatrice de paix comme l’a exposé notre amie Tania (verso).
L’assiduité aux quatre réunions est souhaitable. C’est pourquoi nous demandons aux personnes désirant s’engager dans ce travail, de communiquer leur nom, soit par courrier électronique adressé à
paula.kasparian@noos.fr , soit par courrier postal adressé à notre président, M. Edmond Lisle, 11 rue Férou, 75006 Paris.
A bientôt la joie de travailler ensemble.
Paris le 22 novembre, Paula Kasparian

La fête de Baïsakhi
Le jour de Baïsakhi, la fête des moissons qui annonce le retour du printemps, est un des évènements les plus importants chez les Sikhs, elle est célébrée essentiellement au Punjab mais aussi dans toutes les régions du monde où la confrérie est présente. Pour remémorer la création de l’Ordre des Purs par leur 10ème gourou, les Sikhs se rassemblent pour prier et organisent des processions.
Une fois que la pureté de l’âme entraîne la piété de l’esprit et que la compassion et la bonté motivent tous les actes du corps, alors l’état de Khalsa est parachevé chez un(e) Sikh.Nous définissons en effet notre Foi comme : « la fraternité des hommes sous la paternité de Dieu »
C'est en 1699 que notre dixième Gourou reçut l'inspiration divine d'instiller sa conception du courage et de l'abnégation dans le cœur de tous les Sikhs et de les doter d'un code de vie qui les incite pour toujours à défendre la liberté à respecter l’égalité et à pratiquer la fraternité .
En même temps il donna à la Khalsa une identité unique, indiscutable, et distincte : le Bana, l'habillement et la coiffure des Sikhs qui comprend cinq emblèmes de pureté et de courage. Ces symboles, portés par tous les Sikhs baptisé des deux sexes, sont universellement connus aujourd'hui comme les cinq K: Késh, cheveux et barbe non coupés; Kangha , le peigne en bois; Karra, le bracelet de fer; Kirpan, l'épée ou dague; et Kachera, les sous-vêtements.
Tous les sikhs, hommes et femmes, peuvent ainsi vivre une vie faite de courage, de décence, d'abnégation et d 'égalité.
Au cours des deux guerres mondiales du siècle dernier, 83000 sikhs furent tués et 110 0000 blessés. Ils avaient choisi de se battre pour la liberté des peuples du monde sans autre protection que leur Turban.
Les sikhs respectent toutes les croyances autant que l’absence de croyance. Ils considèrent que l’humanité toute entière ne forme qu’une seule famille en esprit. Aussi toutes celles et tous ceux qui souhaitent se joindre aux festivités que nous organisons aujourd’hui sont les bienvenus.
« Seigneur, béni sois-Tu, aide nous à nous élever au-dessus des nuages. Donne nous la force spirituelle de vivre dans la lumière pour que nous puissions servir humblement et toucher le cœur de tous. Pour que nous puissions dédier cette vie à Ta lumière et à Ton Verbe , donne nous la force de demeurer dans l’authenticité et la compassion. En ce jour anniversaire de la naissance du Khalsa, accorde nous la capacité d’exprimer notre hospitalité, en toute humilité et dans l’esprit de service, afin que nous assistions l’humanité en Ton Nom, dans Ta Grâce et dans Ta lumière »
WAHE GURU JI KA KHALSA WAHE GURU JI KI FATEH
Notre pureté appartient à Dieu. Notre victoire appartient à Dieu
Gurdwara Singh Sabha Paris
16-18, Rue de la Ferme, 93000 BOBIGNY
Tél : 01.41.50.28.25

Derniers textes publiés
- Huitième Assemblée Mondiale de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix à Kyoto – 2006 :
Femmes de Foi.
Compte-rendu de l'Assemblée.
Déclaration finale de 800 responsables religieux du monde entier.
Déclaration de jeunes croyants à Hiroshima.
Reportage sur l'Assemblée.
- Rencontre des responsables religieux irakiens à Oslo par le Secrétaire Général de la WCRP.
- 20e Anniversaire de la rencontre d'Assise, 1986 – 2006
Exposé de Madame Jacqueline Rougé, présidente honoraire de la CMRP.
Engagement des religions pour la paix; le "décalogue" d'Assise.
Anniversaire d'Assise dans les groupes régionaux :
à La Roche-sur-Yon et aux Sables d'Olonne.
à Versailles
- A l'abbaye de Saint-Jacut :. Colloque inter-religieux.
Compte-rendu du colloque sur la transmission
Texte d'entrée en Shabbat, par Philippe Haddad
Témoignage de Jean-Marc Aveline : la mémoire et l'abandon.
Débat en présence de Régis Debray et Claude Geffré , à propos de leur dernier ouvrage commun : Avec ou sans Dieu ?
- Meilleure connaissance des religions : Baïsakhi, fête des Sikhs.

CYCLE DE 8 CONFERENCES
le premier mardi du mois (sauf en avril et mai)
Institut Catholique de Paris,
21 rue d'Assas,
18 - 20h - Salle B01
“ Nous célébrons cette année le XXème anniversaire de la Rencontre interreligieuse de Prière pour la Paix, voulue par mon vénéré prédécesseur, Jean-Paul II, le 27 octobre 1986, dans cette ville d'Assise. Comme on le sait, il invita à cette rencontre non seulement les chrétiens des diverses confessions, mais également des représentants des diverses religions. L'initiative eut un large écho dans l'opinion publique : elle constitua un message vibrant en faveur de la paix et se révéla être un événement destiné à laisser une trace dans l'histoire de notre temps. On comprend donc que le souvenir de ce qui eut alors lieu continue de susciter des initiatives de réflexion et d'engagement. (…) Ces initiatives, chacune selon sa nature spécifique, mettent en évidence la valeur de l'intuition qu'a eue Jean-Paul II et en révèlent l'actualité à la lumière des événements mêmes qui ont eu lieu au cours des vingt dernières années et de la situation dans laquelle se trouve à présent l'humanité. ”
Lettre du pape Benoit XVI à l'évêque d'Assise à l'occasion du 20ème anniversaire de la rencontre de 1986
La dimension religieuse des événements qui font l'actualité ne peut plus échapper à personne. La rencontre d'Assise en 1986 a eu une portée symbolique considérable : à l'invitation de Jean-Paul II, des responsables de nombreuses religions et traditions spirituelles s'étaient retrouvés afin de prier ensemble pour la paix. Depuis, les conflits n'ont pourtant pas manqué, trop souvent interprétés comme un " choc des civilisations " alors qu'il s'agit plutôt d'un choc des ignorances, ou d'instrumentalisations politiques de la religion. 20 ans après Assise où en est la rencontre interreligieuse ?
Quelles sont les avancées, les échecs, les nouveaux défis ?
Huit spécialistes font le point dans ce cycle de conférences mensuelles proposées par l'ISTR.
Mardi 7 novembre 2006
Où en est la rencontre entre Juifs et Chrétiens ?
Geneviève COMEAU, Centre Sèvres
Mardi 5 décembre 2006
Où en est la rencontre entre Musulmans et Chrétiens ?
Henri de LA HOUGUE, Directeur du CPIC, ISTR
Mardi 9 janvier 2007
Où en est la rencontre entre Bouddhistes et Chrétiens ?
Dennis GIRA, Directeur-Adjoint de l'ISTR
Mardi 6 février 2007
Où en est la rencontre entre Hindouistes et Chrétiens ?
Mgr Félix MACHADO,
Sous-Secrétaire du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux
Mardi 6 mars 2007
Quelle présence des religions en Chine ?
R.P. Michel MASSON s.j., Directeur de l'Institut Ricci
Mardi 24 avril 2007
Quelle rencontre avec les Religions Traditionnelles Africaines ?
P. René TABARD c.s.sp.
Mardi 15 mai 2007
Où en est-on de la théologie de la Mission ?
P. Christophe ROUCOU, de la Mission de France,
responsable du SRI (Service des Relations avec l'Islam)
Mardi 5 juin 2007
20 ans après Assise, où en est la Théologie chrétienne des Religions ?
R.P. Claude GEFFRÉ o.p.
INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Institut de Science et de Théologie des Religions - ISTR
21 rue d'Assas 75270 Paris cedex 06
Contact et inscriptions : 01 44 39 84 80 - istr@icp.fr , www.icp.fr
Ensemble du cycle : 50 €. Chaque conférence : 10 €
----------------------------------------------------------

Les religions monothéistes et leur Livre
par Pierre Hoffmann
Les médias utilisent souvent l'expression "les religions du livre" pour désigner le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam : cette expression est-elle pertinente ? Rend-elle compte d'une réalité souvent plus complexe ? Le singulier signifie-t-il qu'il n'y a qu'un seul Livre pour les trois religions, ou que chacune se réfère à son Livre propre ? Elle semble faire écho à l'expression coranique "les gens du Livre", pour parler des juifs et des chrétiens. De quel Livre parle le Coran ?
L'Islam et le Livre :
L'Islam affirme que Dieu a "fait descendre le message" d'abord sur Moïse avec la Thora, ensuite sur Jésus avec l'Évangile, enfin sur Mohamed avec le Coran (Sourate V 44,46,48). Ce message est la transcription de "la Mère du Livre" (Sourate XIII 39), une table écrite conservée auprès de Dieu (Sourate 85 22). Il y a donc bien un seul Livre donné aux croyants qui se réfèrent à Abraham. Dans ce cas, pourquoi le Livre n'est-il pas commun à tous les croyants ? Parce que les juifs puis les chrétiens ont, par la suite, déformé le message de Moïse et de Jésus (Sourate VII 162). Seul le Coran transcrit fidèlement, aujourd'hui, dans la langue de la Révélation, l'arabe, les Paroles et la Pensée de Dieu. On explique ainsi la place reconnue aux juifs et aux chrétiens, gens du Livre eux aussi, dans les terres d'Islam, malgré les déficiences de leur foi.
Le Judaïsme et la Thora :
Certaines affirmations du Coran se trouvent dans la tradition juive. Ainsi, les Tables de la Loi du Sinaï sont-elles la transcription fidèle des Paroles de Dieu (Exode 32,16). La Thora est même la première chose que Dieu a créée avant la Création du Monde. Depuis toujours, la Thora est auprès de Dieu (Genèse Rabba 1,4). Cependant, le judaïsme distingue la Thora écrite et la Thora orale, transmises l'une et l'autre à Moïse pendant les 40 jours qu'il resta en haut du Sinaï. Moïse transmit la Thora orale à ses successeurs (Avot 1,1). Certains pensent même que la Thora orale est plus importante que la Thora écrite, car cette dernière ne peut se comprendre sans la première. Le rapport à la Thora, Livre du Judaïsme, n'est pas de même nature que le rapport du croyant musulman au Coran, même si le Coran a également ses interprètes. Mais dans le Judaïsme, l'interprétation, aussi, vient de Dieu.
Le Christianisme et la Bible :
Le christianisme reconnaît l'autorité de la Bible juive à laquelle s'ajoute ce qu'il est convenu d'appeler le Nouveau Testament (gestes et paroles de Jésus, écrits de circonstances particulières et vision mystique de l'Apocalypse). Comme le Judaïsme, le Christianisme donne autorité à l'Écriture et à la Tradition. Dieu n'en est pas l'auteur direct, mais son Esprit inspire les auteurs humains. D'où l'existence de quatre évangiles, puisque ce sont des témoignages, inspirés certes, reflétant la Parole de Dieu, mais qui sont aussi des "rédactions" humaines. L'Écriture et de la Tradition ont une source commune en Jésus, reconnu Christ et Seigneur. Pour la foi chrétienne, la Parole de Dieu n'est pas d'abord transmise dans un écrit : elle s'est faite humanité en Jésus de Nazareth. Il n'y a pas une écriture qui serait depuis toujours auprès de Dieu : cette place revient à la Parole qu'est le Christ (Jean 1,1). Les traductions ont toujours été permises et les variantes qui en ont résulté n'altèrent pas l'essentiel de la Parole de Dieu qui n'est accessible qu'à travers la personne de Jésus-Christ.
Ainsi, on ne peut dire que ces religions sont celles d'un seul et même Livre, sauf à adopter le point de vue de l'Islam. Chacune a son propre Livre, et elles ne s'y réfèrent pas de la même manière. Afin d'éviter des quiproquos, il est utile d'en prendre conscience et de poursuivre, sur ce sujet, un échange toujours bénéfique entre croyants.
Pierre Hoffmann

Le M.I.R.C
organise un cycle de rencontres sur
Le GROUPE DES DOMBES.
I.- "Les origines et l'abbé Paul Couturier", le vendredi 31 mars;
II.-"Du début jusqu'au Concile Vatican II"; le vendredi 28 avril;
III.-"La période récente", le vendredi 12 mai;
IV.- le mercredi 7 juin, avec la participation du père Bernard SESBOUE, s.j. et du pasteur Michel LEPLAY, anciens co-présidents.
Thèmes :
la session de l'été 2005,
le dernier document publié "Un seul maître",
la situation actuelle et les perspectives d'avenir.
de 18 h à 20 h à l'Espace Bernanos - Auditorium -
4, rue du Havre - 75009 Paris
Entrée libre - participation souhaitée
Les trois premières séances du cycle "Groupe des Dombes" se sont déroulées devant un auditoire fidèle, en présence de religieux et théologiens catholiques et protestants qui ont pris une part active aux débats. L'historique a permis de retracer les origines protestantes et anglo-saxonnes du mouvement pour l'unité des chrétiens, la vie et l'engagement de l'abbé Couturier, le démarrage du Groupe avec des catholiques lyonnais et des pasteurs suisses puis le travail de +en+ approfondi du Groupe... jusqu'au dernier document publié pendant la Semaine de l'unité de janvier 2005 "Un seul maître", objet de la prochaine rencontre du 7 juin, animée par le père jésuite Bernard Sesboüé et le pasteur Michel Leplay, anciens co-présidents.

Lire la Bible
à la lumière de la tradition juive
Une semaine de formation où des chrétiens expérimentent
la richesse de la bible lue avec des amis juifs et chrétiens
du jeudi 27 avril 2006 (18h)
au mardi 2 mai 2006 (16h)
à l’Abbaye de St-Jacut-de-la-Mer (22)
Semaine proposée par le SIDIC — Paris
Service Information Documentation Juifs Chrétiens
avec la participation d’amis juifs :
Rabbin Philippe Haddad, Michel Elbaz
et d’amis chrétiens :
Sœur Louise-Marie Niesz, Père Michel Berder,
Père Jean-Claude Bardin, Yvonne Schneider-Maunoury
PROGRAMME :
Jeudi 27 avril
Soir : Introduction à la semaine : Montage , « Le Pasteur Anslo » de Rembrandt
Vendredi 28 avril :
Matin : Lecture de textes du Nouveau Testament à la lumière de la tradition orale du judaïsme - Sœur Louise-Marie Niesz, nds
Après-midi : Travail de groupe sur textes et remontées en assemblée
Soir : Présentation des participants
Samedi 29 avril
Matin : Apports et limites de certaines lectures de la Bible
Père Michel Berder. La typologie et ses dérives vis-à-vis du peuple juif
La lecture historico-critique, ses apports et ses limites.
Après-midi : Travail de groupe sur textes et remontées en assemblée
Soir : « Entrée en Dimanche » et soirée festive
Dimanche 30 avril
Matin : Travail de groupe sur textes
Eucharistie dominicale
Après-midi : Une lecture juive de la Bible/ - Michel Elbaz
Soir : Film : « Les deux Témoins »
Lundi 1er mai
Matin : La Torah et les enjeux éthiques de la rencontre entre Juifs et Chrétiens /Rabbin Philippe Haddad et Père Jean-Claude Bardin :
La Torah nous oblige Juifs et Chrétiens,quelles pistes pour un engagement commun dans nos sociétés.
Après-midi : Travail de groupe sur textes et remontées en assemblée
Soir : Évaluation Projets d’avenir
Mardi 2 mai
Matin : Aux sources de la Liturgie :Pâque juive etPâques chrétiennes
Exode ch. 12 et Pessah aujourd’hui
par le rabbin Philippe Haddad
après-midi : Pâques et les récits de la Cène
par Yvonne Schneider-Maunoury
16h : Fin
Renseignements et inscription à :
L’Abbaye
BP 1 – 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tel. 02.96.27.71.19
Fax. 02.96.27.79.45
Courriel : abbaye.st.jacut@wanadoo.fr
Site : www.abbaye-st-jacut.com
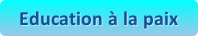
Commission Education à la Paix
Contact :
Mme. Marie LEMESLE : 01 39 38 02 14,
Mme Mehrézia MAIZA : 01 40 38 10 33
E-mail : tradlabidi.fib@wanadoo.fr
Chers amis,
Dans la suite de nos échanges dans le cadre des travaux de la commission éducation à la paix. Nous vous invitons à vous joindre à notre prochaine rencontre le
Dimanche 20 Novembre 2005 de 14h00 à 17h30 Au CISED (Asso. M de Certeau),
5 rue de liberté à St. Denis(Métro Saint-Denis Université)
Nous discuterons le thème suivant :
Les peurs qui traversent notre société
I – Objectifs de la rencontre :
Réfléchir sur la peur en examinant les racines de ce qui fait obstacle à la paix et au vivre ensemble et les remèdes spécifiques à l’interreligieux
2- Méthode :
Equilibrer entre le comportemental ; les témoignages et l’analyse théorique
3- Résultat concret :
Une fiche-outil
4- Questions à donner pour aider à la réflexion :
* quelle(s) peur(s) de l’autre en général ?
* quelle(s) peur(s) des religions en général ?
* quelle(s) peur(s) de la religion de l’autre ?
A faire passer à travers un questionnaire sur : les causes et origines de ces peurs
Les natures, formes et manifestations de ces peurs et leurs remèdes, actions et effet des religions face à ces peurs
Déroulement :
- 14h00 : Présenter brièvement les participants(tes) (surtout les nouveaux et nouvelles)
- 14H30 : Echanges par rapport aux questions préalables
- 14h45 : Organisation des réponses pour dégager les axes autour de l’interreligieux
- 15h30 : Témoignage de Denise Torgemane (Peurs, non-violence et interreligieux)
- 16H00 : discussion
- 17h00 : Synthèse
Pour confirmer votre participation, appelez
Marie : 01 39 38 02 14
Zia : 01 40 38 10 33 ou par courriel
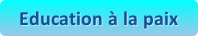
Commission Education à la Paix , Paris , 2005
Fiche établie par Marie LEMESLE et traduite en anglais par Mehrézia MAIZA
------------------------------------------------------------------------------------------
ECOLE PUBLIQUE ET PLURALITE RELIGIO-CULTURELLE
en France
------------------------------------------------------------------------------------------
CONSTAT ACTUEL
La société française actuelle est composée de citoyens de diverses origines, et notamment issus d’immigrations récentes ( Maghreb, Afrique Noire, Asie). La présence, la rencontre et la coexistence à l’Ecole Publique de jeunes de cultures variées et parfois héritières de conflits pose de nouveaux défis à cette institution qui repose sur une tradition de neutralité républicaine.
.
------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTS D’ANALYSE
Quelques repères historiques et institutionnels
- Depuis la Révolution (1789), l’Ecole a une mission d’instruction publique au service de la République, inculquant des valeurs avant tout de civisme et de morale laïque, c’est à dire universelle, a-religieuse et excluant les particularisme culturels régionaux ou autres ( voir les textes de Condorcet)
- Se développant en réaction contre l’emprise de l’Eglise catholique sur l’enseignement dans l’Ancien Régime, cette Ecole conçue comme libératrice reçoit son cadre juridique par la loi du 22 mars 1882 qui lui permettra d’asseoir, par la suite en référence à la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, sa neutralité au niveau des enseignants et des enseignements.
- La loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction du port par les élèves de signes ostensibles religieux s’inscrit dans cette logique égalitaire de refus de laisser s’introduire à l’Ecole des critères de distinction culturelle.
Aspirations nouvelles des usagers de l’Ecole Publique
- La mixité culturelle est souvent perçue par les enseignants comme un enrichissement humain
- Les élèves sont demandeurs et curieux de mieux connaître concrètement la culture des autres.
- La méconnaissance des repères culturels s’avère préjudiciable à la transmission de certains apprentissages
-L’ignorance par l’institution des pratiques et distinctions culturelles est souvent vécue comme du mépris voire de l’arrogance
-Les tensions internes au sein de la communauté éducative demandent des médiations culturelles d’apaisement ( travail sur les mémoires des peuples, enjeux des conflits internationaux)
Enjeux capitaux d’aujourd’hui
- L’Ecole n’est plus la source unique du savoir : médias et internet forgent aussi les consciences
- L’Enseignement public possède un potentiel inexploité d’ouverture à de nouveaux champs de la connaissance
- L’Ecole, en semblant fuir les rencontres qui l’interrogent, donne une image affaiblie de sa capacité à former des citoyens en prise sur la réalité
- Les valeurs universelles se trouvent dans de nombreux aspects culturels, d’où l’utililté de les dégager pour retrouver une appartenance humaine commune
- L’Ecole se doit d’être un rempart contre les réflexes identitaires et les dérives sectaires en donnant de ces déviations une lecture courageuse et claire.
------------------------------------------------------------------------------------------
AXES DU DEBAT
- Qui veut réfléchir ensemble à un nouveau projet de « vivre ensemble » républicain?
- Entre cultures et religions : n’est-il pas urgent d’approfondir les distinctions et les relations entre ces deux concepts ?
- L’Ecole Publique ne pourrait-elle pas reconnaître les religions comme des acteurs sociaux présents dans son environnement ?
- L’Ecole française ne risque-t-elle pas de se trouver en porte- à- faux avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ( 1973) ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Secrétariat de la CMRP 8 rue Jean Bart – 75005 Paris
01 46 33 45 39 cmrp.France@wanadoo.fr
Marie LEMESLE
Commission Education à la Paix
CMRP France
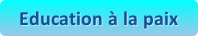
Commission Education à la Paix , Paris , 2005
Fiche établie par Marie LEMESLE et traduite en anglais par Mehrézia MAIZA
------------------------------------------------------------------------------------------
LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
en France
------------------------------------------------------------------------------------------
CONSTAT ACTUEL
Que le XXIème siècle s’ouvre sur un monde de banalisation de la violence, nul ne peut désormais l’ignorer, et l’engagement de l’UNESCO en faveur de la « promotion d’une culture de paix » pour la Décennie 2001-2010 a été suivi de nombreuses investigations et initiatives destinées à endiguer ce phénomène. La violence ambiante n’épargne pas l’Ecole, micro-société , laquelle apparaît encore démunie face à une jeunesse fascinée ou hypnotisée par le bruit et la fureur qui l’entourent.
------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTS D’ANALYSE
Les facteurs de violence environnementaux
- L’influence des médias, surtout TV et internet, sur les jeunes est évidente. Par le contact quotidien avec la violence d’images livrées de plus en plus à l’état brut (actualités ou fictions) selon des critères discutables (accumulation, multiplication, voyeurisme, recherche du sensationnel, manque de recul, brouillage des valeurs, inversion des repères etc.) se développent chez les plus fragiles une vision faussée de la réalité, une perception déshumanisée de la relation à autrui, une fuite dans le virtuel , à l’origine de conflits chez des jeunes en construction d’identité
- L’éclatement des structures familiales, le nomadisme lié à des conditions économiques fluctuantes, la ghetthoïsation urbaine ou rurale de populations tentées par le repli communautaire, l’appel tous azimuts à la surconsommation, à la dictature du paraître, à la revendication des instincts, autant de facteurs de déséquilibre d’ordre personnel et relationnel
- La disparition de modèles d’adultes effectivement engagés, responsables, constructifs, désintéressés, altruistes, favorise la perte de repères éthiques et éloigne d’une légitime quête de sens
- La dépendance aux drogues, jeux vidéos, lois des bandes sont tout à la fois causes et conséquences de la violence d’un environnement vain ou hostile
Les violences de l’institution scolaire
- Le schéma d’instruction traditionnel, hérité d’un autre âge, peu redéfini en profondeur malgré une multitude de pseudo-réformes, se révèle inadapté aux besoins réels des jeunes d’aujourd’hui : appel désuet au sens de l’effort, enseignements figés à dominante conceptuelle, absence de projets de réussite individualisés, prédominance du langage écrit, défaillance de la transdisciplinarité, uniformité nationale des programmes, univers clos sur lui-même
- Le manque chronique de moyens éducatifs adaptés à la réalité du terrain scolaire (aides-éducateurs, surveillants, infirmiers, médecins, psychologues, conseillers d’orientation, documentalistes, médiateurs) ne permet pas d’éradiquer en profondeur la violence verbale ou physique
Des atouts pour mieux vivre-ensemble
- Par vocation, l’Ecole reste un lieu privilégié de sociabilisation, de la découverte de soi et des autres, et la pluralité d’origines des élèves d’aujourd’hui va de pair avec leur sens de la solidarité
- La formation des esprits à la culture, à l’esprit critique, à la sensibilité artistique, à la connaissance scientifique, constitue un solide rempart contre la violence engendrée par la peur et l’ignorance
- L’éducation aux Droits de l’Homme, à la citoyenneté, au respect des minorités, aux valeurs républicaines de la laïcité et, bientôt, au fait religieux sont les atouts d’une éducation à la paix durable.
- Des pratiques et des actions concrètes de prévention et de médiation pénètrent à l’Ecole.
------------------------------------------------------------------------------------------
AXES DU DEBAT
- La paix à l’Ecole : quels partenaires de la société civile, quels défis, quels projets ?
- L’Ecole face à ses violences exogènes et endogènes
- Quel est le rôle, quelle est la part de chaque acteur de l’Ecole face à la violence quotidienne ?
-Parents et enseignants : face à la violence des jeunes, un même combat.
------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Secrétariat de la CMRP 8 rue Jean Bart – 75005 Paris
01 46 33 45 39 cmrp.france@wanadoo.fr
Marie LEMESLE
Commission Education à la Paix
CMRP France


DECEMBRE 2006
Dimanche 3 décembre 2006 - Fête chrétienne : Avent (4 dimanches avant Noël : 3, 10, 17, 24 décembre)
Les quatre semaines précédant Noël, connues sous le nom d'Avent, représentent le début de l'année liturgique et célèbrent la révélation de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ.
C'est un temps de grâce, de pénitence et de conversion que les chrétiens observent fidèlement pour préparer dignement l’avènement du Seigneur à Noël (le 25 décembre) et manifester l'attente de son retour.
Dimanche 3 décembre 2006 - Fête chrétienne : Présentation de la Vierge (calendrier julien )
Fête orthodoxe de la présentation de Marie au Temple de Jérusalem.
Mercredi 6 décembre 2006 - Fête chrétienne : Saint Nicolas
Autrefois évêque de la ville de Myra, située en Asie Mineure (Turquie actuelle), Saint Nicolas (270-310) serait décédé le 6 décembre. On célèbre la Saint-Nicolas ce jour-là. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Église Latine. Reconnu pour sa grande générosité, il devint, au Moyen Âge, le patron des petits enfants puis des écoliers. Il joue le rôle du Père Noël dans de nombreux pays du nord de l’Europe.
Vendredi 8 décembre 2006 - Fête bouddhique : Bodhi
Fête mahayana de l'éveil de Gautama devenu Bouddha (Éveillé) sous l'arbre de l'illumination.
Il demeura ensuite sept semaines sous cet arbre, éprouvant un grand bonheur.
Vendredi 8 décembre 2006 -Fête chrétienne : Immaculée Conception de Marie.
Fête catholique de Marie, conçue sans la marque du péché originel.
Dogme catholique défini par Pie IX en 1854-1863, après sa célébration régulière depuis le XIIIe siècle.
Samedi 16 décembre2006 - Fête juive : Hanoukkah (du 16 au 23 décembre).
Cette fête commémore la victoire en 164 avant JC des Maccabées sur l’armée du souverain syrien Antiochus IV qui avait conquis la terre d’Israël et voulait helléniser les juifs. Elle commémore aussi un miracle : une petite fiole d’huile sainte portant le sceau du Grand- prêtre avait été cachée dans le Temple. Profané puis libéré, ce dernier fut ré-inauguré. Versée dans la Ménora à l’heure de l’inauguration, cette huile dura miraculeusement huit jours. On célèbre ainsi la fête en allumant chaque soir pendant huit jours une bougie commémorant l’illumination renouvelée du Chandelier du Temple. Début de l'allumage de la première bougie, le soir du 25/12.
Cette fête vient rappelle aux Peuple juif la pérennité de l'aide Divine, de son attachement à la Torah, à ses Commandements et aux enseignements des Sages des générations passées. Jours de fête, de louange et de remerciements.
Dès le 25 au soir, Fête des Lumières; c'est la grande fête des enfants.
Mercredi 20 décembre 2006 - Fête zoroastrienne : Yalda ou Naissance de Mitra.
Yalda est une expression syriaque signifiant "naissance". Yalda, dieu de la clarté et de l'éclat, est la première nuit de l'hiver, la plus longue de l'année. Les journées s'allongent de plus en plus et la clarté du jour l'emporte sur l'obscurité de la nuit. Les iraniens ont, depuis plus de 25 siècles, célébré cette fête en ornant un sapin d'une étoile.
Jeudi 21 décembre 2006 - Fête shintoïste : Tohji-taisai.
Tohji-taisai ou Cérémonie du solstice d'hiver célèbre la joie de la fin de la période yin du soleil, lorsque sa force est en déclin, et le commençement de son pouvoir ascendant ou période yang. Le soleil est de grande importance au Japon. Il exprime la présence d'Amaterasu Omikami, le kami du soleil.
Dimanche 24 décembre 2006 - Fête juive : dernier jour d'Hanoukkha.
Lundi 25 décembre 2006- Fête chrétienne : Noël.
Grande fête de la naissance de Jésus, déjà célébrée dès le 24 au soir.
Noël célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes.
Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Ce nom même révèle son identité et sa mission, sauver les hommes et les conduire vers le Père.
Vendredi 29 décembre 2006 - Fête zoroastrienne : Zartusht-no Diso.
En Iran, mort de Zarathoustra.
Samedi 30 décembre 2006 - Fête musulmane : Waqfatul-Arafat ou veille au Mont Arafat .
Waqfatul Arafat est le dernier jour du grand pèlerinage et la veille de Aïd Al-Adha. C'est un moment essentiel du pèlerinage et un jour important de l'année. Ce jour-là, le mont Arafat et les collines qui l'entourent sont couverts de pèlerins vêtus de blanc en tenue de "Ihram" (purification de pèlerinage) venus de toutes les régions de la planète. C'est à cet endroit que le Prophète Mohammed a prononcé son dernier discours à sa communauté lors de son pèlerinage dit d'adieu (Hadjat Al-Wadae). Il a rappelé à ses fidèles les principes fondamentaux de l'Islam et leur a fait ses dernières recommandations.
Dimanche 31 décembre 2006 - Fête islamique : Aïd al-Adha / Aïd el-kebir [Date variable (1 à 2 jours) en fonction de l'apparition de la lune]
Fête du Sacrifice ou Grande Fête, qui commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham (Ibrahim) considéré comme le premier musulman, pour éprouver sa foi.
Cette fête est appelée également fête du Mouton en raison du sacrifice ordinairement pratiqué ce jour-là pour commémorer le sacrifice d'Ibrâhim. Elle symbolise, la foi et l'obéissance à Allah. Aïd al-Adha constitue également le couronnement du pèlerinage de la Mecque. Le grand pèlerinage prend fin à l'aube du jour de Aïd Al-Adha, dont la veille est le grand jour de Arafat. Les pèlerins sacrifient un animal - mouton ou chèvre - dans le village de Mina, entre Arafat et la Mecque. Tous les musulmans observent Eïd al-Adha qu'ils soient ou non en pèlerinage. Une part de la viande est distribuée aux pauvres.
Dimanche 31 décembre 2006 - Fête chrétienne : La Saint-Sylvestre.
Veille du jour de l'An, la Saint-Sylvestre commémore le pape Sylvestre 1er (314-335) sous le pontificat duquel l'Empire romain adopta le christianisme. On célèbre le dernier jour du calendrier civil.
Fêtes baha'ies omises dans le calendrier de novembre 2006. Avec toutes nos excuses !
Samedi 26 novembre 2006 Jour de l’Alliance,
Alliance de Dieu avec l'Humanité.
Lundi 28 novembre 2006 Ascension d’Abdu’l-Bahá
Commémoration de la mort d'Abdu'l-Baha, fils du Prophète-Fondateur de la foi Baha'ie. Il mourut à Haifa, en Palestine en 1921.
Pour compléments d'information : www.bahai.fr
N'hésitez pas à nous communiquer des renseignements ou des corrections sur vos fêtes religieuses!
Photo de Jean-Pierre Martin : Couleurs au Québec.
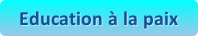
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix-Religions for Peace – France
Commission Education à la Paix , Paris , 2005
Fiche établie par Marie LEMESLE et traduite en anglais par Mehrézia MAIZA
--------------------------------------------------------------------------------
L’ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX
en France
--------------------------------------------------------------------------------
CONSTAT ACTUEL
En dépit de la pertinence et de l’impact du Rapport Régis Debray établissant la nécessité de développer L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque, l’Education Nationale a pris un nombre restreint de mesures en faveur de la diffusion de cet enseignement. Mais les élèves, parce qu’ils vivent à une époque en rupture avec des repères culturels stables, ont un besoin urgent d’être instruits sur lesreligions du monde en tant que composantes essentielles du patrimoine de l’humanité.
--------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTS D’ANALYSE
Un long processus de réflexion
-Il y a plus de 20 ans que des esprits avisés veulent remédier à l’absence de culture religieuse, source d’appauvrissement personnel et d’incompréhension sociale.
-Dès 1982, la Ligue de l’Enseignement envisage que « les religions fassent partie du champ des connaissances scolaires »(Assemblée Générale de Montpellier)
- Depuis 1986, l’histoire des religions est inscrite dans les programmes d’Histoire, ainsi que la lecture de textes fondateurs des religions dans les programme de Français
-Parmi les nombreux Colloques sur le sujet, celui de Besançon (1991) marque une étape décisive grâce à l’engagement et au Rapport du Recteur Philippe Joutard
-En Décembre 2001, le Ministre de l’Education Nationale Jack Lang confie à Régis Debray la mission qui aboutira en avril 2002 à la publication d’un rapport fameux
Une approche spécifique : un enseignement sur les religions ( et non des religions)
-Contrairement autres pays d’Europe et conformément à son éthique laïque ( Loi du 22 mars 1882), la France conserve un système éducatif excluant tout enseignement religieux ( sauf pour l’Alsace-Lorraine restée sous le régime du Concordat) et toute présence du religieux (Loi du 15 mars 2004).
-Dans l’Ecole Publique, le fait religieux est abordé uniquement dans le cadre d’autres enseignements (Lettres, Histoire-Géographie, Philosophie, Disciplines artistiques), avec une approche culturelle et distanciée, et sous l’angle de la connaissance et non de la croyance.
Une mise en œuvre incomplète
- Suite au Rapport Debray, Paris a vu la création de l’Institut Européen en Sciences des Religions dans le cadre de la Vème section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
- Chaque académie peut offrir des séances de formation au fait religieux, aux futurs enseignants ( dans les IUFM) et à ceux en poste (via le Plan Académique de Formation)
- Dans les établissements scolaires, l’introduction au fait religieux se fait sans programme défini, ponctuellement et à l’initiative d’enseignants volontaires, par exemple dans le cadre d’Itinéraires De Découvertes (au Collège), de Travaux Personnels Encadrés (au Lycée), de Clubs de Foyer Socio Educatif ou encore de divers projets de classes,
--------------------------------------------------------------------------------
AXES DU DEBAT
-En quoi l’enseignement du fait religieux est-il indissociable d’un enseignement de la laïcité ?
- Comment l’enseignement du fait religieux peut-il contribuer à la constitution d’une mémoire collective, au-delà des particularismes ?
- Quels sont les enjeux de l’enseignement du fait religieux pour ouvrir vers un monde meilleur.
- Comment faire de l’enseignement du fait religieux un rempart contre fanatismes et sectes ?
- Liberté, égalité, fraternité des religions à l’Ecole, un beau défi pour « la laïque
--------------------------------------------------------------------------------
Contact Secrétariat de la CMRP 8 rue Jean Bart – 75005 Paris
01 46 33 45 39 cmrp.france@wanadoo.fr
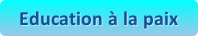
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix-Religions for Peace – France
Commission Education à la Paix , Paris , 2005
Fiche établie par Marie LEMESLE et traduite en anglais par Mehrézia MAIZA
--------------------------------------------------------------------------------
ECOLES PRIVEES ET IDENTITES RELIGIEUSES en France
CONSTAT ACTUEL
Depuis la loi Debré ( 1959) instaurant un « contrat d’association » Etat /Ecoles Privées et après l’abandon du projet de création d’un service unique d’enseignement ( 1984) , les écoles confessionnelles françaises connaissent des relations apaisées avec la République laïque. Elles accueillent un nombre croissant d’élèves alors que la pratique religieuse diminue dans le pays.
--------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTS D’ANALYSE
Quelques repères historiques et institutionnels
- Depuis la Révolution (1789), l’Ecole a une mission d’instruction publique au service de la République, inculquant des valeurs avant tout de civisme et de morale laïque, c’est à dire universelle, a-religieuse et excluant les particularisme culturels régionaux ou autres ( voir les textes de Condorcet)
- Se développant en réaction contre l’emprise de l’Eglise catholique sur l’enseignement dans l’Ancien Régime, cette Ecole conçue comme libératrice reçoit son cadre juridique par la loi du 22 mars 1882 qui lui permettra d’asseoir, par la suite en référence à la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, sa neutralité au niveau des enseignants et des enseignements.
- La loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction du port par les élèves de signes ostensibles religieux s’inscrit dans cette logique égalitaire de refus de laisser s’introduire à l’Ecole des critères de distinction culturelle.
Aspirations nouvelles des usagers de l’Ecole Publique
- La mixité culturelle est souvent perçue par les enseignants comme un enrichissement humain
- Les élèves sont demandeurs et curieux de mieux connaître concrètement la culture des autres.
- La méconnaissance des repères culturels s’avère préjudiciable à la transmission de certains apprentissages
-L’ignorance par l’institution des pratiques et distinctions culturelles est souvent vécue comme du mépris voire de l’arrogance
-Les tensions internes au sein de la communauté éducative demandent des médiations culturelles d’apaisement ( travail sur les mémoires des peuples, enjeux des conflits internationaux).
Enjeux capitaux d’aujourd’hui
- L’Ecole n’est plus la source unique du savoir : médias et internet forgent aussi les consciences.
- L’Enseignement public possède un potentiel inexploité d’ouvertur à de nouveaux champs de la connaissance.
- L’Ecole, en semblant fuir les rencontres qui l’interrogent, donne une image affaiblie de sa capacité à former des citoyens en prise sur la réalité.
- Les valeurs universelles se trouvent dans de nombreux aspects culturels, d’où l’utililté de les dégager pour retrouver une appartenance humaine commune.
- L’Ecole se doit d’être un rempart contre les réflexes identitaires et les dérives sectaires en donnant de ces déviations une lecture courageuse et claire.
--------------------------------------------------------------------------------
AXES DU DÉBAT
- Qui veut réfléchir ensemble à un nouveau projet de « vivre ensemble » républicain?
- Entre cultures et religions : n’est-il pas urgent d’approfondir les distinctions et les relations entre ces deux concepts ?
- L’Ecole Publique ne pourrait-elle pas reconnaître les religions comme des acteurs sociaux présents dans son environnement ?
- L’Ecole française ne risque-t-elle pas de se trouver en porte- à- faux avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ( 1973) ?
--------------------------------------------------------------------------------
Contact Secrétariat de la CMRP 8 rue Jean Bart – 75005 Paris
01 46 33 45 39 cmrp.france@wanadoo.fr
 La Fatiha
La Fatiha
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
"Louange à Dieu, Seigneur des mondes,
Le Clément, le Miséricordieux,
Le Roi du jour du jugement.
C'est Toi que nous adorons,
C'est Toi dont nous implorons le secours.
Indiques-nous le chemin droit,
Celui de ceux que Tu as comblé de Ta grâce,
Non pas celui de ceux qui encourent Ta colère,
Ni celui des égarés."
Saint-Coran - Sourate 1 - "Al-Fatiha" (l'ouvrante)
 Seigneur, fais de moi un instrument de paix
Seigneur, fais de moi un instrument de paix
Là où est la haine, que je sème l'amour.
Là où est l'offense, que je sème le pardon.
Là où est le doute, que je sème la foi.
Là où est le désespoir, que je sème l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je sème la lumière.
Là où est la tristesse, que je sème la joie.
Ô Seigneur,
Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler
Que je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre
Que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant que l'on reçoit
C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon
C'est en mourrant que l'on ressuscite à la Vie.
Saint-François

TOI LE SOUFFLE
Toi le Tout Autre
Qui viens ,
L'Au - delà - de - tout
L'Etranger d'en moi - même,
SOUFFLE
Plus chaud que vent du désert
Plus puissant qu'orage des chaînes dentées
Plus discret qu'haleine ténue de la brise
Tu viens visiter notre coeur
Esprit des esprits
Porte des portes
Chemin des chemins
SOUFFLE
Qui fais battre mon coeur
et fais danser mes mains,
Viens en mon intime intérieur
- fragile comme un roseau coupé -
souffler ta Voie
souffler ta Vie
souffler ta Vive voix !
Amin
Xavier Barois - 1993
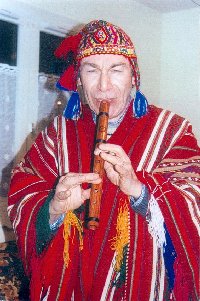
 LES ETAPES DE LA VIE
LES ETAPES DE LA VIE
Grandes étapes de la vie d'un hindou
- La cérémonie du nom a lieu dix ou douze jours après la naissance. Le matin, le père fait une prière dans le sanctuaire domestique, puis les parents l'emmènent au temple, où le prêtre lui murmure des textes sacrés à l'oreille.
- Autres initiations, pendant l'enfance : lorsque l'enfant prend son premier aliment solide, à cinq mois, on récite des prières particulières lors du puja matinal ; il en est de même lors de sa première coupe de cheveux. Lors de la première initiation aux écritures, un des parents guide l'enfant pour écrire trois mantras.
- Lors du mariage, on chante des bénédictions, on asperge les mariés d'eau bénite, on fait des offrandes de riz et les mariés effectuent le rite des sept pas : ils font un voeu à chaque pas : nourriture, force, prospérité, bien-être, enfants, bonheur, harmonie.
- Lors des funérailles, le corps du défunt doit être purifié par le feu pour retourner aux quatre éléments: terre, feu, eau, air. La crémation est accompagnée de prières pour que l'âme du défunt trouve la paix.
Grandes étapes de la vie d'un bouddhiste
- La naissance : on ne devient pas bouddhiste par naissance.
- La prise de refuge : après avoir suivi l'enseignement bouddhiste, le chemin de libération intérieure, on fait acte de profession de foi des Trois Joyaux en prononçant la phrase : "Je prends refuge en Bouddha, en la Doctrine, en la Communauté".
- Lors du mariage, les époux renouvellent la profession de foi des Trois Joyaux et s'engagent à vivre dans les règles devant les amener à l'Éveil, et à éduquer leurs futurs enfants dans ce sens.
- La mort est le passage d'une vie à une autre. Pour faciliter la réincarnation, il faut que le mourant soit dans de bonnes conditions, et dans un bon environnement ; le corps est traité avec respect.
- Le rituel des funérailles est simple : prière pour le défunt et méditation silencieuse.
- Dans le bouddhisme, il n'y a pas de prêtres, ni de sacrifice, et aucun rite n'est obligatoire.
Grandes étapes de la vie d'un juif
- Pour les enfants mâles, le premier rite, huit jours après la naissance, est la circoncision (berith mila). Ce rite qu'Abraham fit en signe de l'Alliance avec Dieu.
- L'enfant reçoit l'enseignement de la Torah jusqu'à 13 ans (garçons) ou 12 ans (filles), âge auquel a lieu la bar mitsva (fils du commandement) ou bath misva (fille du commandement). A la synagogue, le garçon "monte à la Torah" et lit à haute voix en hébreux un passage de la Torah, puis reçoit une bénédiction de son père. Pour les filles, la cérémonie est familiale, car elles ne peuvent pas lire à la synagogue.
- Lors du mariage, l'homme revêt le tallith (châle de prière). Les mariés boivent une coupe de vin bénie par le rabbin, et le mari passe un anneau à l'index de sa femme et dit : "Te voilà consacrée à moi, selon la loi de Moïse et d'Israël", puis placés sous la houppa (étoffe), ils récitent les sept bénédictions nuptiales. A la fin, le marié brise un objet de verre ou de porcelaine en mémoire de la destruction du Temple.
- Le corps du défunt est enterré le plus tôt possible. Lors des funérailles, les proches parents font le rite de la keria : ils déchirent une partie de leur vêtement en signe de chagrin ; des prières sont récitées, on chante des psaumes.
Grandes étapes de la vie d'un chrétien
- Le baptême, peu après la naissance, s'il naît dans une famille chrétienne ; mais à n'importe quel âge s'il se convertit, après quelques temps de catéchuménat. En Orient, on célèbre la communion et la confirmation en même temps.
- Première communion vers 8 ou 10 ans. Ensuite, le chrétien est invité à participer régulièrement à la messe (ou à la "cène" chez les protestants).
- Dans certaines régions, il y a encore une profession de foi, pendant l'adolescence.
- La confirmation, pour renouveler son baptême et accueillir l'Esprit-Saint, à l'entrée dans l'âge adulte.
- Le mariage, ou d'autres engagements comme par exemple l'engagement au célibat des prêtres, religieux, religieuses.
- L'onction des malades, pour un catholique, en cas de maladie grave ou à l'approche de la mort. D'autres prières auprès des malades existent dans les autres confessions.
- Les funérailles, dans l'espérance de la résurrection des morts.
- Après la mort d'un chrétien, on peut continuer à prier pour lui ou même le prier, s'il est considéré comme saint (pour les catholiques).
Grandes étapes de la vie d'un musulman
- A la naissance d'un bébé, le père le prend dans ces bras et lui récite l'appel à la prière à l'oreille droite, puis la formule dite avant la prière à l'autre oreille. A sept jours, les parents organisent une fête.
- La circoncision, généralement effectuée durant l'enfance est signe de purification spirituelle, elle existait chez les arabes avant l'Islam. Elle symbolise l'appartenance à la famille d'Abraham.
- L'adolescence : dès la puberté, garçons et filles apprennent les 5 piliers de l'islam.
- Lors des fiançailles, les fiancés scellent leurs promesses d'engagement par la récitation de la Fatiha (1ère sourate du Coran). Lors du mariage, l'acte de mariage est établi devant un notaire assermenté et devant deux témoins. La présence d'une autorité religieuse n'est pas requise : le mariage devant le maire est valable. La fête du mariage débute chez la famille de la mariée par la cérémonie du henné, et se poursuit par des danses, des chants...
- Le pèlerinage n'est obligatoire que on en a les moyens matériels et physiques. Le jour du départ et celui du retour sont des jours de fête pour les familles de pèlerins.
- La mort est le passage vers la vie future. Le corps est soigneusement lavé et enterré dans les 24 heures. Au cimetière la tête du défunt est dirigée vers la Mecque. On récite des versets du Coran avant et après l'enterrement. La famille porte le deuil pendant 3 jours (40 jours dans certains pays) puis organise un repas.
Grandes étapes de la vie d'un bahaï
- Accueil du petit enfant se pratique dans certaines familles, fête conviviale qui peut avoir un caractère spirituel ; il n'y a pas de cérémonie instituée.
- Déclaration de foi : à partir de l'âge de 15ans, l'adolescent éduqué dans une famille bahaïe choisit (ou non) de déclarer sa foi en Baha'u'llah. Il n'y a pas de cérémonie particulière, ce peut être à l'occasion d'une fête des 19 jours.
- L'Age de la majorité bahaïe est 21 ans : l'adulte a alors le droit de vote et participe, dans le recueillement et la prière, à l'élection des institutions locales.
- Le mariage est une cérémonie instituée. Les époux doivent prononcer le verset "En vérité, nous nous conformerons tous (toutes) à la volonté de Dieu", en présence de témoins. La célébration comporte prières, musique, et lectures.
- La mort est considérée comme une étape vers la vie éternelle. Le corps, temple de l'âme, est traité avec respect.
- Les funérailles bahaïes comportent une prière rituelle, dite en commun. On prie pour le défunt, au moment des funérailles et après.
Réalisé par le Groupe Interreligieux pour la Paix - 93 (affilié à la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix)
en mai 2000, à l'occasion de l'exposition "Temps pluriel des religions" à Saint-Denis
Malgré le soin pris pour collecter ces informations, des erreurs ou des inexactitudes ont pu s'y glisser. Si vous en constatez, nous serions très heureux que vous nous en informiez, afin que nous puissions y apporter des corrections.
Groupe Interreligieux pour la Paix-93 :Interreligieux.Paix93@wanadoo.fr


